
Colloques
du Groupement des Anthropologistes de Langue Française (GALF)
Ben M’rad, L., Chalbi,
N., 2004, Le choix matrimonial en Tunisie est-il
transmissible?. Antropo, 7, 31-37. www.didac.ehu.es/antropo
Le
choix matrimonial en Tunisie est-il transmissible?
Is the matrimonial choice transmettable in Tunisia?
L. Ben M’rad1, N. Chalbi2
1
Chercheur. Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Campus
Universitaire, 1060 Tunis Tel. :
++ 216 98356506. E-mail : lamyabm@yahoo.fr
2 Professeur
Emérite. Laboratoire de Génétique et Biométrie, Campus Universitaire, 1060
Tunis. Tel. : ++ 216- 98 262 032. Fax : ++ 216 – 71 885480. E-mail :
noureddinechalbi@yahoo.fr
Mots-clés: Tunisie, mariages consanguins, choix
matrimonial, héritabilité, environnement social.
Keywords: Tunisia, consanguineous marriages, marital choice,
heritability, social environment.
Résumé
La fréquence élevée des
mariages endogames et consanguins en Tunisie se justifie par des traditions
devenues règles de conduite dans la société pour des intérêts divers. Ces
règles contribuent fortement à la détermination de la circulation des flux
génétiques dans la population.
Dans une enquête menée auprès de familles échantillonnées,
nous avons comparé le type de choix matrimonial du père et de la mère avec
celui de leurs enfants pour voir s’il y a transmission de ce comportement d’une
génération à la suivante et analyser les causes.
Un échantillon de 370 femmes âgées de 18 à 63 ans a été soumis à un
questionnaire et a permis d’établir un inventaire des unions consanguines chez
les couples étudiés ainsi que chez leurs parents respectifs. Les unions
consanguines des couples, tous degrés confondus représentent 32,71%. Elles atteignent 33,25% et 34,04% chez
les parents. Ce sont les unions entre cousins germains qui sont les plus
représentées, avec 16,21% pour le couple, 18,64% et 15,4% pour les parents. Une
place particulière est réservée à l’étude des unions avec la fille du frère du
père. Des tableaux de contingence parents/enfants ont mis en évidence une
ressemblance du choix matrimonial des enfants avec celui de leurs parents,
appuyés par le ![]() de Pearson. Ce choix apparaît pour le
mari comme pour la femme, significativement " transmissible " du
comportement de leurs parents. La discussion de ces résultats aborde la
transmission de ce phénomène au niveau de la population et ses causes environnementales.
Elle souligne l’importance de la place qu’occupe l’environnement social,
économique et culturel dans la détermination de la circulation des flux
génétiques dans les populations humaines et le maintien de ce modèle de famille
dans la société.
de Pearson. Ce choix apparaît pour le
mari comme pour la femme, significativement " transmissible " du
comportement de leurs parents. La discussion de ces résultats aborde la
transmission de ce phénomène au niveau de la population et ses causes environnementales.
Elle souligne l’importance de la place qu’occupe l’environnement social,
économique et culturel dans la détermination de la circulation des flux
génétiques dans les populations humaines et le maintien de ce modèle de famille
dans la société.
Abstract
The high frequency of endogamous and consanguineous
marriages in Tunisia are justified oneself by traditions, which become rules of
conduct in the society for various interests. A such rules contribute strongly
to the determination of the circulation ways of genetic fluxes in the
population.
In an investigation led by sampled families, we compared
the type of matrimonial choice of the father and the mother with the one of
their parents in the aim to see if there is transmission of this behavior of a
generation to the following and analyze the reasons.
A sample of 370 aged women between 18 and 63 years have
been questioned and permitted to establish an inventory of the consanguineous
unions concerning the studied couples as well as their respective parents. The
unions between relatives of the couples interrogated, all disconcerted degrees
represent 32,71%. They reach 33,5% and 34,04% at the parents. These are the
unions between first cousins who are the more represented, with 16,21% for the
couple, 18,64% and 15,4% for the parents. A particular place is reserved to the
survey of the unions with the girl of the father's brother.
Tables of contingency parents/infants put in evidence for
the resemblance of the matrimonial choice of the children with the one of their
parents, supported by the ![]() of Pearson. For the husband as well as for the woman, the
choice seems to be "inherited" significantly from the behavior of their
own parents. The discussion of this results watch the importance of the place
that the social, economic and cultural environment occupies in the
determination of the circulation of the genetic fluxes in the human
populations.
of Pearson. For the husband as well as for the woman, the
choice seems to be "inherited" significantly from the behavior of their
own parents. The discussion of this results watch the importance of the place
that the social, economic and cultural environment occupies in the
determination of the circulation of the genetic fluxes in the human
populations.
Introduction
Comme on le sait, les
gènes circulent dans toute société selon les dynamiques établies par les types
de rencontres et d’unions entre les individus qui portent ces gènes. De ce
fait, le choix du conjoint influe ainsi sur la structure génétique de la
famille et oriente par voie de conséquence, l’évolution du patrimoine
héréditaire de toute la population (Cavalli-Sforza et al., 1966 ; Chapman
et Jacquard, 1971). Dans l’histoire des peuples, le mariage a pris
progressivement une signification particulière avec l’institution des biens et
de la propriété, les implications sociales, culturelles, économiques et
religieuses dans la vie quotidienne des individus. Considérée sous cet angle, l’étude du type de choix du
conjoint contribue ainsi à
distinguer le type de société (Tillon, 1966). Dans ce domaine, de nombreuses
études ont montré que le choix matrimonial dépend généralement de motivations
et de contraintes, le plus souvent, en rapport avec des raisons d’ordre
culturels, religieux, économique, politique, etc…(Reynolds, 1988).
Endogamie et consanguinité en Tunisie
Dans les populations,
les individus s’unissent dans la majorité des cas soit :
-
au hasard,
-
entre conjoints apparentés.
Dans le second cas,
les unions sont dites consanguines et sont contractées entre conjoints d’une
même famille, issus d’une lignée directe (grand-père, père, fils, petit-fils)
ou d’une lignée collatérale (frère, neveu, oncle, cousin).
Les unions consanguines sont générées par l’endogamie de
toute sorte. Les unions endogames sont celles où les deux conjoints
appartiennent à une même catégorie d’origine (localité régionale, classe
sociale, religieuse, clan, tribu, famille).
Considérée sous cet angle, la consanguinité est donc une
forme d’endogamie limite où, au bout du compte, la famille est considérée
elle-même comme une catégorie d’origine (Chalbi et Zakaria, 1998;
Lathrop et Pison, 1982; Mghirbi, 2002). On constate que les mariages
endogames occupent aujourd’hui encore une place très importante dans nos
sociétés. Nombreux auteurs considèrent l’endogamie comme un facteur
d’immobilité sociale. Les recherches effectuées en Tunisie ont montré
significativement qu’il y a une endogamie de 87,57% sur la base de la catégorie
gouvernorat (province) d’origine (Zakaria, 1999) pouvant même atteindre, 96,8%
dans la génération précédente comme on l’a constaté dans les communes rurales
de Nabeul (Mghirbi, 2002).
Même lorsque le choix du conjoint est en apparence tout à
fait libre, il est aisé de constater qu’au niveau de la décision individuelle,
on se conforme en fait dans la grande majorité des cas à un modèle collectif caractéristique
de la société. Notre but, dans ce travail est de mettre en relief, à travers
l’étude d’un échantillon formé de couples et de leurs propres parents, les
aspects qui peuvent nous éclairer sur la similitude du comportement matrimonial
entre les parents et leurs enfants.
Matériel et méthodes
Nous avons mené une
enquête en septembre 2000 auprès de familles échantillonnées au hasard parmi
celles qui se présentent spontanément au Centre Hospitalo-Universitaire Mongi
Slim de la Marsa ainsi qu’au dispensaire de la cité Intilaka. Notre enquête s’est déroulée auprès de
370 femmes, âgées de 18 à 63 ans.
L’enquête a été
conduite à l’aide d’un questionnaire préparé au préalable en vue de recueillir
des données sur les couples contemporains dont la femme est soumise au
questionnaire, et aussi sur leurs propres parents et leurs grands-parents. Les
questions portent sur les liens de parenté, les lieux d’origine, de résidence,
l’habitat, le niveau d’instruction, la profession et divers indicateurs de la
qualité de la vie.
Importance des unions
consanguines dans la generation actuelle
L’analyse des données
fournies par les questionnaires nous a permis de constater l’existence de liens
de parenté très étroits entre les conjoints contemporains et leurs parents. Le
tableau 1 montre que:
-
Dans la génération des couples interrogés (notée G.ce), le
pourcentage des unions consanguines dans l’ensemble de l’échantillon, représente 32,71%.
-
Dans la génération des parents de la femme et ceux du
conjoint (notées respectivement G.Pf et G.Pm), sont respectivement de 33,25% et
34,04%.
Ce sont, dans notre
échantillon, les unions contractées entre cousins germains qui sont les plus
fréquentes avec, respectivement, 16,21% pour G.Ce, 18,64% pour G.Pf et 15,4%
pour G.Pm.
|
Générations |
Types de consanguinités |
|||||
|
U. Cg |
U. Ci |
U. Cig |
U. Cnd |
Total |
||
|
G. Ce |
ni |
60 |
16 |
24 |
21 |
121 |
|
% |
16,21 |
4,32 |
6,48 |
5,67 |
32,7 |
|
|
G. Pf |
ni |
69 |
7 |
16 |
31 |
123 |
|
% |
18,64 |
1,89 |
4,32 |
8,37 |
33,24 |
|
|
G. Pm |
ni |
57 |
7 |
13 |
42 |
126 |
|
% |
15,4 |
1,89 |
3,51 |
13,24 |
34,05 |
|
U.
Cg: unions entre cousins germains, U.Ci: unions entre cousins inégaux, U.Cig:
unions entre cousins issus de germains, U.Cnd: unions à consanguinité non
définie, G.Ce: génération du couple étudié, G.Pf: génération des parents de la
femme, G.Pm: génération des parents du mari.
Tableau 1.
Répartition des différents types d’unions consanguines dans les trois
générations.
Table 1. Distribution of the various types
of consanguineous marriages in three generations.
Analyse
comparative du choix matrimonial parents/enfants
En mettant en parallèle le type de choix des enfants avec
celui de leurs parents, on peut se demander si le comportement dans le choix
matrimonial ne serait pas, en quelque sorte,
" transmissible " à l’échelle de la société ? En effet,
comme nous pouvons le constater d'après la figure 1, tout se passe comme s’il
existait un déterminisme parental du comportement matrimonial observé chez les
enfants, tellement ces derniers imitent leurs parents.
Les données recueillies ne permettent pas d’établir des
covariances enfants/parents relativement aux divers facteurs de l’Environnement
pour estimer la ressemblance quant au choix matrimonial. Nous avons par
conséquent testé la ressemblance du comportement matrimonial à l’aide de l’étude de l’hypothèse d’indépendance dans
la répartition des unions inscrites dans un tableau de contingence parents / enfants.
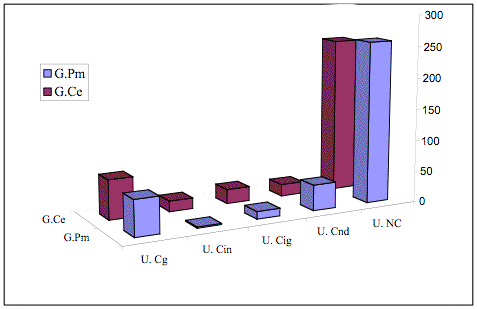
Figure 1. Distribution du choix
matrimonial des maris et des parents.
Figure 1. Distribution of the marital
choice of the husbands and their parents
Nous avons
établi un tableau de contingence où les lignes représentent le type de mariage
du mari ou de la femme et les colonnes, le type de mariage de leurs parents.
Les effectifs observés figurent sur le tableau 2.
|
U.Cg |
|
|||||||
|
G.ce
G.pm |
FFP |
FFM |
FSP |
FSM |
U.Cin |
U.Cig |
U.Cnd |
U.NC |
|
U.Cg |
FFP |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
20 |
|
FFM |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
9 |
|
|
FSP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
FSM |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
|
|
U.Cin |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
U.Cig |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
U.Cnd |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
6 |
5 |
20 |
|
U.NC |
16 |
10 |
5 |
11 |
9 |
10 |
11 |
186 |
FFP:
fille du frère du père, FFM: fille du frère de la mère, FSP: fille de la sœur
du père, FSM: fille de la sœur de la mère.
Tableau
2. Effectifs observés du type de mariage du mari en fonction
de celui de ses parents.
Table
2. Actual observed of the wedding type of the husband
according to that of his parents.
La prise en
compte de toutes les classes de consanguinité rencontrées dans l’enquête
conduit à un tableau avec beaucoup de données manquantes ou inférieures à 5.
Pour cela, nous avons procédé à un groupement selon trois classes de la
variable consanguinité :
-
Classe 1, regroupe les unions entre cousins germains (
U.Cg),
-
Classe 2, regroupe les unions consanguines autres qu’entre
cousins germains ( U.A.Cg),
-
Classe 3, regroupe les unions non consanguines ( U.N.C ).
Ces effectifs de
classes figurent dans le tableau 3.
Sur le tableau 3
figurent aussi les effectifs théoriques établis sur la base de l’hypothèse
d’indépendance entre les lignes et les colonnes du tableau de contingence. La vraisemblance de l’hypothèse nulle
(H0) a été testée à l’aide du ![]() de Pearson à 4 ddl. On a trouvé
de Pearson à 4 ddl. On a trouvé ![]() = 16,81, ce qui entraîne le rejet de
l’hypothèse d’indépendance à 5%.
= 16,81, ce qui entraîne le rejet de
l’hypothèse d’indépendance à 5%.
Ainsi donc, le type de choix du conjoint
pour le mari n’est pas, de toute vraisemblance, indépendant de celui effectué
par ses propres parents. Tout se passe comme si le choix matrimonial pratiqué
par un enfant est fait conformément à l’image du type de choix déjà effectué
par ses propres parents.
|
G. Ce G. Pm |
U.Cg |
U.A.Cg. |
U. N.C. |
Total |
||||
|
|
|
|
|
|||||
|
U.Cg |
Ob |
9.00 |
12.00 |
36.00 |
57.00 |
|||
|
Th |
9.70 |
9.09 |
38.20 |
|||||
|
U.A.Cg |
Ob |
12.00 |
17.00 |
26.00 |
55.00 |
|||
|
Th |
9.36 |
8.77 |
36.86 |
|||||
|
U.N.C |
Ob |
42.00 |
30.00 |
186.00 |
258.00 |
|||
|
Th |
43.92 |
41.14 |
172.92 |
|||||
|
Total |
|
63.00 |
59.00 |
248.00 |
370.00 |
|||
Tableau
3. Effectifs observés (Ob) et théoriques (Th )du type de
mariage du mari en fonction de celui de ses parents.
Table
3. Actual observed (Ob) and
theoretical (Th) of the wedding type of the husband according to that of his
parents).
Cette forte liaison entre les deux
générations quant au choix matrimonial indique l’existence d’une covariance
Parents/Enfants qui n’a pas pu être établie et qui ressort clairement de la
Figure 1.
Ceci signifie qu’au niveau de la société, cette hérédité quasi-parfaite, et qui, de toute évidence, ne peut d’aucune façon être attribuée à l’effet des gènes reçus, est due uniquement au milieu général, l’environnement, qui entoure le couple et détermine son orientation dans le choix matrimonial.
L’environnement des futurs conjoints est complexe et englobe divers facteurs d’ordre familial, éducationnel, culturel, religieux, économique, social etc… Il dépend d’intérêts familiaux, du clan et occupe donc une place déterminante quant à la circulation des flux génétiques dans les populations humaines.
Ainsi, pour conclure,
l'analyse statistique réalisée conduit à l'hypothèse d'une transmission du
comportement matrimonial hautement significative chez les couples de notre étude.
Cette transmission est la conséquence des effets du milieu environnemental des
couples, qui font que les époux se choisissent en fonction du choix de leurs
parents, même si en apparence, ce choix semble délibéré pour beaucoup.
Discussion
Le mariage peut sembler une affaire individuelle ne
concernant que les futurs conjoints. Mais, dans de nombreuses sociétés,
aujourd'hui comme hier, le choix du conjoint demeure encore moins libre que
nous ne l'imaginons généralement compte tenu de la modernisation. Les résultats
de notre étude le confirment. Il semble donc qu’en Tunisie, tout comme dans la
société arabo-musulmane, certaines règles fixent le choix du conjoint :
par exemple, l’union avec la fille du frère du père est vivement recommandée,
celle avec la fille du frère de la mère est presque déconseillée, et enfin,
celle avec la fille de la sœur du père, presque proscrite.
L’analyse statistique des tableaux de contingence pour les
deux générations parents/enfants a mis en évidence l’existence d’une ressemblance
entre le comportement démographique des enfants et celui de leurs parents. La
valeur très élevée du ![]() vient appuyer
cette similitude du comportement d’une génération à l’autre et permet d’affirmer
que le choix matrimonial, dans notre échantillon, présente pour le mari comme
pour la femme, une forte dépendance de celui de leurs parents. Ces résultats
montrent à quel point l’environnement socio-économique, culturel et religieux
occupe une place déterminante quant à la circulation des flux génétiques dans
les populations humaines.
vient appuyer
cette similitude du comportement d’une génération à l’autre et permet d’affirmer
que le choix matrimonial, dans notre échantillon, présente pour le mari comme
pour la femme, une forte dépendance de celui de leurs parents. Ces résultats
montrent à quel point l’environnement socio-économique, culturel et religieux
occupe une place déterminante quant à la circulation des flux génétiques dans
les populations humaines.
L’incidence de l’intérêt économique sur le choix
matrimonial en Tunisie a été étudié dans le gouvernorat de Nabeul (M’ghirbi,
2002). Sur un échantillon de 547 couples tirés au hasard, l’auteur note que les
maris ayant choisi les modèles de mariages consanguins, sont essentiellement
des agriculteurs propriétaires de terrains agricoles. Ceci a été vérifié pour
les générations successives (celle des couples et celle de leurs parents
respectifs). L’auteur a souligné en particulier que ces unions entre apparentés
ont pour but primordial de préserver les biens familiaux, source de revenus
collectifs. Ainsi, les ruraux propriétaires de terres agricoles tendent à se
conformer à un modèle matrimonial collectif qui vise la conservation des terres
au sein de la même famille, notamment par les unions avec la fille du frère du
père et il s’ensuit une nette prépondérance de chaînes masculines dans
l’apparentement des conjoints (Comeau, 1999).
Ce modèle de
famille semble bien ancré dans la société arabo-musulmane et très fréquent dans
les pays du Maghreb malgré la modernisation (Ben Hamadi, 1996). Au Maroc, une
enquête de santé publique conduite depuis 1962, a mis en évidence l’existence
d’une consanguinité allant jusqu’à 32% dans les régions montagneuses et isolées
du Rif (Lamdouar-Bouazzaoui, 1994). Dans le Monde Arabe, on a constaté des
niveaux de consanguinité très élevés dans différents pays, très souvent entre
cousins de premier degré (Hafez et
al., 1983 ; Khlat, 1988). Dans les U.A.E. (Émirats Arabes Unies), le taux
de consanguinité atteint 50,5%, avec une prévalence pour les mariages entre
cousins germains, représentant 26,2% (Al-Gazali.et al., 1997).
Enfin, en Lybie,
l’étude publiée par le PAPCHILD (1997) concernant l’enquête menée dans le pays
en 1995, a porté sur un échantillon de 4686 femmes distribuées en classes selon
la durée de leur mariage, allant de plus de 5 ans à 30 et plus, a révélé les
faits suivants. Les unions entre cousins germains paternels ou maternels
s’élèvent à 40,8% pour les femmes urbaines et à 49,2% pour les femmes rurales.
Cette étude précise de plus, qu’en milieu urbain, ces mêmes unions sont de
36,0% pour les plus jeunes, mariées depuis au moins 5 ans, contre 45,0 % pour
la classe la plus âgée, 30 ans de mariage et plus. Pour la femme rurale, ces
unions sont beaucoup plus fréquentes, avec respectivement pour les deux classes
44,6 et 50,0%.
Le choix du conjoint tend à se faire dans
une certaine proximité géographique et il se porte plus volontiers sur un
partenaire apparenté (par peur de l’étranger), souvent de même niveau
socio-économique, ayant un niveau d'instruction proche. Les individus tendent à
se conformer à un modèle collectif, quel que soit le degré de conscience qu'ils
en ont quant aux conséquences.
References bibliographiques
Al-Gazali, L. I.,
Bener, A., et Abdulrazzaq, Y. M., 1997,
Consanguineous marriages in the United Arab Emirates. Journal of Biosocial
Science, 29, 491-497.
Ben Hamadi, B., 1996, Modèles de Familles et Fécondité au Maroc.
Congrès Régional Arabe de Population, U.I.E.S.P., Le Caire, 250-272.
Cavalli-Sforza, L.L.,
Kimura, M. et Barrai, I., 1966, The
probability of consanguineous marriages.
Genetics, 54, 37-60.
Chalbi, N., et
Zakaria, D., 1998, Modèles de familles, endogamie et consanguinité
apparente en Tunisie. Essais de mesure. Famille et population. Nouvelle série.
O.N.F.P. Tunis, 1, 39-59.
Chapman, A.M.
et Jacquard, A., 1971, Un isolat d’Amérique Centrale : Les indiens
Jicaques du Honduras. Génétique et Populations, Hommage à Jean Sutter, INED, In
Cahier n°60, PUF.
Comeau, R., et Dionne, B., 1999, À propos de
l’histoire nationale. Département d’histoire. Université de Montréal Christian
Dessureault. Sillery, Septention, pp.160.
Hafez, M., El Tahan, H., Awadallah, M., El Khayat, H.,
Abdelgaffar, A., et Ghoneim, M., 1983, Consanguineous mating in Egyptian
population. Journal of Medical Genetics, 20, 58-60.
Khlat, M., 1988, Consanguineous marriages and reproduction
in Beirut, Lebanon. American Journal of Human Genetics, 43, 186-196.
Lamdouar-Bouazzaoui,
N., 1994, Consanguinité et santé publique au Maroc. Bull. Acad. Natle. Med., 6, 1013-1027.
Lathrop, M.,
et Pison, G., 1982, Méthode statistique d’étude de l’endogamie :
application à l’étude du choix du conjoint chez les Peul Bandé. Population,
3, 513-542.
M’Ghirbi, J.,
2002, Endogamie, Choix matrimonial, Consanguinité, Facteurs
Démographiques et Socio-économiques dans le Gouvernorat de Nabeul (Tunisie).
Diplôme d’études approfondies, Faculté des Sciences de Tunis, pp. 105.
Papchild,
1997, Enquête arabe lybienne sur la santé de la mère et de l’enfant de 1995. Rapport principal. Pan Arab Project for Child
Development ; League of Arab States, Cairo.
Reynolds, V., 1988, Religious rules, mating patterns and
fertility. Human Maiting Patterns. Cambridge University Press, 191-208.
Tillon, G.,
1966. Le harem et les cousins. Le Seuil, Edit. Paris.
Zakaria, D.,
1999, Étude de l’endogamie d’origine régionale, de la distribution de la
consanguinité apparentée et du comportement intergénérationnel, dans le choix
matrimonial en Tunisie. Intérêt des noms de famille et de l’isonymie maritale.
Thèse de doctorat en Biologie. pp. 180.