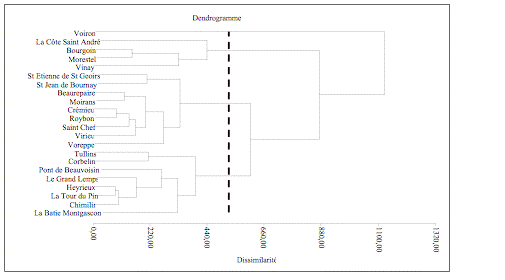Prost, M., Revol M.
et Boëtsch, G., 2004, Biodémographie et Structures Urbaines: Les Agglomérations
de Plaine Dauphinoise de 1579 à 1890. Antropo, 6, 25-41.
www.didac.ehu.es/antropo
Biodémographie
et Structures Urbaines: Les Agglomérations de Plaine Dauphinoise de 1579 à
1890.
Biodemography and
Urban Structures: the Towns of Dauphiné Plain from 1579 to 1890.
Michel Prost1, Monique Revol2
et Gilles Boëtsch1
1 UMR 6578 Laboratoire d’Anthropologie: adaptabilité biologique et culturelle. CNRS/Université de la Méditerranée. Faculté de Médecine. 27, Bd. Jean Moulin. 13385 Marseille Cedex 5. E-mail: Gilles.Boetsch@medecine.univ-mrs
2Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales. Centre de Recherches Historiques. 54 Bd. Raspail. 75006 Paris.
Mots Clés: Agglomérations, Apparentement, Biodémographie, Choix du conjoint, Isonymie, Patronyme.
Keywords: Biodemography, Choice of the spouse, Isonymy,
Cities, Kinship, Surname.
«…on retrouve les sociétés, les deux styles de vie, les deux façades: et l’antinomie qui oppose bourgeois et rustres, ville et campagne, et, pourquoi pas, barbarie et civilisation. [1598-1605]». E. Le Roy Ladurie (1985).
«Les campagnards sont lourds, stupides et débauchés. Les nobles et les habitans des villes sont polis, dépourvus de toute arrogance, aimables et vifs, sans que leur gravité en souffre, et très organisés pour l’étude des sciences». Just Zinzerling. (1616). Traduction de 1859.
Résumé
Dans cet article, nous nous intéressons à la structure des populations urbaines de la province de Dauphiné. Nous abordons ici, au moyen de méthodes émanant de la biodémographie, une approche nouvelle des groupements humains. 20 agglomérations de plaine sont observées au travers de leurs actes de mariage durant une large période couvrant les années 1579-1890. Près de 34000 unions sont prises en compte. L’informatisation de bases de données procure à l’histoire quantitative un avantage double, non seulement elle gère des fichiers très importants mais encore elle permet d’accéder au cœur même des populations en évaluant leur degré d’homogénéité génétique. Les cités dauphinoises ne forment pas une unité véritable puisque nous observons, tout à la fois, une diversité dans les comportements matrimoniaux et dans les structures génétiques. Globalement, ces localités abritent davantage d’habitants que d’autres communautés de la plaine entre Grenoble et Lyon. Néanmoins les indices que nous recueillons donnent à penser que leurs pratiques en matière de nuptialité demeurent proches de celles de la ruralité environnante. A contrario des «rurbains» actuels, nous pourrions alors les qualifier de «villes rurales» ou de «bourgs ruraux» du Bas Dauphiné.
Summary
In this study, we are interested by the biodemographic structures of
urban populations of the province of Dauphiné. By means of concepts
stemming the genetic of populations and the methods resulting from the
historical demography and the biological anthropology, we have access to a new
approach of human groupings. 20 towns of plain are considered through marriage
for the 17th and 18th centuries: more than 34,000 unions
are taken in account. The cities of the Bas Dauphiné do not seem to
form a real unity. We notice a variety: in the quantity of populations, in
marital behaviours and in the genetic structures. Globally, these urban
populations possess more inhabitants that the other communities situated
between Grenoble and Lyon. Nevertheless, the calculated biodemographic
indications demonstrate that marital practices are similar to those of the
surrounding rural parishes. These urban structures should be qualified as
“large rural village” of the Dauphiné.
Introduction et problématique
D’un point de vue anthropologique, nous cherchons à connaître quelles sont les capacités des hommes à s’insérer et à perdurer dans divers écosystèmes. A cet égard, la province alpine du Dauphiné offre une importante diversité de groupements humains et d’implantations comme en témoignent, par exemple, les extrema altitudinaux qui s’étagent de 33 à 4103 mètres. Ce continuum géographique, permet d’observer de multiples écosystèmes: ruraux, semi-montagnards [plateaux et «balcons»], semi-urbains ou urbains [bourgs, agglomérations et villes] et montagnards. Assurément, au cours des générations, les communautés se sont adaptées aux contraintes environnementales particulières. Néanmoins, les premières évaluations d’ordre biodémographique qui ont été menées récemment suggèrent que le Dauphiné ne représente pas, durant l’Epoque Moderne au moins, un invariant culturel pertinent (Prost et Revol, 2000 et 2002). Ici, nous étudions des populations urbaines qui se situent à l’intermédiaire entre celles résidentes dans les très grandes villes et celles, majoritaires, formant l’ensemble rural, les agglomérations de la plaine situées entre Lyon et Grenoble. La situation médiane de ces unités populationnelles, souvent difficilement classables, fait que, l’on se demande si ce sont des villes, des pseudo-villes, des cités à part entière ou bien des bourgs ou encore de gros villages agglomérés (Le Mée, 1999). Les barrières en la matière s’avérant toujours difficiles à établir clairement, on procédera par comparaisons en tentant d’observer les principaux facteurs qui rassemblent ou éloignent ces populations urbaines relativement aux rurales. Ce problème de classement, de hiérarchisation n’est pas vraiment nouveau puisque déjà en 1678, Lubin s’interrogeait: «Il faudrait donc convenir et savoir précisément qui sont les places auxquelles on doit donner le nom de villes et quelles sont celles qui ne le méritent pas» (Dupâquier et al., 1988). Plus tard en 1690, dans son dictionnaire, Furetière donne une définition: «(la ville est) l’habitation d’un peuple assez nombreux, qui est ordinairement fermée de murailles; assemblage de plusieurs maisons disposées par rues et renfermées d’une clôture commune, qui est ordinairement de murs et de fossés». Au siècle suivant, en 1771, le dictionnaire de Trévoux précise que: «ce ne sont pas les murs qui distinguent le bourg de la ville, mais le droit de bourgeoisie, et les privilèges qui sont attachés à la ville, non au bourg. Il se distingue du village en ce qu’il est plus grand. Il a toujours une paroisse et une espèce de magistrature, une foire annuelle et un marché…». De même, l’historien dissocie véritablement l’urbain du rural, tout en affirmant la complémentarité des deux entités: «la ville, «dépendante» de la campagne dans ses structures sociales comme dans la formation de son capital et de son revenu, est bien le lieu de rassemblement de la «classe propriétaire», et de ceux qui, de près ou de loin, copartageants ou dépendants étroitement soumis, gravitent autour d’elle» (Vovelle, 1980). Dans un autre registre, celui de la sociologie moderne, on souligne par exemple, l’importance de la localité de naissance des conjoints à l’époque contemporaine, selon que l’on se situe dans une localité comptant moins de 2000 habitants, ou davantage (Girard, 1981). C’est d’ailleurs sur cette base numérique que l’on considéra, au XIXe siècle, l’existence ou non des villes: «Sous le Premier Empire, on hésita à choisir entre 1000 et 2000 habitants. Par la suite, de 1821 à 1841, on retint, comme si on avait voulu prendre le juste milieu entre ces deux niveaux, le chiffre de 1500 personnes agglomérées. Enfin, au recensement de 1846 la Statistique Générale de la France (S.G.F.) considéra comme ville, toute commune dont la population agglomérée au chef-lieu atteignait ou dépassait 2000 habitants» (Le Mée, 1999).
Ainsi, en se référant aux études déjà établies par les spécialistes, une dichotomie marquante devrait être observée entre les différents indices qui seront recueillis et ceux, déjà connus de la ruralité. Mais aussi, alors que les sociologues constatent actuellement l’impact de l’importance démographique de l’agglomération sur le mariage français, qu’en était-il aux siècles précédents ? Au demeurant, il est de notoriété que la cité joue un rôle conséquent, aussi bien dans l’attraction de populations nouvelles avides de bourgeoisie, que dans celui de la variété génétique. «Mais le jeune Sauvaire est un self-made man: homme d’initiative, il a quitté la terre pour la ville; il a fait fortune, de quoi racheter à son père le mas de Gavot, en 1590; il a pris les goûts de luxe des bourgeois, avec la nuance criarde d’un marchand parvenu…» (Le Roy Ladurie, 1985). Au n’en pas douter, les villes sont véritablement des lieux de brassage et de diversité. Au XVIe siècle déjà, Charles Expilly le constatait pour la ville de Grenoble: «L’affluance de habitans alloit toujours augmantant en sorte que (…) à paine y avoit-il assez de maisons pour comprendre et loger tant de monde qui tous les jours y accouroit de diverses parts». En réalité, les foires qui se produisent dans les villes sont des carrefours pour des échanges à la fois commerciaux, mais aussi pour des rencontres de tous ordres qui forcément produiront à terme une hétérogénéité génétique. «La capitale normande n’a survécu qu’en puisant ses forces dans les campagnes voisines. En trois siècles [de 1550-1850] elle a pu capturer près de 400000 immigrants. Les départs ont été également fréquents, mais deux fois moins que les arrivées… Des centaines de milliers de vies s’entrecroisent dans l’espace resserré de Rouen» (Bardet, 1983). Dans une province essentiellement agricole, en observant des bourgs et des villes, à quel type d’apparentement allons-nous aboutir? Pourrons-nous comme dans le reste du Dauphiné, mesurer un pool génique urbain? Si comme dans la grande cité de Chartres des «rassemblements» d’urbains sont observés, nous devrions, en confrontant un important groupe d’agglomérations géographiquement rapprochées, constater des réseaux plus ou moins ténus dans lesquels s’effectuent préférentiellement des échanges matrimoniaux: des «isolats» urbains en quelque sorte? Enfin, nous chercherons à déterminer si, comme pour les populations alpines, des variables écosystémiques telles l’altitude et la densité, ont un impact pertinent sur la biodémographie urbaine.
Matériel
Pour saisir aussi correctement que possible ce monde urbain, nous nous appuyions sur un ensemble de 20 villes et bourgs dauphinois. Certes, ce regroupement n’est pas exhaustif, néanmoins il est représentatif du réseau urbain de la plaine comprise entre les «capitales» que sont Grenoble et Lyon. Ce contingentement est principalement dû au fait que certaines sources ne sont pas encore intégrées au programme en cours. Cependant, comme le montrent les données du tableau 1, c’est sur un ensemble de 33787 mariages que porteront les analyses. Précisons aussi que les dates extrêmes s’échelonnent entre 1579 et 1890, mais c’est sur une période couvrant essentiellement les XVII et XVIIIes siècles que les plus gros effectifs seront observés, c’est-à-dire les plus significatifs (Wachter, 1992).
|
|
Dates |
Mariages observés (n.a) |
Altitude (m) |
Superficie (ha) |
Densité (h/km2) |
|
Beaurepaire |
1669-1792 |
1129 |
300 |
1846 |
83 |
Bourgoin
|
1737-1792 |
1196 |
254 |
2437 |
113 |
Crémieu
|
1737-1797 |
904 |
212 |
614 |
270 |
|
Heyrieux |
1737-1791 |
556 |
270 |
1395 |
75 |
La Côte Saint André
|
1579-1792 |
3983 |
376 |
2793 |
108 |
|
La Tour du Pin |
1609-1792 |
808 |
200 |
477 |
206 |
|
Le Grand Lemps |
1641-1792 |
1138 |
478 |
1290 |
71 |
|
Moirans |
1612-1781 |
1285 |
189 |
2006 |
79 |
|
Morestel |
1674-1792 |
858 |
210 |
803 |
354 |
|
Pont de Beauvoisin |
1632-1792 |
2063 |
310 |
736 |
124 |
|
Roybon |
1673-1806 |
1660 |
615 |
6731 |
26 |
|
Saint Chef |
1673-1759 |
940 |
295 |
2716 |
64 |
|
Saint Etienne de Saint Geoirs |
1639-1890 |
2456 |
390 |
1862 |
114 |
|
Saint Jean de Bournay |
1713-1760 |
609 |
369 |
2687 |
50 |
Saint Marcellin
|
1611-1800 |
2508 |
280 |
781 |
170 |
Tullins
|
1601-1792 |
3843 |
223 |
2879 |
103 |
Vinay
|
1683-1792 |
1796 |
250 |
1601 |
151 |
|
Virieu |
1615-1792 |
488 |
406 |
1138 |
163 |
Voiron
|
1642-1792 |
3562 |
290 |
2190 |
239 |
Voreppe
|
1632-1792 |
2005 |
229 |
2865 |
52 |
|
Moyenne arrondie [CV] |
1579-1890 |
|
307 [35] |
1992 [69] |
131 [64] |
Tableau 1. Distribution
de diverses données quantitatives concernant les 20 agglomérations dauphinoises
observées. (celles qui sont soulignées sont qualifiées de villes au XIXe
siècle par Le Mée),
[coefficient de variation: ![]() ].
].
Nous travaillons ici
sur des relevés systématiques1 des actes
de mariage qui ont été informatisés par les membres du Centre Généalogique du
Dauphiné. Ces chercheurs bénévoles ont réalisé un outil remarquable de grande
portée scientifique puisque trois départements alpins font l’objet de
recherches en anthropologie biologique. Les 20 cités choisies l’ont été
majoritairement pour la qualité de leurs archives car les séries de registres
paroissiaux présentent souvent des périodes lacunaires (Le Mée, 1999). Certes,
cette étude se fonde sur un seul type de sources, les unions réalisées au sein
de différentes paroisses dauphinoises sur une période de plusieurs siècles. La
première critique que l’on peut formuler s’adresse à la monovalence
archivistique, en aucun cas les données seront recoupées. Cependant nous
mettons en œuvre des calculs statistiques pour décrire différentes réalités et là,
c’est la dimension quantitative qui prime. Ensuite, il est légitime d’évoquer
le fait que ces relevés aient été réalisés par différentes personnes et
informatisés par d’autres. Il paraît vraisemblable que des erreurs de lecture,
de transcriptions ainsi que d’éventuelles omissions ont pu se produire.
Néanmoins, les généalogistes ont une connaissance «aiguë» des archives et des
lieux qu’ils pratiquent quasi-quotidiennement.
Ces relevés présentent donc de bonnes garanties de fiabilité. D’ailleurs, les
données comportant un doute ou un manque ont été systématiquement rejetées. En
ce qui concerne les patronymes, un long travail de regroupement a été réalisé
car les ecclésiastiques en charge de les transcrire ont eu, en la matière, une
versatilité sans borne. Ainsi, un patronyme peut être inscrit d’une certaine
manière à une génération et d’une autre à la suivante, quand ce n’est pas à
l’intérieur même d’un acte, voire le surnom familial qui est employé en lieu et
place. Enfin, certains problèmes d’aphérèses, d’hypocoristiques ou de
régressions ont été palliés afin de rendre les listes patronymiques valides2 (Dauzat, 1951). Demeuraient d’autres
problèmes, tel celui du contenu des actes quant à l’information sur la
provenance des époux. Pour des travaux d’anthropologie biologique, l’intérêt se
porte principalement sur les lieux de naissance. En définitive, l’écueil le
plus incommode fut celui de l’environnement communautaire durant cette période
historique. Les agglomérations dauphinoises, mais aussi les villages, sont
souvent regroupées en communautés qu’il est mal aisé de discerner. Tel hameau
ou partie de terroir est agrégé ou «démembré» d’un certain ensemble formant une
paroisse et/ou une communauté. Cette variabilité spatiale s’exerce aussi selon
les époques. Il en découle des fluctuations administratives, ecclésiastiques,
seigneuriales, ou autres que nous ne cernons pas toujours précisément. A cet
égard, la cité de Saint-Chef représente un modèle du genre puisqu’elle comprend
en plus ou en moins selon le temps, les hameaux ou annexes de paroisses
d’Arcisses, Chamont, Crucilleux, Laval, Montcarra, Trieux et Vercin. Au
surplus, les archives paroissiales mentionnent d’autres regroupements: Arcisses
s’intègre parfois avec Salagnon et l’ensemble comprend en sus Vignieu. En tout
cas, l’enquête concernant Saint Chef fut particulièrement délicate à réaliser.
Du point de vue de
la statistique, plusieurs distributions du tableau 1 présentent un caractère de
dépendance entre elles. Un test3 du ![]() entre le nombre
de mariages observés et l’altitude d’implantation des cités renvoie un résultat
significatif au seuil de 1%, 2607,780 (p = 0,000, ddl = 19). De même, entre
l’altitude puis successivement la superficie et la densité, les
entre le nombre
de mariages observés et l’altitude d’implantation des cités renvoie un résultat
significatif au seuil de 1%, 2607,780 (p = 0,000, ddl = 19). De même, entre
l’altitude puis successivement la superficie et la densité, les ![]() présentent tous
une dépendance marquée. Respectivement, au seuil de 1%: 1738,149 (p = 0,000,
ddl = 19) et 1053,762 (p = 0,000, ddl = 19). Ainsi, les données de l’écosystème
dans lequel sont implantées les cités dauphinoises paraissent avoir une
importance marquante à la fois à l’égard de la démographie, mais aussi sur la
capacité des bourgeois à s’unir. Ici, V de Cramer montre que le nombre de
mariages observé est lié avec l’altitude, la superficie et la densité par des
liens qualifiés de forts. Respectivement, V = 0,256+++, 0,357+++
et 0,291+++. De même, avec la taille des populations urbaines et les
paramètres de la géographie cités précédemment, le V de Cramer atteint
respectivement: V = 0,194+++, 0,299+++ et 0,158++.
présentent tous
une dépendance marquée. Respectivement, au seuil de 1%: 1738,149 (p = 0,000,
ddl = 19) et 1053,762 (p = 0,000, ddl = 19). Ainsi, les données de l’écosystème
dans lequel sont implantées les cités dauphinoises paraissent avoir une
importance marquante à la fois à l’égard de la démographie, mais aussi sur la
capacité des bourgeois à s’unir. Ici, V de Cramer montre que le nombre de
mariages observé est lié avec l’altitude, la superficie et la densité par des
liens qualifiés de forts. Respectivement, V = 0,256+++, 0,357+++
et 0,291+++. De même, avec la taille des populations urbaines et les
paramètres de la géographie cités précédemment, le V de Cramer atteint
respectivement: V = 0,194+++, 0,299+++ et 0,158++.
Méthodes
Ces populations
urbaines seront étudiées selon les méthodes habituelles de la biodémographie.
Notre approche s’effectuera de façon globale, c’est-à-dire que nous
n’observerons que des populations prises intrinsèquement, les groupes familiaux
et les individus représentant d’autres niveaux d’observation (Sauvain-Dugerdil et
al., 1998). D’emblée, un
cadre dans lequel s’insèrent les populations est défini. Ici les cités sont
assimilées aux paroisses pour lesquelles tout évènement se situant hors de
celle-ci figure «l’étranger». Ainsi, pour le choix du conjoint, les unions
seront comptabilisées comme endogames si, et seulement si, les deux époux sont
effectivement nés dans la paroisse, cette dernière pouvant intégrer un ou
plusieurs hameaux ou villages parfois distants, parfois très proches. Ensuite,
le champ d’investigation sera successivement élargi en examinant les unions
dont l’un au moins des époux provient:
- des autres cités
du corpus.
- des trois
«capitales» provinciales: Grenoble, Lyon et Chambéry.
- de la montagne
dauphinoise.
- de l’entité
politico-historique que représente la province dans son ensemble.
- de l’étranger, les
frontières considérées alors étant celles de l’Epoque Moderne. Pour cette
dernière partie, bien que le traité d’Utrecht occulte en 1713 une partie du
Briançonnais, les populations de ces vallées piémontaises ont été considérées
comme dauphinoises.
Aux moyens d’autres
méthodes issues, en particulier de la génétique de population, nous nous
intéresserons à différents critères tels celui mesurant le choix du conjoint ou
bien encore celui concernant le degré d’apparentement des époux (Jacquard,
1970). En procédant à des tests statistiques, nous pouvons déterminer
l’existence ou non du choix du conjoint par comparaison avec un modèle
théorique, la panmixie, où
les unions se font exclusivement au hasard (Fernet et al., 1975). A l’aide des patronymes, des
chercheurs ont mis au point un moyen estimant l’apparentement des unions et la
consanguinité des personnes qui en descendent (Crow et al., 1965; Lasker, 1977; Crow, 1983).
L’isonymie, bien que soumise à d’importants préalables, établit que des couples
portant un même patronyme ont une ascendance commune à plus ou moins brève
échéance, c’est-à-dire qu’ils sont apparentés. Nous utilisons couramment ce
procédé qui s’avère gratifiant, puisqu’en l’absence de réseaux généalogiques,
il est capable de rendre compte au mieux de la réalité (Boëtsch et al., 2001; Prost et al., 2002). Néanmoins, s’agissant d’une approche
biodémographique, le processus méthodologique ne sera pas employé complètement,
ce ne sera qu’une évaluation portant sur les 20 populations. Les noms de
famille serviront aussi à estimer un indice de diversité [Idp].
Calqué sur celui des espèces (Odum, 1953) il indiquera si, en examinant ces
localités, nous sommes proches du monde urbain ou du monde rural. Construit
comme le rapport du nombre de patronymes différents rencontrés dans un
groupement sur le logarithme de la population moyenne [ce dernier pondérant les
écarts parfois importants des diverses populations], l’Idp permet
d’obtenir une «hiérarchisation» convenable de la diversité biologique. Pour
sophistiquées qu’elles soient, ces méthodes quantitatives appliquées aux
sciences de l’homme, permettent de cerner presque aisément une population,
jusque dans sa structure la plus fine, c’est-à-dire celle de la connaissance du
pool génique. Cependant,
il est nécessaire qu’au préalable nous ayons défini les «barrières» qui
contingentent le ou les groupement(s) humain(s) observés. Dans le cas présent,
les entités populationnelles s’inscrivent dans un cercle d’unions représenté
par une paroisse; elles ont été choisies selon deux critères très précis: leur
appartenance au semis urbain et leur situation topographique dans la plaine
entre deux «capitales» importantes. En dernier lieu, tout au long de l’étude,
des comparaisons seront conduites avec:
- le monde rural
dauphinois représenté par des paroisses des Terres Froides, des Basses Terres et du Plateau de Crémieu qui ceint ces agglomérations.
- des paroisses
d’altitude de l’Oisans et des Hautes-Alpes (Prost, Boëtsch, 2001 et 2002).
Résultats et discussion
Les données
informatiques brutes issues des dépouillements ayant été compilées dans des
fichiers idoines, elles ont été triées et filtrées selon les prescriptions
indiquées précédemment.
1.Choix du
conjoint et échanges matrimoniaux
Le tableau 2
regroupe un ensemble de données démographiques et des fréquences concernant les
20 agglomérations. La première colonne indique la population moyenne. Ces
quantités sont obtenues en effectuant la moyenne arithmétique arrondie de
données prises respectivement aux XVII et XVIIIes siècles4. Ainsi, c’est sur plus de 40000 personnes
que porte cette étude. Si nous rapportons ce nombre aux 543585 Dauphinois
recensés en 1698 (Dupâquier et al., 1985), la proportion obtenue s’établit à 7,5%. Par contraste, si nous
comparons le nombre moyen de résidents bourgeois à celui des communautés
rurales d’alentours, le différentiel demeure conséquent, 2030 contre 555 soit
un rapport de 3,7 (Prost et al., 2003). De prime abord, il s’agit bien de structures citadines pour
lesquelles la population en place se différencie démographiquement des villages
environnants. Néanmoins, cette moyenne de 2030 personnes occulte d’importantes
disparités. Voiron, très grosse cité accueille 5,7 fois plus d’individus que
son homologue septentrionale Pont de Beauvoisin. Cette diversité démographique
va sans doute permettre d’observer toute une palette de comportements
matrimoniaux.
|
|
Population |
Endogamie 1 |
Endogamie 2 |
Bourg |
Ville |
Montagne |
Etranger |
|
Beaurepaire |
1540 |
46,4 |
97,6 |
4,2 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Bourgoin |
2750 |
59,3 |
95,5 |
2,8 |
1,6 |
3,6 |
0,1 |
|
Crémieu |
1704 |
69,5 |
91,4 |
1,9 |
0,6 |
0,1 |
0,1 |
|
Heyrieux |
1040 |
66,0 |
94,8 |
0,7 |
1,6 |
0,4 |
0,2 |
|
La Côte Saint André |
3020 |
63,1 |
97,3 |
2,5 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
|
La Tour du Pin |
980 |
50,8 |
98,1 |
3,7 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
|
Le Grand Lemps |
1153 |
67,8 |
99,1 |
3,6 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
Moirans |
1580 |
28,2 |
96,2 |
10,4 |
1,9 |
0,5 |
0,0 |
|
Morestel |
2845 |
52,1 |
95,7 |
2,8 |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
|
Pont de Beauvoisin |
910 |
40,1 |
70,9 |
2,3 |
1,7 |
0,9 |
0,3 |
|
Roybon |
1730 |
62,4 |
98,7 |
1,4 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
|
Saint Chef |
1750 |
56,7 |
98,6 |
3,4 |
0,6 |
0,1 |
0,0 |
|
Saint Etienne de Saint Geoirs |
2130 |
65,8 |
98,4 |
2,7 |
0,6 |
0,0 |
0,1 |
|
Saint Jean de Bournay |
1950 |
59,4 |
98,7 |
2,8 |
0,2 |
0,8 |
0,2 |
|
Saint Marcellin |
1373 |
--- |
--- |
0,7 |
0,2 |
0,0 |
0,1 |
|
Tullins |
2970 |
47,4 |
97,8 |
6,5 |
1,5 |
0,5 |
0,1 |
|
Vinay |
2420 |
71,1 |
98,8 |
2,1 |
1,2 |
0,1 |
0,0 |
|
Virieu |
1634 |
44,6 |
99,8 |
4,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Voiron |
5230 |
43,1 |
96,6 |
5,5 |
1,5 |
0,9 |
0,0 |
|
Voreppe |
1895 |
29,5 |
97,0 |
1,8 |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
|
Moyenne [CV%] |
2030 [49] |
53,6 [37] |
95,8 [7] |
3,30 [67] |
0,85 [68] |
0,5 [158] |
0,11 [100] |
|
|
40604 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tableau 2. Distribution des
différentes fréquences (en %) observées:endogamie et échanges.
Avec
une endogamie moyenne des lieux de naissance (nommée Endogamie 1 dans le tableau 2) qui
s’établit à près de 54%, les bourgs réalisent un résultat légèrement supérieur
à celui examiné dans l’ensemble rural d’alentours: 49,1%. Alors que nous
pouvions nous attendre à une forte exogamie due en partie au tissu
socioéconomique de l’Urbs, c’est le contraire qui prévaut. Il est donc avéré que les
cités dauphinoises, en dépit de commerces et d’un artisanat spécialisé
important, ne sont pas ces lieux d’échanges et de passages où des flux de
population convergent pour se marier. Néanmoins, le résultat comparatif avec
les villages s’inscrit dans la logique car le potentiel mariable, nommé aussi
«effectif efficace» du marché matrimonial urbain offre davantage de choix. Il
n’est pas forcément nécessaire de migrer au-delà de la paroisse pour s’unir
comme il est habituellement constaté dans les communautés rurales et comme
c’est le cas ailleurs en France (Lebrun, 1985; Dupâquier et al., 1988). En outre,
l’éventail professionnel et sociologique est tel dans la cité que la
probabilité de réaliser une union homogamique s’en trouve fortement accrue.
Ainsi, en dépit d’un brassage forcément supérieur à celui que l’on rencontre
dans les campagnes isolées, nous vérifions que dans le sud-est, les bourgeois
sont plus endogames que les ruraux. En tout cas, le monde urbain de la plaine
s’inscrit dans le concept d’aire «fermée» avec une endogamie supérieure à 50%
(Sevin et al., 1991). Le fait que cette mesure s’effectue sur une longue période et
que le coefficient de variation s’établisse à 37, suggère que nous avons
affaire à un comportement matrimonial relativement homogène qui perdure. Aux
extrêmes, Crémieu et Le Grand Lemps, mais aussi Saint Etienne de Saint Geoirs,
Heyrieux, Roybon et surtout Vinay, avec des taux compris dans une fourchette
60-71%, se comportent comme des populations nettement plus fermées, analogues à
celles de l’Arc alpin (Prost et al., 2001). A l’inverse, Moirans représente une
anomie. Son faible taux de 28% d’endogamie démontre que, dans cette
agglomération, le choix du conjoint s’effectue au-delà du cadre paroissial,
principalement dans la paroisse mitoyenne de Saint Jean de Moirans. Dans une
moindre mesure, Voreppe qui ne réunit que 29,5% d’unions entre autochtones,
échange davantage avec des communes plus éloignées. Ainsi, si nous avions
choisi comme cercle des mariages le cadre communautaire ou celui du mandement,
nous aurions capté des taux très importants.
Avec
la «barrière» figurée par les frontières provinciales (Endogamie 2), nous avons voulu mesurer
la perméabilité des villes à l’égard des autres provinces françaises et même
d’autres pays étrangers. Le Dauphiné, province frontière du sud-est, est soumis
aux flux migratoires, aux passages commerciaux et aux nombreuses et incessantes
allées et venues des troupes. Pour autant ces multiples circulations
affecteront-elles les marchés matrimoniaux? Certes non. Avec près de 96%
d’unions endogames entre deux bourgeois de souche, l’urbanité se révèle comme
particulièrement close aux échanges de toutes origines. Pourtant, les
économistes décrivent les échanges commerciaux, ils sont importants (Dubois,
1933; Léon, 1954). Puis ce sont les historiens; ceux-ci montrent son importance
stratégique et les flux continuels de la soldatesque au cours des XVIe -
XVIIIe siècles (Bligny et al., 1973). Seulement, l’analyse des
marchés matrimoniaux in situ ne renvoie, sur une période pluriséculaire, aucunement de
désordres, de désorganisations ou de changements. Les urbains s’unissent entre
eux dans une fourchette comprise entre 91-99% avec un coefficient de variation
très faible de 7. De ce fait, c’est pratiquement la fermeture génétique totale
qui prévaut. Seule la ville de Pont de Beauvoisin et sa position frontalière
dénote avec une endogamie dauphinoise en retrait de 25%. Spécifions toutefois
que, dans la base de données informatisée, les époux sont dits quelquefois de «Pont»
ou de «Pont Savoie». Parfois encore les unions se sont effectuées au couvent
des Carmes, l’intégrité paroissiale n’est ici pas forcément respectée. Quant à
Saint Marcellin, les informations sur la provenance des époux sont trop
«sporadiques» pour que la statistique soit pertinente. Comme pour l’écosystème
rural, l’urbain admet une dépendance marquée entre la taille d’une population
et les fréquences de l’endogamie. Ainsi, le ![]() appliqué sur les
différentes distributions admet des résultats significatifs. Avec l’endogamie
de paroisse, on recueille, au seuil de 1%, 257,721 (ddl = 18, p = 0,000); avec
celle de province: 313,383 (ddl = 18, p = 0,000). De même, entre les données
des deux taux d’endogamie, on atteint un seuil de signification,
appliqué sur les
différentes distributions admet des résultats significatifs. Avec l’endogamie
de paroisse, on recueille, au seuil de 1%, 257,721 (ddl = 18, p = 0,000); avec
celle de province: 313,383 (ddl = 18, p = 0,000). De même, entre les données
des deux taux d’endogamie, on atteint un seuil de signification, ![]() = 36,033 (ddl = 18, p = 0,007). Par contre, aucune
corrélation significative aux seuils de 5% n’a pu être établie entre la
distribution de l’endogamie paroissiale et provincial r = 0,226, p = 0,176. Le
V de Cramer indique que des liens faibles s’établissent entre la quantité
moyenne de population observée et les deux niveaux d’endogamie. Respectivement,
V = 0,080+ et V = 0,087+. Quant à la liaison entre les
deux fréquences endogamiques, la statistique ne renvoie qu’un lien faible, V =
0,113+.
= 36,033 (ddl = 18, p = 0,007). Par contre, aucune
corrélation significative aux seuils de 5% n’a pu être établie entre la
distribution de l’endogamie paroissiale et provincial r = 0,226, p = 0,176. Le
V de Cramer indique que des liens faibles s’établissent entre la quantité
moyenne de population observée et les deux niveaux d’endogamie. Respectivement,
V = 0,080+ et V = 0,087+. Quant à la liaison entre les
deux fréquences endogamiques, la statistique ne renvoie qu’un lien faible, V =
0,113+.
Mais quelle est la
situation dans les autres villes du royaume?
Au vu des données du tableau 3, en dépit de la variété dans l’ampleur démographique des cités observées, nous retrouvons grosso-modo les pourcentages dauphinois, 45 - 68% dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mais d’autres informations viennent corroborer cette constatation: «A Rouen, entre 1700 et 1793, un peu plus de la moitié des maris sont nés hors de la ville. Cela semble être la norme pour les grandes capitales régionales françaises de cette époque, Bordeaux exceptée où le pourcentage est nettement plus bas (32,6%, maris et femmes confondus)» (Dupâquier et al., 1988). Tentons d’approfondir la connaissance du comportement matrimonial bourgeois. Pour cela, différentes fréquences concernant les échanges avec d’autres structures sont établies. D’abord, il s’agit de savoir si, en tant qu’urbain, on cherche son conjoint dans un bourg voisin, en l’occurrence, un des 20 répertoriés dans l’étude. Là encore, la réponse est négative, même si ces échanges atteignent 10% à Moirans ou encore 6,5% à Tullins. En moyenne, ils n’excèdent pas 4% ce qui demeure très bas pour des localités souvent proches, voire adjacentes ou situées dans un périmètre géographiquement restreint. Ces faibles proportions témoignent de la non existence, dans cette province, de réseau ou de trame urbaine dans laquelle se produiraient des échanges matrimoniaux préférentiels.
|
|
Période |
Endogamie (moyennes arrondies) |
|
Angers (Lebrun, 1985) |
1741-1745 |
68 |
|
Beauvais (Goubert, 1982) |
1771-1790 |
de 56 à 89 selon les paroisses |
|
Bourg en Bresse (Turrel, 1986) |
1551-1553 et 1785-1799 |
35 et 44 |
|
Chartres (Vovelle, 1980) |
1780-1799 |
62 |
|
Lyon (Garden, 1975) |
1728-1730 et 1786-1788 |
57 et 45 |
|
Meulan (Lachiver, 1969) |
1690-1869 |
46 |
Tableau 3. Taux d’endogamie (en %) observés dans différentes agglomérations
françaises (XVIe – XIXe siècles).
A l’égard des grands centres urbains du sud-est, l’attirance est pratiquement négligeable, à peine 0,9% de l’ensemble bourgeois. C’est Grenoble avec 197 individus des deux sexes qui présente une propension supérieure aux échanges nuptiaux. Puis Lyon avec 85 personnes et enfin Chambéry avec moins d’une vingtaine. En tout, moins de 300 urbains s’unissent à des bourgeois pour les 33787 couples répertoriés. Néanmoins, ici, un seul flux migratoire est appréhendé, celui qui concerne la migration matrimoniale entre un ou une autochtone et une personne de ces trois grandes villes. Il est certain qu’en observant les paroisses de ces dernières, de forts contingents devraient être recueillis. Ainsi, à Lyon, le recensement de 1597 fait ressortir 7,2% de dauphinois parmi les chefs de feu, et les provenances connues les plus fréquentes mentionnent bien les cités étudiées: Crémieu, La Tour du Pin, La Côte Saint André, etc. (Zeller, 1983).
Quant aux échanges avec la montagne dauphinoise, le constat est clair: les deux mondes s’ignorent quasiment. Certes, la dichotomie Haut et Bas Dauphiné est connue, mais ici nous en mesurons l’impact au niveau du choix du conjoint: 0,5%. La proportion atteint moins de 1% à Voiron qui est pourtant une ville fort industrieuse. Seule Bourgoin se singularise avec presque 4%. Pourtant, si les habitants du Haut ne méconnaissent pas la plaine, la réciproque est fausse. En effet, les gens du Bas n’ont qu’une très faible mobilité en regard de leurs homologues d’altitude qui, eux, migrent quasi constamment (Léon, 1954; Prost, 2002 et 2003). Ils vont peigner le chanvre, peindre des indiennes, «trafficquer», c’est-à-dire exercer un quelconque commerce, mais aussi régenter les petites écoles ou encore travailler chez un oncle ou un cousin installé comme ecclésiastique (Prost, 2002, 2003a et b). Seulement, rares sont ceux qui migrent viagèrement en plaine et plus rares encore sont ceux qui s’y marient. Quant à s’y reproduire les occurrences restent exceptionnelles. A coup sûr, le marché matrimonial dauphinois paraît particulièrement saturé et qui plus est, très encadré, dans ce pays de droit écrit où «l’usage est de faire autant d’héritiers qu’un père a d’enfants» [ADI 2C326 (année 1699) volume 17, page: 88]. En tout cas, ayant étudié de très près les Briançonnais établis en Bas Dauphiné [reconstitution des familles, élaboration des généalogies, etc.], nous avons constaté que pratiquement aucune famille n’a pu perdurer au-delà de 3 générations, quand elles ont pu se reproduire (Prost et al., 2003). Les quelques montagnards formant moins de 1% du corpus qui «se risquent» à se marier dans les cités de la plaine, sont souvent des personnes avec un statut de marchand ou de négociant, ce sont rarement des artisans. Ils s’unissent fréquemment à des veuves ou à des femmes d’un certain âge. Cet état de fait fera que leur descendance ne sera pas forcément assurée. Mais l’envisageait-il?
Tout aussi intéressants sont leurs lieux de provenance. La migration viagère du Haut vers les villes du Bas s’exerce par filières, sporadiquement. Ce n’est jamais une immigration de masse, de couples ou de familles comme au Moyen-Age. Ici, ce sont principalement des hommes: 23 proviennent du diocèse d’Embrun, 22 de la région d’Allevard, 32 de l’Oisans, 42 du diocèse de Gap et quelques dizaines de Valbonnais, du Trièves, de la Mure, de Vizille, etc. Pour les habitants du mandement de l’Oisans, seules 11 paroisses sur 20 sont pourvoyeuses et Bourg d’Oisans procure 13 migrants définitifs dans les agglomérations de la plaine. A Pont de Beauvoisin, ce sont des hommes de Saint Maurice en Valgodemard au diocèse de Gap qui s’établissent successivement. Sur une période de 20 ans ils sont 3 à se marier, tandis qu’un mariage inverse, sans descendance, est repéré à la même période à Saint Maurice.
En définitive, les échanges transfrontaliers demeurent rares, voire inexistants pour 7 des 20 villes. De ce fait, le bourgeois de la plaine à un «horizon matrimonial» passablement restreint, se contingentant d’abord à sa propre cité, 5 mariages sur 10, puis secondairement aux communautés rurales circumvoisines.
Après avoir observé l’organisation spatiale du marché matrimonial, intéressons-nous à sa structure.
Le tableau 4
synthétise les données émanant de la statistique. La première colonne rappelle
la distribution, par agglomérations, des fréquences endogamiques établies au
moyen des relevés. Des matrices 2x2 ont été élaborées décrivant les quatre
situations possibles du choix géographique du conjoint: les deux époux sont nés
dans la paroisse, l’époux est autochtone, l’épouse non, etc. Les fréquences de
la colonne deux proviennent d’un calcul statistique réalisé au moyen des
données précédentes, il s’agit d’un artefact. Ces
dernières indiquent très précisément l’endogamie «attendue», celle
hypothétique, que nous recueillerions si les couples bourgeois s’unissaient au
hasard, sans qu’aucun critère de choix et d’homogamie entre en jeu, c’est le
régime de la panmixie. Dans ce modèle panmictique,
les couples urbains réunissent 5,5% d’endogamie, mais le coefficient de
variation de 109% désigne une forte hétérogénéité de comportements. C’est à
Moirans, Voreppe et à la Côte Saint André que les plus forts taux sont observés,
respectivement 21, 15 et 13%. Par différence entre la mesure réelle et celle
attendue, on détermine une fréquence plus ou moins importante expliquant la
capacité des hommes et des femmes à se choisir. En effectuant sur les deux
matrices [réelle et attendue] un test d’indépendance du ![]() , un index d’homogamie géographique
, un index d’homogamie géographique ![]() est obtenu.
Alors que 53,6% d’endogamie paroissiale fut réellement mesurée, le même
potentiel d’hommes et de femmes se mariant «au hasard» générerait presque 6%
d’endogamie. La différence aboutit à 48,1%. Ceci suggère que le choix du
conjoint, basée sur la proximité géographique, est une dimension relativement
importante du mariage bourgeois. Quant à l’index d’homogamie, évalué en moyenne
à 24%, il présente une variabilité considérable [CV = 138, ratio maximum 93].
Il révèle en outre l’attitude culturelle du comportement matrimonial des
urbains. Selon les taux indiqués, le choix prend un caractère systématique, on
préfère s’unir dans sa propre cité. C’est le cas spécialement à Saint Jean de
Bournay, Le Grand Lemps et Vinay où la proportion dépasse 90%. Par contre, à la
Côte Saint André, à Pont de Beauvoisin et à Voreppe, c’est la situation inverse
qui prévaut. Ces paramètres statistiques décrivent les 20 cités comme fortement
hétérogènes en matière de marchés matrimoniaux. Ceci malgré une distance
géographique ne dépassant jamais 55 km, d’une typologie structurelle analogue
et d’attitudes socioculturelles liées à l’appartenance à une même province.
Autour de ces agglomérations, les milliers d’unions recensées dans 15 paroisses
rurales ont produit une endogamie géographique de 44,5% (Prost et al., 2003). Chez ces ruraux, l’endogamie attendue du modèle panmictique
aboutissait à 5,9% d’où un écart de 38,6% [
est obtenu.
Alors que 53,6% d’endogamie paroissiale fut réellement mesurée, le même
potentiel d’hommes et de femmes se mariant «au hasard» générerait presque 6%
d’endogamie. La différence aboutit à 48,1%. Ceci suggère que le choix du
conjoint, basée sur la proximité géographique, est une dimension relativement
importante du mariage bourgeois. Quant à l’index d’homogamie, évalué en moyenne
à 24%, il présente une variabilité considérable [CV = 138, ratio maximum 93].
Il révèle en outre l’attitude culturelle du comportement matrimonial des
urbains. Selon les taux indiqués, le choix prend un caractère systématique, on
préfère s’unir dans sa propre cité. C’est le cas spécialement à Saint Jean de
Bournay, Le Grand Lemps et Vinay où la proportion dépasse 90%. Par contre, à la
Côte Saint André, à Pont de Beauvoisin et à Voreppe, c’est la situation inverse
qui prévaut. Ces paramètres statistiques décrivent les 20 cités comme fortement
hétérogènes en matière de marchés matrimoniaux. Ceci malgré une distance
géographique ne dépassant jamais 55 km, d’une typologie structurelle analogue
et d’attitudes socioculturelles liées à l’appartenance à une même province.
Autour de ces agglomérations, les milliers d’unions recensées dans 15 paroisses
rurales ont produit une endogamie géographique de 44,5% (Prost et al., 2003). Chez ces ruraux, l’endogamie attendue du modèle panmictique
aboutissait à 5,9% d’où un écart de 38,6% [![]() = 27,8%]. Cette proximité de taux incline à penser qu’en
matière de choix du conjoint nous avons, de part et d’autre, des comportements
fort peu dissemblables. En altitude, à moins de 80km de là à vol d’oiseau, les
unions répertoriées en Oisans à la même époque déterminent respectivement des
taux de 67,6 et 13,6%, produisant un écart de 54% [
= 27,8%]. Cette proximité de taux incline à penser qu’en
matière de choix du conjoint nous avons, de part et d’autre, des comportements
fort peu dissemblables. En altitude, à moins de 80km de là à vol d’oiseau, les
unions répertoriées en Oisans à la même époque déterminent respectivement des
taux de 67,6 et 13,6%, produisant un écart de 54% [![]() = 10,3%]. Au-delà du Lautaret, les communautés des
Hautes-Alpes atteignent des maxima avec des
proportions respectives de 86,5 et 3,6%, soit une différence de 82,9% [
= 10,3%]. Au-delà du Lautaret, les communautés des
Hautes-Alpes atteignent des maxima avec des
proportions respectives de 86,5 et 3,6%, soit une différence de 82,9% [![]() = 26,5%]. En définitive, le Dauphiné présente une
variabilité biodémographique telle qu’il paraît bien difficile de conclure à
une aire culturelle pertinente. Néanmoins, si les agglomérations de la plaine
s’apparient au monde rural qui les environne, celui de la montagne s’en écarte
ouvertement.
= 26,5%]. En définitive, le Dauphiné présente une
variabilité biodémographique telle qu’il paraît bien difficile de conclure à
une aire culturelle pertinente. Néanmoins, si les agglomérations de la plaine
s’apparient au monde rural qui les environne, celui de la montagne s’en écarte
ouvertement.
|
Endogamie: |
observée |
attendue |
Index
d’homogamie |
|
Beaurepaire |
0,525 |
0,0083 |
0,0482 |
|
Bourgoin |
0,593 |
0,0039 |
0,7804 |
|
Crémieu |
0,695 |
0,0640 |
0,0018 |
|
Heyrieux |
0,660 |
0,0320 |
0,3952 |
|
La Côte Saint André |
0,631 |
0,1332 |
0,0000 |
|
La Tour du Pin |
0,508 |
0,0194 |
0,1395 |
|
Le Grand Lemps |
0,678 |
0,0009 |
0,9299 |
|
Moirans |
0,282 |
0,2112 |
0,0000 |
|
Morestel |
0,521 |
0,0344 |
0,0539 |
|
Pont de Beauvoisin |
0,401 |
0,0669 |
0,0000 |
|
Roybon |
0,624 |
0,0252 |
0,0326 |
|
Saint Chef |
0,567 |
0,0455 |
0,0096 |
|
Saint Etienne de Saint Geoirs |
0,658 |
0,0106 |
0,5012 |
|
Saint Jean de Bournay |
0,594 |
0,0007 |
0,9758 |
|
Saint Marcellin |
--- |
--- |
--- |
|
Tullins |
0,474 |
0,0343 |
0,0004 |
|
Vinay |
0,711 |
0,0011 |
0,9292 |
|
Virieu |
0,446 |
0,0564 |
0,0099 |
|
Voiron |
0,431 |
0,0380 |
0,0003 |
|
Voreppe |
0,295 |
0,1476 |
0,0000 |
|
Moyenne [CV%] |
Rappel: 0,536 [37] |
0,0547 [109] |
0,2397 [138] |
Tableau 4. Distribution de
données statistiques concernant le choix du conjoint dans les 20 populations.
2. Patronymes,
biodiversité et apparentement
Examinons à présent les données directement déduites du comptage des patronymes des époux. Deux types d’indices peuvent être mis en avant: l’index de diversité et l’estimation de l’apparentement des couples par la méthode isonymique.
|
|
Patronymes observés [ n.a. ] |
Patronymes différents [ n.a. ] et (%) |
Index de diversité patronymique: Idp. |
Parenté isonymique [ ‰ ] |
|
Beaurepaire |
2099 |
711 (33,9) |
223 |
0,71 |
|
Bourgoin |
2374 |
511 (21,5) |
149 |
1,05 |
|
Crémieu |
1805 |
673 (37,3) |
209 |
0,27 |
|
Heyrieux |
1112 |
316 (28,4) |
105 |
0,45 |
|
La Côte Saint André |
7879 |
1122 (14,2) |
322 |
0,97 |
|
La Tour du Pin |
1610 |
335 (20,8) |
112 |
0,31 |
|
Le Grand Lemps |
2272 |
582 (25,6) |
197 |
2,20 |
|
Moirans |
2567 |
517 (20,1) |
162 |
0,97 |
|
Morestel |
1714 |
347 (20,2) |
101 |
0,88 |
|
Pont de Beauvoisin |
4118 |
1090 (26,5) |
368 |
0,73 |
|
Roybon |
3301 |
529 (16,0) |
163 |
5,64 |
|
Saint Chef |
830 |
237 (28,6) |
73 |
0,80 |
|
Saint Etienne de Saint Geoirs |
5283 |
519 (9,8) |
156 |
2,66 |
|
Saint Jean de Bournay |
1216 |
426 (35,0) |
136 |
1,64 |
|
Saint Marcellin |
4986 |
1424 (28,8) |
456 |
0,80 |
|
Tullins |
7671 |
1046 (13,6) |
301 |
1,63 |
|
Vinay |
3584 |
493 (13,8) |
146 |
2,79 |
|
Virieu |
960 |
269 (28,0) |
82 |
0,75 |
|
Voiron |
7103 |
903 (12,7) |
243 |
1,36 |
|
Voreppe |
3998 |
1061 (26,5) |
334, |
1,50 |
|
Moyenne [CV%] |
3324 [67] / |
656 [52] (23,1) [35] |
202 [52] |
1,41 [87] |
Tableau 5. Données
patronymiques et apparentement isonymique calculé au moyen des noms de famille.
(Les patronymes incertains ou incomplets ont été
supprimés de la base de données).
Le comptage des noms de famille dans un lieu parfaitement circonscrit suggère déjà une évaluation pertinente du degré d’isolement d’une population. Un grand nombre de patronymes reflète une importante diversité biologique. Cependant, le facteur «taille» de la population vient perturber toute comparaison (Rabino-Massa et al., 1976). Pour cela, un index de diversité patronymique [Idp] a été élaboré en transposant aux noms l’indice de diversité des espèces créé par Odum en 1953.
Avec une moyenne de plus de 650 noms de famille différents (cf. tableau 5, 2e colonne), les cités dauphinoises présentent une palette de situations allant de Saint Marcellin à Saint Chef avec un ratio considérable de 6. De même, l’index de diversité rend compte de l’écart entre les mêmes agglomérations, les extrema déterminent alors un rapport légèrement supérieur de 6,2. Cinq d’entre elles se distinguent par un nombre véritablement plus important que la moyenne, au-delà de 300. Ces villes devraient donc enregistrer une forte diversité génétique. En effet, si nous corrélons l’Idp avec les résultats de l’apparentement, nous obtenons r = -0,0773 (R2 = 0,0059) et, si le même travail est effectué avec les 5 villes en question, la corrélation s’établit à r = -0,6781 (R2 = 0,4598). A l’inverse, Morestel, Saint Chef, Virieu, Heyrieux et La Tour du Pin, ont un index qui se rapproche de celui calculé, en moyenne, pour les Basses Terres et qui s'élevait à 95,8. Cette nouvelle similitude donne à penser, qu’en dépit de la taille et de la densité de la population, certains bourgs ont des structures biodémographiques analogues à celles de la ruralité. Malgré ces cas particuliers, l’Idp moyen, globalement situé autour 202, marque bien une différence structurelle entre ville et campagne: 202 contre 96 soit un rapport de 2,1. Le coefficient de variation de l’ensemble, 52%, montre que ces localités n’admettent guère d’unicité en la matière.
Pour aller plus
avant, tentons d’évaluer la consanguinité moyenne de ces populations urbaines.
Quatre méthodes classiques autorisent une évaluation plus ou moins pertinente
de l’apparentement des unions. La consanguinité moyenne C issue des dispenses,
celle dite ![]() de Bernstein
basée sur l’effectif mariable, l’apparentement moyen Fgéné. élaboré aux moyens des réseaux généalogiques et la méthode isonymique
Fiso qui se construit au moyen des
couples portant un patronyme identique (Jacquard, 1970; Bley et al, 1999; Boëtsch et al., 2002). Ici, nous
n’utilisons que la dernière, puisque des données manquent pour mettre en œuvre
les trois autres. Il ne s’agira pourtant que d’une estimation globale. Les
opérations scindant l’évaluation en composantes conjoncturelle et structurelle
réclameraient des calculs considérables. Cette option de travailler sur une
appréciation d’ensemble est aussi régie par le fait que l’isonymie matrimoniale
est soumise à des préalables que nous ne pouvons vérifier. Parmi ceux-ci,
citons: transmission du patronyme par descendance patrilinéaire [exclusion de
toute illégitimité], noms de famille ayant une origine monophylle et présentant
un caractère non ubiquitaire, déséquilibre entre les sexes, etc. (Crognier et
al., 1984; Prost et al.,
2002). A l’origine du calcul de parenté, il est nécessaire de quantifier les
couples de chaque paroisse pour lesquels le même nom est recensé. C’est cette
fréquence qui détermine les prémices de la méthode. L’ensemble des
agglomérations n’admet qu’une très faible propension à s’unir isonymiquement, à
peine 0,6% des couples. Le coefficient de variation de 90% témoigne d’une
variabilité conséquente. Dans les paroisses rurales qui servent de référence,
le taux recueilli est légèrement supérieur à 1% et celui émanant des quinze
paroisses des Basses Terres, est de 0,6%. Sous ce
critère spécifique, en dépit de l’importance considérable du nombre des hommes
—il y a presque quatre fois plus de personnes dans les villes que dans les
villages— et de la diversité patronymique, les bourgeois de la plaine
présentent, une fois encore, des attitudes matrimoniales équivalentes à celles
des ruraux limitrophes. Au contraire, les taux montagnards sont eux particulièrement
élevés. Ils offrent même un gradient croissant avec l’altitude des lieux
d’implantation des villages: 5,4% pour l’Oisans, presque 8% pour les
Hautes-Alpes. Finalement, 16 bourgs admettent des taux semblables, seul Roybon
se détache de l’ensemble en exposant une réelle dissimilarité: 2,3%. Dans une
moindre mesure, Saint Etienne de Saint Geoirs et Vinay avec 1,1% marquent aussi
leur différence. En l’absence de toute étude fine de sociologie, aucune
interprétation pertinente ne peut être avancée pour expliquer ce fort ratio qui s’élève à 18,7 (5,6% contre 0,3%).
de Bernstein
basée sur l’effectif mariable, l’apparentement moyen Fgéné. élaboré aux moyens des réseaux généalogiques et la méthode isonymique
Fiso qui se construit au moyen des
couples portant un patronyme identique (Jacquard, 1970; Bley et al, 1999; Boëtsch et al., 2002). Ici, nous
n’utilisons que la dernière, puisque des données manquent pour mettre en œuvre
les trois autres. Il ne s’agira pourtant que d’une estimation globale. Les
opérations scindant l’évaluation en composantes conjoncturelle et structurelle
réclameraient des calculs considérables. Cette option de travailler sur une
appréciation d’ensemble est aussi régie par le fait que l’isonymie matrimoniale
est soumise à des préalables que nous ne pouvons vérifier. Parmi ceux-ci,
citons: transmission du patronyme par descendance patrilinéaire [exclusion de
toute illégitimité], noms de famille ayant une origine monophylle et présentant
un caractère non ubiquitaire, déséquilibre entre les sexes, etc. (Crognier et
al., 1984; Prost et al.,
2002). A l’origine du calcul de parenté, il est nécessaire de quantifier les
couples de chaque paroisse pour lesquels le même nom est recensé. C’est cette
fréquence qui détermine les prémices de la méthode. L’ensemble des
agglomérations n’admet qu’une très faible propension à s’unir isonymiquement, à
peine 0,6% des couples. Le coefficient de variation de 90% témoigne d’une
variabilité conséquente. Dans les paroisses rurales qui servent de référence,
le taux recueilli est légèrement supérieur à 1% et celui émanant des quinze
paroisses des Basses Terres, est de 0,6%. Sous ce
critère spécifique, en dépit de l’importance considérable du nombre des hommes
—il y a presque quatre fois plus de personnes dans les villes que dans les
villages— et de la diversité patronymique, les bourgeois de la plaine
présentent, une fois encore, des attitudes matrimoniales équivalentes à celles
des ruraux limitrophes. Au contraire, les taux montagnards sont eux particulièrement
élevés. Ils offrent même un gradient croissant avec l’altitude des lieux
d’implantation des villages: 5,4% pour l’Oisans, presque 8% pour les
Hautes-Alpes. Finalement, 16 bourgs admettent des taux semblables, seul Roybon
se détache de l’ensemble en exposant une réelle dissimilarité: 2,3%. Dans une
moindre mesure, Saint Etienne de Saint Geoirs et Vinay avec 1,1% marquent aussi
leur différence. En l’absence de toute étude fine de sociologie, aucune
interprétation pertinente ne peut être avancée pour expliquer ce fort ratio qui s’élève à 18,7 (5,6% contre 0,3%).
De ces fréquences découlent des coefficients de parenté qui décrivent les liens familiaux qu’entretiennent entre elles les familles qui composent les populations. Si les familles ne sont pas apparentées, c’est-à-dire qu’entre les ascendants des époux et des épouses il n’existe pas d’ancêtre(s) commun(s), le coefficient calculé est nul, et les descendants de ces couples ne sont pas consanguins. Dans le cas contraire, un nombre plus ou moins important est obtenu selon le degré de parenté. Concrètement, ce dernier précise la proportion moyenne de gènes identiques que possède en commun une population quelconque (Morissette, 1991; Bouchard et al., 1991). A ce titre, le patrimoine génétique commun de l’ensemble urbain est d’environ 1,4‰. Chez les ruraux , selon la même méthodologie, le taux moyen s’élève à 2,6‰ soit 1,3 fois plus de gènes communs dans les villages que dans les villes. Plus en hauteur, dans la ville de Briançon, la proportion diffère considérablement: 103,6‰, 52 fois plus que dans les localités de la plaine. D’ailleurs la montagne alpine génère l’isolement génétique car pour les Uissans des XVII et XVIIIes siècles, le taux s’élève à 134‰ et dans les Hautes-Alpes, le pool génique moyen atteint 195‰ pour la même période historique. Directement relié par la fréquence isonymique, le coefficient de consanguinité est naturellement important à Roybon. Avec un patrimoine génétique de 5,6‰, cette agglomération d’environ 1730 habitants s’assimile à plusieurs petits villages. Par exemple Châteauvillain dans les Terres Froides qui avec 361 habitants recueille, 7,5‰ de gènes communs. Ou encore Saint Didier d’Aoste au diocèse de Belley qui compte environ 488 habitants et dont le patrimoine génétique moyen s’élève à 5‰. Toutefois, Saint Etienne de Saint Geoirs et même Vinay s’écartent eux aussi de la moyenne en affichant des taux d’environ 2,7‰. Ces proportions semblent, dans ces cas-là, directement corrélées avec les taux d’endogamie qui atteignaient respectivement à 66 et 71%. Mais il s’agit de deux cas particuliers car si nous corrélons globalement l’apparentement et l’endogamie géographique, le résultat reste très modeste: r de Pearson = 0,286 (p = 0,118, non significatif aux seuils de 5%). Dans le contexte urbain, l’isolement géographique n’est pas forcément lié à l’isolement reproductif. Certes, parmi ces structures urbaines, certaines ont des comportements matrimoniaux qui s’apparentent à ceux rencontrés dans la ruralité d’alentours. Mais, par exemple la ville de Voiron avec plus de 5000 résidants et un faible taux d’endogamie (43%) n’est pas exempte de toute consanguinité. Il doit forcément subsister, au sein de cette entité, des groupes familiaux sans doute des familles liées par des intérêts communs, artisans, strates sociales particulières, etc. qui s’unissent préférentiellement au point d’admettre un patrimoine génétique commun de l’ordre de 1,4‰. Ici, nous sommes dans une impasse méthodologique. Pour ce type d’étude, nous avons opté pour une recherche macroscopique capable de rendre compte d’un ensemble important de populations. Nous obtenons au fil de la progression des indices globaux ne permettant d’accéder qu’à des résultantes et des synthèses générales. Il paraît certain qu’en adoptant une approche au niveau familial [mésoscopique, fiche familiale] ou mieux encore au niveau individuel [microscopique, généalogique], nous aurions débouché sur des variables plus précises autorisant des explications d’un autre ordre. Globalement, le V de Cramer appliqué sur les différentes distributions renvoie des coefficients significatifs au seuil de 1%. Ainsi, la diversité patronymique et l’endogamie communale sont reliées par un lien fort, V = 0,234+++. De même, avec l’endogamie provinciale, on obtient un score identique, V = 0,228+++. Par contraste, l’isonymie matrimoniale n’offre, avec les deux niveaux d’endogamie, que des liens moyens, respectivement V = 0,120++ et V = 0,098++. Ce dernier étant même à la limite du lien faible.
3. Ecosystème
et biodémographie
Un dernier point reste à confronter. Est-ce que les populations urbaines, comme leurs homologues rurales et montagnardes, sont, dans leurs attitudes matrimoniales, influencées par les variables de l’écosystème dans lequel elles s’insèrent?
|
|
Altitude et densité |
Population |
Endogamie |
Apparentement: Fiso |
Diversité: Idp |
r de Pearson (p) |
|
Moyenne de l’ensemble |
307m |
2030 |
54,2 |
1,41 |
202 |
--- |
|
Les plus basses |
207 |
2016 |
49,6 |
0,81 |
177 |
0,999 (0,000)* |
|
Les plus hautes |
453 |
1933 |
60,7 |
2,44 |
184 |
0,996 (0,000)* |
|
Ratio |
2,2 |
1,04 |
1,2
|
3,01 |
0,96 |
0,991 (0,000)* |
|
Moyenne de l’ensemble |
131 h/km2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Les moins denses |
53 |
1696 |
55,2 |
2,36 |
181 |
0,999 (0,000)* |
|
Les plus denses |
248 |
2426 |
53,9 |
0,72 |
224 |
0,995 (0,000)* |
|
Ratio |
4,7 |
0,70 |
1,02 |
3,3 |
1,23 |
0,997 (0,000)* |
Tableau 6. Indices
biodémographiques des populations urbaines obtenus selon l’altitude et la
densité extrêmes. *significatif au seuil de 1%
Pour mettre en
évidence un éventuel impact des paramètres écosystémiques sur le marché
matrimonial urbain, cinq villes ont été triées en fonction de leurs extrêmes en
matière d’altitude et de densité (tableau 6). Avec la hauteur d’implantation,
outre un important écart de plus de 11% pour l’endogamie, le ratio le plus probant s’avère être celui de l’apparentement. Les localités
implantées en hauteur, cette dernière étant toute relative, 453m contre 207m,
ont un patrimoine génétique commun trois fois plus important que celles du bas.
Le paramètre altitudinal, même faible puisqu’en dessous de 500m, isole et
participe d’une manière non équivoque à la fermeture génétique des populations.
C’est d’ailleurs cette conclusion qui s’était imposée pour des populations
urbaines positionnées en montagne (Prost et Revol, 2002). La densité quant à
elle n’influence aucunement l’endogamie. Dans l’un et l’autre cas, les
proportions s’inscrivent autour de la moyenne générale. Par contre, une
nouvelle fois, l’apparentement moyen offre une dichotomie marquée et logique,
les agglomérations les moins denses ont un pool
génique trois fois plus important. Ces résultats montrent clairement que
certaines variables de l’écosystème ont un impact direct sur la structure
biodémographique des citadins. Si l’on compare les résultats moyens de la
statistique concernant le V de Cramer pour l’altitude, la densité et la biodémographie
(endogamies 1 et 2, fréquence isonyme et diversité patronymique), la force du
lien qui les relie globalement est évidente. Avec l’altitude et la
biodémographie, Vmoyen = 0,140++, avec la densité, Vmoyen
= 0,288+++. Dans le premier cas c’est un lien moyen, dans le second,
il est qualifié de fort. Par ailleurs, si l’on procède aux mêmes statistiques
mais pour des données concernant les unions entre ruraux de la plaine
dauphinoise, on aboutit à des moyennes analogues (Prost et al., 2003 sous presse). Respectivement Vmoyen = 0,96++
et 0,286+++. Ces dernières moyennes indiquent bien qu’une réelle
similitude existe entre le monde urbain et le monde rural dans la plaine
dauphinoise.
Conclusion
A l’issue de cette
étude, le premier enseignement que nous pouvons mettre en avant s’adresse à la
méthodologie. Nous travaillons ici sur le temps long, la période observée
s’étire sur deux siècles voire plus. Durant cet intervalle, les familles
s’unissent, se reproduisent, perdurent, c’est-à-dire que nous appréhendons
toute la dynamique évolutive et répétitive de la société urbaine. Néanmoins,
nous recueillons que des indices «unitaires» qui représentent, à coup sûr, la
résultante de tout un ensemble de comportements matrimoniaux
multigénérationels: un concentré en quelque sorte, c’est dire si chacun d’eux
peut être pertinent.
Ces populations, celles des villes moyennes et
des bourgs, ont été jusqu’à présent relativement peu étudiées. Souvent prises
entre les deux grands pôles de la recherche que l’on oppose constamment, les
ruraux et les urbains, ces structures «intermédiaires» demeurent difficiles à
saisir. Sont-ce des gros bourgs ou de petites villes? Est-ce qu’une population
agglomérée dépassant une certaine quantité de personnes entre dans cette
catégorie? Bourg, ville, gros bourg, place forte, pseudo-ville, agglomération, cité, localité, voilà
le vocabulaire catégoriel que l’on invoque alors. Certes, en ce qui concerne le
Dauphiné, il s’agit d’entités qui, par leur potentiel d’individus, sont
nettement plus importantes que les groupements d’habitants des alentours. A cet
égard, nous distinguons clairement le monde urbain du monde rural. Les cités de
la plaine, en excluant la dimension intra muros, sont deux fois plus denses et presque quatre fois
plus peuplées que les paroisses rurales adjacentes. En revanche, les multiples
indices qui sont élaborés ici suggèrent de toutes autres considérations:
- Le groupement des
20 localités, géographiquement très proches et appartenant à la même province,
ne présente pas vraiment d’homogénéité flagrante. Au fil des tableaux, nous
n’observons pratiquement que des données anomales, avec des différentiations
parfois très marquées. La meilleure preuve que nous puissions avancer est
d’effectuer la moyenne des coefficients de variation de chaque colonne. Ces
indicateurs construits avec l’écart-type et la moyenne arithmétique rendent
parfaitement compte du phénomène. Les 17 coefficients renvoient une moyenne de
70%: c’est la diversité qui prime. En outre, la corrélation deux à deux de
l’ensemble des données des tableaux 1 à 5 (excepté le tableau 3), aboutit à de
faibles voire médiocres proportions [r = 20,3% et R2 = 6,1%]
corroborant, une fois encore, une hétérogénéité indéniable. Ainsi, l’ensemble
des villes de la plaine ne forme pas une unité populationnelle pertinente.
- Si nous comparons ensuite les données des villes à celles provenant du corpus rural environnant, nous n’aboutissons qu’à des écarts ténus. A ce titre, moins de 5% séparent l’endogamie des villes de celle des champs. Pour le choix du conjoint, l’écart à la panmixie est supérieur d’à peine 9,5% chez les «bourgeois» relativement aux ruraux. Tout se passe comme si nous avions affaire à des localités n’ayant pas vraiment accédé au rang de ville, peut-être des pseudo-villes. Dans la structure génétique même de ces urbains, le coefficient d’apparentement isonymique ne s’écarte que très peu de celui calculé chez les ruraux: respectivement 2,6 contre 1,4‰ quand, en Oisans, celui-ci s’établit à 134‰.
- En ultime analyse,
nous nous rendons compte que, comme toutes les autres structures de cette
province, les agglomérations de la plaine sont fortement dépendantes des
variables de l’écosystème, la densité en particulier jouant un rôle
prépondérant.
En définitive, du seul point de vue de la biodémographie, la véritable scission que nous observons au sein du Dauphiné ne s’exerce pas entre communautés rurales et groupements urbains, mais plutôt entre le Haut et Bas Dauphiné. Nous voyons émerger alors une nouvelle catégorie de structure et pouvons, à coup sûr, rajouter un qualificatif antinomique au titre de l’article: les agglomérations «rurales» de la plaine… (cf. l’annexe statistique in fine).
Bibliographie
Bardet J.P., (1983): Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social. Sedes. Paris. 421 pages.
Bley D. et Boëtsch G., (1999): L’anthropologie démographique. PUF. Paris. 126 p.
Bligny B., (sous la direction – 1973): Histoire du Dauphiné. Privas. Toulouse. 486 p.
Boëtsch G. et Prost M., (2001): Apparentement et ressemblance
patronymique en Dauphiné du XVe au XXe siècle. Le
patronyme, histoire, anthropologie, société. (Darlu et al., eds.). CNRS Editions. Paris. 432 p. pp: 301-317.
Boëtsch
G., Prost M. and Rabino-Massa E., (2002): Evolution of consanguinity in a French
alpine valley: the Vallouise in the Briançon region. (17th -19th
centuries). Human Biology, 74 (2). pp: 285-300.
Bouchard G. et de Braekeleer M., (1991): Histoire d’un Génome. PUQ. Montréal. 599 p.
Crognier E., Bley D. et Boëtsch G. (1984): Mariage en Limousin. Evolution séculaire et identité d’une population rurale. Le canton de Châteauponsac (1870-1979). CNRS. Paris. 144 p.
Crow J. F., (1983): Surnames as
biological markers.
Discussion. Human
Biology. 55, pp: 383-397.
Crow J. P. and Mange A. P., (1965):
Measurement of inbreeding from the frequency of marriages between persons of
the same surname. Eugenics
Quaterly. 12-4. pp: 199-203.
Dauzat A., (1951): Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France. Larousse. Paris. 625 p.
Dubois G., (1933): Une enquête de l'intendant dauphinois Fontanieu:
mémoires généraux sur les productions et le commerce du Dauphiné. Bulletin de la société scientifique du
Dauphiné. Tome LIII. pp: 87-276.
Dupâquier J., (Sous la direction- 1988): Histoire de la population française. 4 tomes. PUF. Paris. 2310 p.
Dupâquier J. et M., (1985): Histoire de la démographie. La statistique de la population des origines à 1914. Perrin. Paris. 462 p.
Fernet P., Jacquard A. et Jakobi L., (1975): Mariages et filiations dans la vallée pyrénéenne de l’Ouzom depuis 1744. Population . Numéro spécial: démographie historique. pp: 187-196.
Garden M., (1975): Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle, Flammarion, Paris, 374 p.
Girard A., (1981): Le choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France. Travaux et Documents. Cahier n°70. PUF-INED. 201 p.
Goubert P., (1982): Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. EHESS. Paris. 653 p.
Jacquard A., (1968): «Panmixie et consanguinité. Quelques précisions de langage». Population. 6. pp: 1065-1090.
Lachiver M., (1969): La population de Meulan du XVIIe au XIXe siècle, SEVPEN, Paris, 339 p.
Lasker G.W., (1977): “A coefficient
of relationship by isonymy. A method for estimating the genetic relationship
between populations”. Human Biology, 49. pp: 489-493.
Lebrun F., (1985): La vie conjugale sous l’Ancien Régime. collection U2. Colin. Paris. 179 p.
Léon P., (1954): La naissance de la grande industrie en Dauphiné (fin XVIIIe-1869). Paris. PUF. 2 volumes. 965 p.
Le Roy Ladurie E., (1985): Les paysans de Languedoc. EHESS. Paris. 745 p.
Odum E. P., (1953): Fundamentals of ecology. W.B. Saunders co. Philadelphia. 574 p.
Morissette J., (1991): «La consanguinité dans la population de Charlevoix (1680-1852)». Histoire d’un génôme. (sous la direction de Bouchard G. et de Braekeleer M.). PUQ. Montréal. pp: 253-277.
Prost M., (2002): «Les divers systèmes migratoires en vigueur dans la montagne alpine et leurs impacts respectifs au niveau socio-économique». Histoire, économie et démographie. Migrations, cycle de vie familiale et marché du travail. (Barjot & Faron eds.). AFHE-Cahier des Annales de Démographie Historique n°3. 572 p. pp: 207-230.
Prost M., (2003): Les Migrations dans les Alpes Occidentales du Moyen
Age au XVIIIe siècle. Dans Permanences et changements dans les
sociétés Alpines, états des lieux, perspectives de recherche (Boëtsch & al.
éds.). Edisud. 260 p.,
pp:73-90.
Prost M., (2003, soumis): «Les ecclésiastiques et leurs familles: étude des structures sociales et des pratiques migratoires en Haut Dauphiné (XVe-XIXe siècles)». Communication du colloque Société de Démographie Historique «Religion et Démographie».
Prost M. et Boëtsch G., (2001): «Choix du conjoint et apparentement dans les populations montagnardes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles». Revue de Géographie Alpine, Tome 89. n°3. pp: 21-40.
Prost M. et Boëtsch G., (2002): «Mobilité et aires matrimoniales dans les populations alpines du Dauphiné: le cas des 20 communautés de l’Oisans du XVII au XIXe siècle», Anthropologica et Praehistorica.113. pp: 121-133.
Prost M., Boëtsch G. et Revol M. (2002), Enfants naissants et enfants utiles. Le cas de la montagne briançonnaise à l’Epoque Moderne, (1600-1809). Cahiers Québécois de Démographie. Volume 31, n°2. pp: 193-213.
Prost M., Boëtsch G. et Revol M., (2003, sous presse),
Choix du conjoint, migrations et distances matrimoniales dans 7 communautés
rurales du Dauphiné au XVIIIe siècle. Cahiers d’histoire. 17 p.
Prost M. et Revol M., (2000), Biodémographie comparée:
le Dauphiné rural, urbain et montagnard à l’époque moderne (XVIIe et
XVIIIe siècles). Cahiers d’histoire. Tome 45. n°3. pp: 391-414.
Prost M. et Revol M., (2002): «Impact de la géographie sur la biodémographie ? Populations urbaines de montagne et de plaine (16e–19e siècle)». Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. Tome 14, nouvelle série. Fascicule 1-2. pp: 27-49.
Rabino-Massa E., Masali M. et Chiarelli B., (1976): «Structure ethnique
et structure génétique d’une population isolée des Alpes occidentales
(Bellino-Blins)». L’étude des isolats. Paris. INED. pp: 323-330.
Sauvain-Dugerdil C. et Richard P., (1998): «Le cercle des unions: une définition dynamique de la population, ou de la pertinence d’une convergence entre l’anthropologie biologique et la démographie historique». Les chemins de la Recherche. n°43. Lyon. pp: 27-45.
Ségalen M. et Jacquard A., (1971): «Choix du conjoint et homogamie». Population. 3. pp: 487-498.
Sevin A. et Boëtsch G., (1991): «L’évolution des structures
biodémographiques dans une population agricole française». Anthropologie et
Préhistoire. 102, pp:
149-161.
Tomassone R., Dervin C. et Masson J.P., (1993) : Biométrie. Modélisation des phénomènes biologiques. Masson. Paris (2e édition). 553 p.
Turrel D., (1986): Bourg en Bresse au 16e siècle. Les hommes et la ville, Bourg en Bresse, 290 p.
Vovelle M., (1980): Ville et campagne au 18e siècle (Chartres et la Beauce). Editions Sociales. Paris. 307 p.
Wachter K.W., (1992): «Variabilité aléatoire des phénomènes démographiques: enseignements des séries paroissiales de Wrigley et Schofield». Modèles de la démographie historique. Congrès et colloques n°11. INED-PUF. Paris. pp: 77-98.
Zeller O., (1983): Le recensement lyonnais de 1597 et 1636. Démographie historique et géographie sociale. PUL. 474 p.
Notes de bas de page
[1] Relevés et informatisation du Centre Généalogique du Dauphiné (CGD), base de données du programme D.A.U.P.H.I.N.E. développé à l’UMR 6578 du CNRS à Marseille.
2 Le taux de mutations patronymiques atteint dans certains cas 15%, parfois dépasse 20%. Ainsi, par exemple, Collomb peut s’orthographier Colomb, Collom, Colom, Colonb, Colhomb, etc.
3 En ce qui concerne le test d’indépendance du ![]() sur les tableaux
de contingence, un test supplémentaire sera indiqué. En effet, plus la valeur
du
sur les tableaux
de contingence, un test supplémentaire sera indiqué. En effet, plus la valeur
du ![]() est élevée, plus
l’évidence contre l’hypothèse nulle est grande. Cependant, «…pour rejeter
une hypothèse nulle, il suffit tout simplement d’avoir un échantillon assez
grand» (Tomassone et al.,
1993). Nous utiliserons donc le V de Cramer,
est élevée, plus
l’évidence contre l’hypothèse nulle est grande. Cependant, «…pour rejeter
une hypothèse nulle, il suffit tout simplement d’avoir un échantillon assez
grand» (Tomassone et al.,
1993). Nous utiliserons donc le V de Cramer, ![]() . C’est une mesure d’association du
. C’est une mesure d’association du ![]() . Il possède certains avantages: il ne dépend pas de
l’effectif total, il atteint son maximum même
lorsque le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes, ce coefficient
est le seul –parmi les tests sur les tableaux de contingence– qui soit normé, maximum
= 1, quelle que soit la dimension de la table de
contingence, il permet encore d’estimer l’intensité du lien entre les variables
testées. V varie dans l’intervalle [0,1]: une valeur proche du 0 indique
l’indépendance, une autre voisine de 1 confirme la dépendance. La «force» du
lien qui relie les données est estimée à partir des limites. De 0,05 à 0,09, le
lien est considéré comme faible (noté +), de 0,09 à 0,18 il est dit
moyen (noté ++), puis de 0,18 à 0,36 c’est un lien fort (noté +++)
et finalement de 0,36 à 1 le lien est très fort (noté ++++).
. Il possède certains avantages: il ne dépend pas de
l’effectif total, il atteint son maximum même
lorsque le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes, ce coefficient
est le seul –parmi les tests sur les tableaux de contingence– qui soit normé, maximum
= 1, quelle que soit la dimension de la table de
contingence, il permet encore d’estimer l’intensité du lien entre les variables
testées. V varie dans l’intervalle [0,1]: une valeur proche du 0 indique
l’indépendance, une autre voisine de 1 confirme la dépendance. La «force» du
lien qui relie les données est estimée à partir des limites. De 0,05 à 0,09, le
lien est considéré comme faible (noté +), de 0,09 à 0,18 il est dit
moyen (noté ++), puis de 0,18 à 0,36 c’est un lien fort (noté +++)
et finalement de 0,36 à 1 le lien est très fort (noté ++++).
4 Manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble: U 439 et U 441 (XVIIe s.), U 908 (1698), U 5210 (vers 1748) et R 765 (1777).
Annexe statistique
V de
Cramer
(ddl = 18 ou 19) |
Altitude |
Densité |
Superficie |
Endo.1 |
Endo.2 |
Mariage |
Population |
Idp |
|
Densité |
0,347+++ |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
Superficie |
0,194+++ |
0,309+++ |
--- |
|
|
|
|
|
|
Endogamie 1 |
0,117++ |
0,294+++ |
0,117++ |
--- |
|
|
|
|
|
Endogamie 2 |
0,135++ |
0,301+++ |
0,133++ |
0,113++ |
--- |
|
|
|
|
Nombre de mariages |
0,256+++ |
0,291+++ |
0,357+++ |
0,128++ |
0,153++ |
--- |
|
|
|
Population |
0,194+++ |
0,158++ |
0,299+++ |
0,080+ |
0,087+ |
0,332+++ |
--- |
|
|
Idp |
0,266+++ |
0,360+++ |
0,243+++ |
0,234+++ |
0,228+++ |
0,130++ |
0,202+++ |
--- |
|
Fiso |
0,039 |
0,196+++ |
0,015 |
0,120 |
0,098++ |
0,027 |
0,025 |
0,086+ |
- Caractéristiques techniques de la classification
ascendante hiérarchique (CAH): pondération uniforme des colonnes, test de
dissimilarité, distance de Manhattan, avec comme critère d’agrégation, le lien
fort. Une partition en 4 classes est obtenue au niveau de la troncature (en
pointillés sur le dendrogramme).
- Sur cet arbre (CAH) qui classifie les agglomérations selon leur dissemblance en fonction des critères étudiés (endogamie paroissiale, endogamie de province, fréquence de l’isonymie, diversité patronymique et quantité de population), on observe d’emblée que l’ensemble se scinde en classes vraiment disproportionnées: la ville de Voiron formant, à elle seule, une partition unique. En réalité, les localités sont biodémographiquement d’autant plus dissemblables que les segments qui les relient sont longs. Ainsi, Bourgoin et La Tour du Pin, qui sont pourtant très proches (géographiquement 15 km environ les séparent), se retrouvent sur cet arbre, quasiment aux extrêmes. De même, les spécialistes de l’histoire urbaine, regroupent habituellement sous l’acception de ville, les cinq localités suivantes: Bourgoin, Crémieu, La Cote Saint André, Pont de Beauvoisin et Voiron. Certes, on remarque que trois d’entre-elles se concentrent en haut du dendrogramme, cependant Crémieu et surtout Pont de Beauvoisin apparaissent comme véritablement différentes et non classables dans le groupe initial. En outre, nous avons introduis parmi les localités du corpus, avec les mêmes critères que ceux cités précédemment, trois paroisses foncièrement rurales à fin de comparaison. Ces trois populations rurales, Corbelin, La Bâtie Montgascon et Chimilin se situent, elles aussi, dans la plaine entre Grenoble et Lyon. Effectivement, deux d’entre-elles figurent «au bas» de l’arbre, à l’opposé de la ville de Voiron. Il y a bien, dans ce cas là, une «distance maximale» entre la ruralité et l’urbanité. Néanmoins, Corbelin, bien qu’appartenant à la même classe hiérarchique, figure à proximité de Tullins et de Pont de Beauvoisin qui sont pourtant des structures urbaines reconnues. Ainsi, ce type de test permet de montrer que «le monde urbain» ne forme pas une entité biodémographique homogène, ceci en dépit d’une appartenance à une même province historique, à un écosystème analogue et à une mitoyenneté géographique certaine.