
Heuzé, Y., Bley, D., Bonnet, D.,
2003, La stature: mesure et perception d’un caractère biologique.
Antropo, 5, 1-8. www.didac.ehu.es/antropo
La
stature : mesure et perception d’un caractère biologique
Height : measurement
and perception of a biological feature
Yann Heuzé1, Daniel Bley2, Dominique
Bonnet3
1Laboratoire d'Anthropologie des populations du passé, UMR 5809 CNRS, Université Bordeaux 1, Bat. B8 1° étage, Avenue des facultés, 33405 Talence cedex, France. E-mail: yannheuze@hotmail.com
2Laboratoire Sociétés, Santé, Développement UMR 5036 CNRS, Université Victor Segalen de Bordeaux 2, case 71, 146 rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux cedex, France
3CPAM de la Gironde, 2-4 rue Robert
Charazac 33000 Bordeaux, France
Mots clés: stature, représentations, adultes,
précarité, France
Key words: height, represantations, adults, precariousness,
France
Résumé
Les résultats que nous présentons proviennent d'une enquête anthropologique sur les mesures et les perceptions de la stature, réalisée au Centre d'Examens de Santé de Bordeaux (Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde). Notre population d'étude est constituée de 150 personnes des deux sexes, âgées de 20 à 60 ans, prises au hasard parmi les consultants du centre. Les mesures de la stature et du poids sont effectuées sur les personnes enquêtées et complétées par des données caractérisant leur état de santé. Un questionnaire (52 items) sur la perception de la stature est posé auprès de chaque personne.
Les aspects étudiés concernent la perception de la stature et les classifications éventuelles qui y sont associées, les avantages et inconvénients physiques et sociaux liés à la stature dans différentes circonstances de la vie quotidienne et leur impact sur la qualité de vie. Ces résultats nous ont permis de discuter du jeu et de la place des représentations dans la définition de l'altérité à partir d'un trait biologique commun.
Abstract
The results
exposed are issue from an anthropological survey about measurements and
perceptions of height, realized in the Centre d'Examens de Santé de
Bordeaux (Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde). The studied
population consist in 150 persons, women and men, between 20 and 60 years,
randomly selected between the patients of the Centre. Height and weight measurements are made on patients and
completed by health information. A questionnaire (52 items) about height
perceptions is submitted to willful.
Height perceptions and linked
possible ranges, physical and social advantages and inconveniences associated with height in the different
daily life situations and their impact on life quality, are studied. These
results give us the possibility to discuss about the part of the
representations in the alterity definition from a common biological feature.
Introduction
La stature (définie comme la taille debout) est l'un des signes distinctifs de tout individu, un des critères couramment utilisé pour connaître ou reconnaître quelqu'un. Ainsi pour décrire une personne, nous faisons souvent référence à sa stature tout autant qu'à la couleur de peau, de cheveux, etc. Le fait que notre stature figure sur notre carte d'identité démontre combien celle-ci est un élément important qui permet de nous distinguer, de nous caractériser en devenant un déterminant de l'identité administrative.
La stature est également un élément important utilisé par les anthropobiologistes pour caractériser les variations du phénotype et son écosensitivité. La stature est un caractère que l'on estime chez les populations du passé à partir de matériel osseux sec, surtout avec les os longs et plus particulièrement avec le fémur (Trotter et Gleser, 1958; Cleuvenot et Houët, 1993), mais qui fait aussi l'objet de nombreuses études sur des populations actuelle comme le montre la rétrospective de Tanner (1999). La plupart examinent les modalités de la croissance en discutant les différents facteurs qui sont à l'origine de notre stature, qui se répartissent communément en deux groupes: les facteurs héréditaires et les facteurs environnementaux comme le niveau socio-économique, l'alimentation, le climat, etc. En revanche, si l'on s'évertue à mesurer la stature des individus, peu de travaux portent sur les perceptions et les représentations de la stature.
Si l'attention portée aujourd'hui au corps dans nos sociétés concerne principalement le poids, on peut imaginer que la stature doit également générer des représentations socioculturelles. C'est ce que nous avons tenté d'examiner à travers cette étude qui a fait l'objet d'un travail universitaire (Heuzé, 2001).
Matériel et méthodes
L'étude s'est déroulée au Centre d'Examens de
Santé de Bordeaux, sous le couvert de la direction de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de la Gironde. Parmi les personnes affiliées au
régime général de l'Assurance Maladie, il existe une
catégorie dite précaire, représentée par les
allocataires du R.M.I., les jeunes assurés de 16-25 ans, les
chômeurs, les personnes sans domicile fixe. Au cours de cette
étude nous utiliserons cette même définition de la
précarité afin d'observer d'éventuelles relations avec
d'autres variables.
Le recrutement de l'échantillon était assuré par l'une
des secrétaires travaillant à l'accueil, sous la forme d'une
proposition accompagnée d'une note d'information sur l'étude et
son caractère anonyme. Ce recrutement s'est fait sur la base du
volontariat, sans distinction de sexe. Les personnes recrutées devaient
appartenir à une classe d'âge allant de 20 à 60 ans inclus.
Nous avons ainsi rencontré 150 personnes, 80 femmes et 70
hommes. Les paramètres relevés sont de deux ordres. Des
données qualitatives recueillies à partir d'un questionnaire de
52 items élaborés à cette fin, et des données
quantitatives obtenues à partir des mesures de la stature et du poids de
chaque sujet, une fois le questionnaire passé. Les niveaux
socio-économiques des individus ont été estimés
à partir de leur catégorie socioprofessionnelle (c.s.p.)
relevée par le centre selon la classification de l'I.N.S.E.E. Le CES
possédant un fichier patient informatisé, il a été
possible de tester la représentativité de la population d'étude
par rapport à la population de référence. Celle-ci est
constituée par la totalité des patients âgés de 20
à 60 ans ayant fréquenté le centre durant le
déroulement de l'étude, ce qui représente 2 634 personnes.
Si nous n'avons pu rencontrer que 150 personnes, cela est notamment lié
au fait que le passage du questionnaire prenait environ 25 minutes. Ceci pose
des problèmes d'effectifs lorsque plusieurs modalités sont prises
en compte. C'est pour cela que nous avons choisi de ne pas utiliser d'analyse
à composante multiple, car les résultats obtenus ne prenaient pas
en compte une variabilité suffisante selon nous.
L'échantillon se compose donc de 150 personnes, 80 femmes dont
17 en situation de précarité et 70 hommes dont 16 en situation de
précarité. La population de référence est elle
composée de 2 634 personnes, 1 239 femmes dont 304 en situation de
précarité et 1 395 hommes dont 254 en situation de
précarité.
Pour ce qui est de la répartition par sexe et du nombre de
personne en situation de précarité, l'échantillon n'est
pas significativement différent de la population de
référence (![]() <0,05). Il n'y a pas de différence significative au niveau des c.s.p. entre
l'échantillon et la population de référence (
<0,05). Il n'y a pas de différence significative au niveau des c.s.p. entre
l'échantillon et la population de référence (![]() <0,05). L’échantillon est légèrement
surreprésenté dans la classe d'âge 25-29 ans, et sous
représenté dans les classes d'âges 45-49 ans et 55-59 ans.
Ce fait peut s’expliquer en partie par une plus grande
disponibilité des plus jeunes.
<0,05). L’échantillon est légèrement
surreprésenté dans la classe d'âge 25-29 ans, et sous
représenté dans les classes d'âges 45-49 ans et 55-59 ans.
Ce fait peut s’expliquer en partie par une plus grande
disponibilité des plus jeunes.
La stature et le poids sont globalement représentés de la
même manière dans l'échantillon et dans la population de
référence (cf.
table 1).
La crainte de rencontrer des gens principalement de petite et/ou de
grande stature ne s'est pas matérialisée.
|
|
Sexe |
Effectif |
Moyenne |
Ecart type |
Minimum |
Maximum |
|
Echantillon |
Femmes |
80 |
160,8 |
7,15 |
145 |
177 |
|
Hommes |
70 |
173,8 |
6,65 |
161 |
188 |
|
|
Population |
Femmes |
1239 |
161,0 |
6,31 |
131 |
184 |
|
Hommes |
1395 |
174,1 |
6,9 |
152 |
196 |
Table 1. Descriptifs des données sur la stature relevées au CES (Tailles en cm)
Table 1. Data from height measured in CES (Height in
cm)
Résultats et discussion
La stature et le poids permettent le calcul d'un indice très
fréquemment utilisé: l'indice de Quetelet ou Body Mass Index (B.M.I.) des anglo-saxons. Le BMI est
égal au poids (kg) divisé par la stature élevée au
carré (![]() ). Roguka et Bielicki (1999), notamment, ont
démontré que dans les pays fortement industrialisés, le
B.M.I. est corrélé négativement avec le niveau
socio-économique. Cela signifie que plus un individu aura un niveau
socio-économique faible, plus il aura tendance à être
"gros". Que ce soit au sein de l'échantillon ou de la
population de référence, nous n'avons pas observé de
corrélation entre le B.M.I. et la catégorie socioprofessionnelle.
Néanmoins en croisant le B.M.I. avec l'indice de précarité
(comme définit ci-dessus), on constate que s'il n'existe pas de
différence significative au niveau du B.M.I. chez les femmes de la
population de référence qu'elles soient en situation de
précarité ou non, il n'en est pas de même chez les hommes
de la population de référence. En effet, les B.M.I. des hommes de
la population de référence en situation de
précarité sont significativement plus faibles que ceux des hommes
non précaires (p<0,05). Ce constat va à l'encontre des
résultats de l'étude précitée. Il serait intéressant
de reproduire cette observation sur un ensemble de patients du CES plus
important afin d'être sûr que cela n'est pas du au hasard. Si ce
résultat persistait, il indiquerait que le niveau
socio-économique agit de manière opposée sur le B.M.I. des
hommes fréquentant le centre que sur celui des hommes des pays fortement
industrialisés.
). Roguka et Bielicki (1999), notamment, ont
démontré que dans les pays fortement industrialisés, le
B.M.I. est corrélé négativement avec le niveau
socio-économique. Cela signifie que plus un individu aura un niveau
socio-économique faible, plus il aura tendance à être
"gros". Que ce soit au sein de l'échantillon ou de la
population de référence, nous n'avons pas observé de
corrélation entre le B.M.I. et la catégorie socioprofessionnelle.
Néanmoins en croisant le B.M.I. avec l'indice de précarité
(comme définit ci-dessus), on constate que s'il n'existe pas de
différence significative au niveau du B.M.I. chez les femmes de la
population de référence qu'elles soient en situation de
précarité ou non, il n'en est pas de même chez les hommes
de la population de référence. En effet, les B.M.I. des hommes de
la population de référence en situation de
précarité sont significativement plus faibles que ceux des hommes
non précaires (p<0,05). Ce constat va à l'encontre des
résultats de l'étude précitée. Il serait intéressant
de reproduire cette observation sur un ensemble de patients du CES plus
important afin d'être sûr que cela n'est pas du au hasard. Si ce
résultat persistait, il indiquerait que le niveau
socio-économique agit de manière opposée sur le B.M.I. des
hommes fréquentant le centre que sur celui des hommes des pays fortement
industrialisés.
De nombreuses études ont mis en évidence une
corrélation positive entre la stature et le niveau
socio-économique (Olivier, 1965; Rona, 1981; Tanner, 1992; Nystöm
Peck et Lundberg, 1995; Cavelaars et al., 2000). Si cette corrélation est effective
pour les hommes de la population de référence (R=0,19),
même si elle est faible, ce n'est pas le cas pour les femmes. Ce
résultat est-il lié à la méthode utilisée
pour apprécier le niveau socio-économique des individus, ou
doit-il être interprété comme le fruit d'une relation moins
forte entre le niveau socio-économique du foyer de l'enfance et la
c.s.p. chez les femmes une fois adulte ? Pour répondre à cette
interrogation il serait nécessaire de faire une enquête sur un
échantillon d'effectif plus important.
Nous nous sommes attachés à savoir si les individus
avaient plutôt des affinités pour certaines statures, petites ou
grandes. Plus de 50 % des personnes interrogées estiment que dans la vie
les "grands" sont avantagés, principalement pour une question
de "prestance", "d'autorité naturelle" et de
"facilité de contact". Trois "avantages" qui se
révèlent intéressants au niveau de la vie sociale et tout
particulièrement dans les activités professionnelles. A
l'inverse, plus de 4 personnes sur 5 estiment que les "petits" ne
sont pas avantagés par leur stature dans la vie. En créant au
sein de l'échantillon trois catégories de: "petits"
(145-159 cm), "moyens"(160-174 cm) et "grands" (175-189
cm), il a été possible d'observer si ces catégories de
stature avaient une influence sur l'écart existant entre la stature
auto-estimée par le sujet et sa stature mesurée
(l’intervalle de chaque catégorie étant définit par
la différence entre les statures minimale et maximale divisée par
trois).
Cette différence [auto-estimation]-[mesure] est en moyenne chez les
femmes de 1,18 cm et chez les hommes de 0,81 cm. Il existe des écarts
significatifs dans cette différence [auto-estimation]-[mesure] selon la
catégorie de stature (p<0,05). Les "petits" ont plus
tendance que les "grands" à surestimer leur stature. Il est
intéressant de noter que l'écart entre l'auto-estimation et la
mesure de la stature n'est pas très important. Le fait que cette
étude se soit déroulée dans un contexte médical n'y
est probablement pas étranger. On constate donc un désir
d'être grand chez la majorité des individus.
Ce rejet des petites statures peut probablement
s'expliquer par différentes hypothèses. Les quelques hypothèses explicatives avancées
ici ne sont en aucune manière exhaustives. Mondiet-Colle et Colle (1989:
79) attribuent par exemple une part de responsabilité de cette tendance
aux mythes fondateurs de l'univers et de l'humanité, où le
gigantisme est le mode de représentation des origines. Nous pourrions
ainsi citer Atlas portant la Terre sur son dos, ou encore le Titan
Prométhée façonnant les Hommes à partir d'argile,
etc. Les derniers de ces géants auraient été Adam et Eve
qui sont décrits comme tels dans la bible. Transgressant l'interdit,
commettant le péché originel, ils paieront leur faute en
n'engendrant que des descendants plus petits qu'eux. Ainsi, dans la
mémoire collective, ou plutôt l'inconscient collectif, la personne
de petite stature serait fautive, ou continuerait à payer les fautes de
ses aïeux.
On peut également trouver une autre
hypothèse dans l'histoire évolutive de l'Homme. Différents
fossiles tels que les Australopithèques, les Paranthropes et
différentes espèces d'Homo indiquent que la stature a augmenté
parallèlement à l'évolution de la lignée humaine
(Garralda et Vandermeersch, 1993). Même si dès le stade Homo
erectus une importante
variation semble se mettre en place avec notamment des individus qui auraient
dépassé 1m80, la majorité des gens gardent à
l'esprit cette image de l'Homme grandissant et se dressant sur ses deux
"pattes" au cours de son évolution. Ainsi les gens de petite
stature apparaîtraient donc comme des personnes moins
évoluées. A l'appui de cet argument, on peut citer l'exemple d'un
groupe Pygmées vivant à proximité d'un village, dont
certains viennent y travailler et qui sont considérés par
certains villageois comme un peuple intermédiaire entre la civilisation
et la nature, se situant entre l'Homme et le singe, une sorte de chaînon
manquant (Abega, 1997).
Le fait qu'une corrélation entre le niveau
socio-économique et la stature ait été
démontrée à de nombreuses occasions renforce ce sentiment,
qui s'exprime notamment dans les différences supposées concernant
les ethnies et les nationalités selon le niveau de développement
économique. On constate que les populations les plus grandes par la
stature sont à 80% associées à des pays occidentaux
(principalement la Scandinavie, les Etats-Unis et l'Allemagne), et seulement
à 20% aux pays d'Afrique noire où l'on trouve pourtant les
populations les plus grandes (Dinka, Massaï, Tutsi).
Un autre élément de réponse
s'inspire de la réflexion d'une femme de petite stature qui analysait:
"ma stature ne m'a pas aidé à grandir". Elle signifiait
par là qu'étant de petite stature, les personnes de son entourage
avaient tendance à la rajeunir et de ce fait, lui apportaient une
attention différente, ne l'ayant pas aidée à
s'émanciper. La petite stature ferait donc référence
à l'enfance et par conséquent rendrait les personnes
"petites" moins responsables, moins capables.
Ce désir d'être "grand" a pour
conséquence d'engendrer une insatisfaction, voir une frustration, chez
les personnes "petites", ou se considérant comme telles. Ainsi
95% des personnes insatisfaites de leur stature le sont parce qu'elles se
considèrent trop petites. 52% des individus "petits" estiment
rencontrer des problèmes dans leur vie quotidienne à cause de
leur stature, qu'ils soient pratiques (ergonomie, accessibilité, etc.)
ou qu'ils concernent l'image corporelle.
Parmi les personnes que nous avons rencontrées, il semble que
les femmes soient plus sensibles que les hommes aux questions de stature. En
effet, une fois leur stature adulte atteinte, elles sont 26,3 % à en
être insatisfaites, pour 10 % des hommes. Cette même question du
degré de satisfaction de sa stature a été posée
pour les périodes de l'enfance et de l'adolescence. Nous avons
été surpris de ne pas constater de différence
significative entre garçons et filles. Par ailleurs, il a
été demandé aux femmes si elles pensaient envisageable de
vivre avec un conjoint plus petit qu'elles, et aux hommes s'ils pensaient
envisageable de vivre avec une conjointe plus grande qu'eux. Il y a une
proportion de femmes (50,6 %) significativement supérieure à
celle des hommes (23,9 %) qui répondent non à la question
posée. 31 % des femmes voient en un conjoint plus petit qu'elles un
homme qui manquerait de virilité et qui aurait du mal à les protéger.
25 % des hommes estiment qu'ils développeraient un complexe
d'infériorité (attention, ces pourcentages sont
réalisés uniquement à partir des réponses
négatives argumentées). Il a également été
demandé aux individus d'estimer leur catégorie de stature
("très petit(e)", "petit(e)", "moyen(ne)",
"grand(e)" ou "très grand(e)"), selon qu'ils se
comparent à leur génération ou à la population
actuelle (cf. figures 1 et
2).
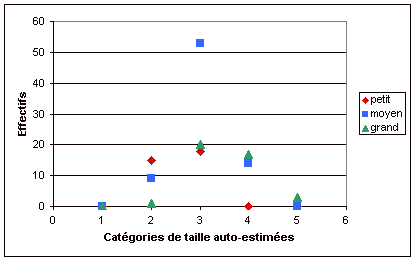
Figure 1. Comparaison des différentes catégories de taille auto-estimées des individus par rapport à leur génération (abscisse) avec leur catégorie de taille réelle (petit, moyen, grand) (tp: très petit, p: petit, m: moyen, g: grand, tg: très grand)
Figure 1. Comparison with individual
different range of auto-estimate height according to their generation (abscissa)
and their real height range (small, medium, tall) (tp : very small, p : small,
m : medium, g: tall, tg : very tall)
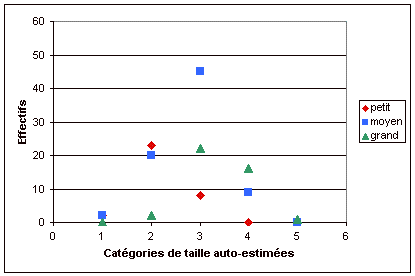
Figure 2. Comparaison des différentes catégories de taille auto-estimées des individus par rapport à la population actuelle (abscisse) avec leur catégorie de taille réelle (petit, moyen, grand) (tp: très petit, p: petit, m: moyen, g: grand, tg: très grand)
Figure 2. Comparison with individual
different range of auto-estimate height according to current population
(abscissa) and their real height range (small, medium, tall) (tp : very small,
p : small, m : medium, g: tall, tg : very tall)
On constate que dans l'ensemble les personnes interrogées ne se sentent pas significativement plus petites par rapport à la population actuelle que par rapport à leur génération, excepté pour les femmes se trouvant "petites". Elles sont en effet deux fois plus nombreuses à se sentir "petites" par rapport à la population actuelle (40 %) que par rapport à leur génération (20 %).
Nous avons été surpris par cette différence entre
les deux sexes au niveau de la perception de la stature. Nous pensions que les
représentations de puissance, de domination auxquelles renvoient les
grandes statures correspondaient plus à des caractéristiques
masculines que féminines, et que ce serait donc chez les hommes que nous
trouverions un plus grand intérêt vis à vis de la stature.
En se remémorant les qualités associées aux grandes
statures: "prestance", "autorité naturelle" et
"facilité de contact" et leur intérêt dans la vie
professionnelle, une hypothèse explicative nous est apparue comme
envisageable. Comme le souligne Le Breton (1990: 162), au même titre que
"les femmes revendiquent le droit à la force en entrant dans les salles de
musculation", ne souhaitent-elles pas posséder les mêmes
atouts que les hommes pour s'imposer dans leur vie sociale ?
S'il apparaît donc clairement que les personnes
interrogées apprécient les grandes statures, il semble
intéressant de savoir ce qu'elles entendent par "grand(e)" et
"petit(e)". Les variables constituées à partir des
réponses à ces questions ne suivant pas la loi normale, les
différentes moyennes ne peuvent pas être comparées entre
elles. Nous avons donc comparé les différences de
répartition de ces variables autour de leur médiane (cf. figure 3).
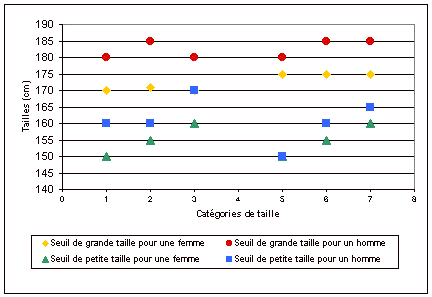
Figure 3. Influence de la stature d'un sujet sur sa perception des grandes et petites tailles.
Figure 3. Person’s height influence on his small
and tall perceptions
On constate ainsi que les seuils de grande stature féminin et
masculin sont globalement appréciés de la même
manière par les femmes et par les hommes, et ce quelque soit leur
catégorie de stature respective. Il en va tout autrement pour les seuils
de petites statures. En effet, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes,
plus l'individu est grand, plus il a tendance à faire des estimations
élevées de ces seuils. Il semble donc que les grandes statures
soient relativement normalisées, tandis que la notion de petite stature
reste beaucoup plus floue.
La stature des gens a-t-elle une influence sur leur
estimation de la stature moyenne des femmes et des hommes âgés de
20 à 60 ans, vivant en France ? Il semblerait que la réponse
à cette question soit négative puisque il n'y a pas de
corrélation significative entre la stature des individus et leurs
estimations de la stature moyenne des femmes et des hommes vivant en France
(p>0,05). Le fait d'être "petit", "moyen" ou
"grand" n'entraîne pas de différence significative dans
ces estimations (p>0,05). Que l'on soit une femme ou un homme, cela
n'engendre pas non plus de différence significative dans ces
estimations. Il semble donc que l'image de la stature moyenne des
français soit partagée globalement de la même
manière par tous.
Les moyennes de ces estimations de la stature des
français sont les suivantes: 165,3 cm pour les femmes et 174,8 cm pour
les hommes. En comparant ces chiffres à ceux de la stature moyenne des
femmes et des hommes de la population de référence, on constate
que pour les hommes ces valeurs sont assez proches: 174,8 cm à partir
des estimations et 174,1 cm pour les hommes de la population. Par contre, pour
les femmes cette différence est importante: 165,3 cm à partir des
estimations et 161,0 cm pour les femmes de la population. Dans les deux cas les
différences se font dans le sens d'une image plus grande que la
réalité. L'importance de cet écart entre l'image de la
stature moyenne des femmes et la réalité donne probablement un
élément d'explication au fait qu'elles se sentent plus petites
qu'elles ne sont. Le référentiel que représente l'image de
la stature moyenne des femmes vivant en France étant bien au-dessus de
la réalité.
Pour terminer, nous avons souhaité comparer les
représentations de la stature à celles du poids au sein de
l'échantillon. En ce qui concerne le taux d'insatisfaction par rapport
à la stature, nous avons vu qu'il penchait fortement en faveur des
femmes (26,3 % contre 10 %). Au niveau du poids, on constate que 60 % des
femmes en sont insatisfaites pour 47 % des hommes. Néanmoins, et
contrairement à la stature, cette différence n'est pas
significative. Plus de la moitié de l'échantillon n'est donc pas
satisfait de son poids, et contrairement à ce que nous attendions, ce
phénomène touche autant les hommes que les femmes. Les
régimes miracles et autres salles de remise en forme ont donc encore de
beaux jours devant eux. Nous retrouvons à travers la manière dont
les personnes de l'échantillon vivent leur poids, et dans une autre
mesure leur stature, l'importance de l'image, et de l'image du corps en
particulier, dans nos sociétés où le sens
prépondérant est de loin celui de la vue. Ces résultats
vont dans le sens de ce que Le Breton décrit ainsi: "les signes
traditionnels du masculin et du féminin tendent à
s'échanger, et à nourrir le thème androgyne qui s'affirme
de plus en plus" (1990: 162).
Conclusion
Cette étude a permis de mettre en évidence deux
résultats principaux. D'une part, la majorité des individus
auraient aimé être plus grands, considérant qu'ainsi leur
vie serait plus facile tant sur le plan pratique que sur le plan social.
D'autre part, cette tendance semble toucher plus particulièrement les
femmes que les hommes. Nous avons également pu constater que la
différence entre [stature auto-estimée] - [stature
mesurée] n'était malgré tout pas si importante que cela,
même si cet écart est en moyenne plus élevé chez les
personnes de petite stature que chez les personnes de grande stature. Le fait
que cette étude se soit déroulée dans un contexte médical
n'y est sûrement pas étranger.
Les gens conscients de ce que la stature et le poids
se différencient fondamentalement par le fait que l'une ne se
contrôle pas quand l'autre peut l'être dans une certaine mesure,
les représentations au sein de la population relatives à ces deux
caractères biologiques ne sont pas les mêmes. Il nous semble
néanmoins que par certains aspects le désir d'être grand se
rapproche de celui d'être mince. Pourtant le premier ne pourra jamais
n'être qu'une source de frustration, sauf à imaginer par exemple,
une évolution de la législation visant la prescription de
traitement à base d'hormones de croissance. Où faudra-t-il alors
placer la limite au-delà de laquelle on versera dans l'eugénisme
?
Face à cette attention croissante portée
au corps et à son image, il serait intéressant que des
études sur les perceptions des dimensions corporelles, autres que celle
du poids, soient menées par des chercheurs dans le cadre d'une approche
bio-culturelle.
Bibliographie
Abega, S.C., 1997, Qualité de vie et
regard de l'autre: les thèmes alimentaires chez les Tikar de Nditam. Prévenir,
33, 189-194.
Cavelaars,
A.E.J.M., Kunst, A.E., Geurts, J.J.M., Crialesi, R., Grotvedt, L., Helmert, U.,
Lahelma, E., Lundberg, O., Mielck, A., Rasmussen, N. Kr., Regidor, E., Spuhler,
Th, Mackenbach, J.P., 2000, Persistent variations in average height between
countries and between socio-economic groups: an overview of 10 European
countries. Ann.
Hum. Biol., 27(4), 407-421.
Cleuvenot,
E., Houët, F, 1993,
Proposition de nouvelles équations d'estimation de stature applicables
pour un sexe indéterminé, et basées sur les
échantillons de Trotter et Gleser. Bull. Mém. Soc. Anthrop. Paris, n.s.,
5, 245-255.
Garralda,
M. D., Vandermeersch, B., 1993, L'évolution
de la stature. Bull. Mém. Soc. Anthrop. Paris, n. s., 5, 269-281.
Heuzé, Y., 2001, La
stature: mesure et perception d'un caractère biologique. Mémoire de DEA d'Anthropologie,
Université Bordeaux 1.
Le Breton, D., 1990,
Anthropologie du corps et modernité (Paris : PUF)
Mondiet-Colle, C., Colle, M.,
1989, Le mythe de Procuste : la stature humaine entre norme et fantasme (Paris : Seuil)
Nystöm
Peck, M., Lundberg, O., 1995, Short stature as an effect of economic and social
conditions in childhood. Social Science and Medicine, 41, 733-738.
Olivier, G., 1965, Anatomie
anthropologique (Paris)
Roguka,
E., Bielicki, T., 1999, Social contrasts in the incidence of obesity among
adult large-city dwellers in Poland in 1986 and 1996. Journal Biosocial
Sciences, 31, 419-423.
Rona,
J.R., 1981, Genetic and environmental factors in the control of growth in
childhood. British Medical Bulletin, 37, 265-272.
Tanner,
J.M., 1992, Growth as a measure of the nutritional and hygienic status of a
population. Hormone Research, 38 (suppl. 1), 106-115.
Tanner,
J.M., 1999, The growth and development of the annals of Human Biology: a 25
years retrospective. Ann. Hum. Biol., 26(1), 3-18.
Trotter,
M., Gleser, G., 1958, A re-evaluation of estimation of stature based on
measurements of stature taken during life and of long bones after death. Am. J. Phys. Anthrop., n.s., 16, 79-124.