
Akpi, E.A., Agbodjavou, M.K., Bedie, V., Kougblenou, O.A., Aïna, A.M., Kpatchavi, C.A., 2021. Rumeurs, attitudes et pratiques sur la vaccination dans un contexte de maladie dite « importée ». Exemple du covid-19 en milieu Adja-Fon au sud-ouest du Bénin. Antropo, 46, 67-82. www.didac.ehu.es/antropo
Rumeurs, attitudes et pratiques sur la vaccination dans un contexte de maladie dite « importée ». Exemple du covid-19 en milieu Adja-Fon au sud-ouest du Bénin
Rumors, attitudes and practices on vaccination in a context of "imported" disease. Example of covid-19 in the Adja-Fon environment in southwestern Benin
Eric Ayédjo Akpi1, Mena Komi Agbodjavou2, Vignon Bedie3, Odile Akonasou Kougblenou4, André Mensah Aïna5, Codjo Adolphe Kpatchavi6
1Unité de Recherche en Anthropologie Médicale Appliquée (URAMA), Institut des Sciences Biomédicales Appliquée (ISBA), Bénin. ericakpi@gmail.com
2Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » (EDP), Université d’Abomey-Calavi (UAC), Unité de Recherche en Anthropologie Médicale Appliquée (URAMA), Institut des Sciences Biomédicales Appliquée (ISBA), Bénin. komimena@outlook.com
3Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin. bedie.vignon@gamail.com
4Ecole Doctorale des sciences de santé (EDSS), Unité de Recherche en Anthropologie Médicale Appliquée (URAMA), Institut des Sciences Biomédicales Appliquée (ISBA), Bénin. akodilas@yahoo.fr
5Université de Liège, Bèlgique. Université de Parakou, Bénin. andremensah.aina@gmail.com
6Département de Sociologie-Anthropologie (DS-A), Faculté des Sciences humaines et sociales (FASHS), Université d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin. kpatchaviadolphe@yahoo.com
Correspondance : Eric Ayédjo Akpi, ericakpi@gmail.com
Mots-clés : Rumeurs, Attitudes et pratiques, Covid-19, Vaccination, Couffo, Bénin
Key-words: Rumors, Attitudes and practices, Covid-19, Vaccination, Couffo, Benin
Résumé
La pandémie de covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé des pays en développement en l’occurrence celui du Bénin. Ses multiples interprétations ont favorisé la circulation des rumeurs qui se sont érigées comme des obstacles au respect des mesures de riposte mises en place pour son éradication. Le présent article a exploré les mécanismes par lesquels ces rumeurs façonnent les attitudes et les pratiques sur la vaccination en période de pandémie en milieu Adja-Fon au Sud-ouest du Bénin.
La méthodologie adoptée a été de nature qualitative et a mobilisé les techniques d’entretien individuel semi-structuré, de focus group et d’observation directe. L’enquête de terrain s’était déroulée du 19 au 23 novembre 2020 dans le département du Couffo auprès de quatre cibles à savoir : 21 agents de santé et relais communautaires impliqués dans les activités de vaccination au niveau des centres de santé d’arrondissement ; 10 femmes enceintes ; 8 mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois ; et 12 pères ou conjoints. Au total 51 personnes ont été enquêtées au moyen de l’échantillonnage par choix raisonné et de boule de neige.
L’enquête ressort qu’en dehors des médias traditionnels, les rumeurs surtout celles relatives aux théories du complot sur le covid-19 ont été propagées à travers les nouveaux médias notamment WhatsApp, Facebook et les proches vivants en villes. Ces rumeurs ont favorisé les attitudes de méfiance des populations vis-à-vis des vaccinations de routine. La perception que le covid-19 était une maladie « importée » amenait les populations à observer des pratiques telles que les rituels en vue de conjurer les « maux », la consommation de sodabi et de sauce à base de noix de palme afin de renforcer leur immunité. En effet, cela avait conduit à la banalisation des gestes barrières aussi bien en communauté qu’à l’intérieur des formations sanitaires. Aussi, les agents de santé et les populations n’étaient-ils pas favorables à l’acceptabilité d’un éventuel vaccin contre le covid-19.
Ce travail constitue une approche empirique exploratoire en vue de traiter l’épineuse question de l’acceptabilité des vaccins anti covid-19 dans les pays du sud.
Abstract
The covid-19 pandemic has put the health systems of developing countries, including Benin, to the test. The multiple interpretations of the pandemic have encouraged the circulation of rumors, which have become obstacles to compliance with the response measures put in place to eradicate it. This article explores the mechanisms by which these rumors shape attitudes and practices regarding vaccination during the pandemic in the Adja-Fon region of southwestern Benin.
The methodology adopted was qualitative in nature and involved semi-structured individual interviews, focus groups and direct observation. The field survey took place from November 19 to 23, 2020 in the department of Couffo with four target groups: 21 health workers and community relays involved in immunization activities in the district health centers; 10 pregnant women; 8 mothers or guardians of children aged 0 to 12 months; and 12 fathers or spouses. A total of 51 people were surveyed using purposive and snowball sampling.
The survey revealed that apart from the traditional media, rumors, especially those related to conspiracy theories about covid-19, were spread through new media, especially WhatsApp, Facebook and relatives living in cities. These rumors have fostered attitudes of distrust among the population towards routine vaccinations. The perception that covid-19 was an "imported" disease led people to observe practices such as rituals to ward off "evils", consumption of sodabi and palm nut sauce to boost their immunity. Indeed, this had led to the trivialization of barrier gestures both in the community and within health facilities. Thus, health workers and the population were not in favor of the acceptability of a possible vaccine against covid-19.
This work constitutes an exploratory empirical approach to address the thorny issue of covid-19 vaccine acceptability in the South.
Introduction
Au-delà des disparités importantes notées dans la propagation du virus et ses ravages entre les pays développés et en voie de développement, la situation de la pandémie préoccupe à plus d’un titre. Il est désormais observé un clivage nord-sud dans la gestion de l’évolution du virus. Tandis que les pays du nord sont pris entre le piège du confinement et du deconfinement répétés, les mutations dangereuses du virus se font partout dans plusieurs endroits du globe. A cela s'ajoutent les défis de vaccination anti covid-19 qui suscitent des débats à tous les niveaux.
Les organisations en charge de la santé des populations, les politiques, et les experts impliqués dans la gestion de la pandémie s’accordent désormais sur le fait que la vaccination universelle constitue la stratégie idéale pour stopper l’évolution du virus afin de briser les chaînes de mutation potentiellement mortelle.
Il est par ailleurs encourageant qu’au début de cette année soit un an environ que le monde est entré en état d’urgence sanitaire, plusieurs vaccins candidats aient reçu l’approbation de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) et de ses partenaires. Un nombre important d'entre eux ont été d’ailleurs produits à grande échelle. Des mécanismes pour assurer la distribution juste et équitable de ces vaccins ont été mis en place notamment le mécanisme COVAX, le premier mécanisme du genre.
La demande de vaccination a diminué pendant le COVID-19 dans les pays où les parents visitent les cliniques ou cabinets pédiatriques privés pour la vaccination. Cela a entraîné une réduction des taux de vaccination, car les parents évitent les visites chez le médecin pour maintenir une distance physique et empêcher les enfants d'être infectés par COVID-19 (Nuzhath et Mahbub, 2020).
L'Afrique demeure en marge dans la campagne de vaccinations contre le Covid-19, avec seulement 2 % des vaccins administrés au niveau mondial. Au Bénin, pour répondre à cette crise sanitaire, un plan de contingence a été adopté, un comité national de crise a été créé pour organiser la surveillance, le dépistage et la prise en charge des cas suspects et confirmés, et des centres d’isolement et de prise en charge ont été installés dans plusieurs régions du pays. Actuellement, une campagne de vaccination de masse est organisée sur toute l’étendue du territoire, mais elle se heurte à de nombreuses réticences et refus. La notion de psychose, relatée par de nombreuses rumeurs, explique que la crainte des mères peut être un frein à la vaccination. Un tel contexte influence inévitablement les attitudes et pratiques des populations ainsi que des agents de santé face à la pandémie et suscitera le développement de diverses stratégies d’adaptation, de sélection ou de contournement des règles établies.
En dehors des problèmes liés à la disponibilité des vaccins et à l’offre des services de vaccination sur le continent, il faut y voir également les réalités sociologiques et anthropologiques à la base de ce faible pourcentage. Le présent travail, en partant de l’hypothèse selon laquelle le vaccin constitue la clé de relance de la santé mondiale dans l’évolution actuelle de la pandémie, ambitionne de proposer à son lecteur une analyse socio-anthropologique des rumeurs répandues sur la maladie, sur son origine et sur sa perception par les communautés Adja-Fon, ainsi que leurs influences sur la vaccination en période de pandémie. Il contribuera à la compréhension des multiples enjeux de santé publique auxquels font face les systèmes de santé des pays en voie de développement dans la gestion de la crise sanitaire inédite.
Matériels et Méthodes
Cadre de recherche
L’enquête a été réalisée dans les communes d’Aplahoue, de Djakotomey, de Dogbo, de Lalo et de Toviklin. La collecte des données s’est faite dans 23 Zones de Dénombrement (ZD) retenues dans le département de Couffo. Les Centres de Santé d’Arrondissement étaient pris comme les bases d’unités administratives.
Le pourcentage des Zones de Dénombrement atteintes était de 70% (soit 16/23) dans le Département du Couffo. Les raisons qui expliquent ce pourcentage sont : d’abord, les consignes de prendre en compte uniquement les Centre de Santé d’Arrondissement avaient conduit par exemple à l’exclusion des centres de santé communaux d’Azové et de Toviklin II ; ensuite, il y a également l’inaccessibilité des villages/quartiers due à l’inondation (Exemple : exclusion de Zountokpa-Codji) ; et enfin, la prise en compte de l’effet de saturation de données. Le tableau 1 présente les ZD investigués.
Au total dans le Couffo, 11 Centres de Santé d’Arrondissement (CSA) ont été visités dans le cadre de la collecte de données. Ces centres desservent au total 16 villages / quartiers.
Echantillonnage et Cibles de l’enquête
L’échantillonnage par choix raisonné et par commodité ont été utilisés pour toucher un grand nombre de cibles que sont : les agents de santé impliqués dans la vaccination au niveau des centres de santé d’arrondissement, relais communautaires, femmes enceintes, mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois, pères ou conjoints.
Les agents de santé et les relais communautaires ont été pris en entretien individuel semi-structurés au niveau des formations sanitaires tandis que les femmes enceintes, mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois, pères ou conjoints ont été pris en focus group au niveau de la communauté.
|
Centre de Santé |
Villages/quartiers (ZD) |
|
Zone sanitaire Aplahoué-Dogbo-Djakotomey |
|
|
CSA Azové
|
Azové |
|
Djimadohoue |
|
|
CSA Betoumey
|
Zohoudji |
|
Houngba |
|
|
Segbehoue |
|
|
CSA Soukouhoue |
Tokpohoue |
|
CSA Dekpo |
Bozinkpe |
|
CSA Madjré |
Madjré |
|
CSA Dévé |
Déve-home |
|
Zone sanitaire Klouékanmè-Toviklin-Lalo |
|
|
CSA Ahodjinnako |
Adonou |
|
CSA Hlassamé
|
Oukanmey |
|
Sowanouhoue |
|
|
CSA Gnizounmé |
Assogbahoue |
|
CSA Houedogli
|
Affomadi |
|
Lagbakada |
|
|
CSA Doko |
Djouganmé |
Tableau 1. Zones de Dénombrement investiguées.
Table 1. Investigated enumeration areas
Techniques de collecte de données
Trois techniques de recherche propres à la recherche qualitative ont permis de collecter les données empiriques. Il s’agit de l’entretien individuel semi-structuré, du focus group et de l’observation directe dans les centres de santé et dans la communauté.
Entretien individuel semi-structuré
Cette technique a été utilisée à l’endroit des agents de santé et relais communautaires impliqués dans les activités de vaccinations au niveau des centres de santé d’arrondissement. Deux agents de santé et un relais communautaire sont pris en entretien par centre de santé. Pour être pris en entretien, il fallait que ces derniers soient en poste avant l’avènement de Covid-19 soit avant le 11 mars 2020. Il s’agit notamment des chefs poste (majors du centre), les aides-soignantes et les relais communautaires qui les appuient dans cette activité. Ces derniers ont été interrogés au sein des formations sanitaires en novembre 2020. La durée moyenne d’un entretien était de 45 minutes. Les entretiens ont porté sur les axes thématiques suivants : informations/communications sur le covid-19 et les activités de vaccination, la connaissance des agents et relais communautaires sur le covid-19, leurs attitudes et pratiques, les effets du covid-19 sur la pratique de la vaccination dans les centres et les stratégies de résilience.
Le tableau 2 présente la répartition des agents de santé y compris les relais communautaires interviewés.
|
Agents de santé |
Femmes |
Hommes |
Total |
|||
|
n |
% |
N |
% |
N |
% |
|
|
Infirmier (es) d’Etat |
4 |
19,1 |
1 |
4,7 |
5 |
23,8 |
|
Infirmier (es) Breveté (es) |
2 |
9,5 |
0 |
0 |
2 |
9,6 |
|
Sage-femme |
4 |
19,1 |
0 |
0 |
4 |
19 |
|
Aide-soignantes |
3 |
14,3 |
2 |
9,5 |
5 |
23,8 |
|
Relais communautaires |
0 |
0 |
5 |
23,8 |
5 |
23,8 |
|
Total |
13 |
62 |
8 |
38 |
21 |
100 |
Tableau 2. Répartition des agents de santé interviewés suivant la fonction et le sexe au cours de l’enquête.
Table 2. Distribution of health workers interviewed by function and gender during the survey.
Entre le 19 et le 23 novembre 2020, 21 agents de santé ont été interviewés dont 19% sont des sages-femmes impliquées dans la vaccination chez les femmes enceintes et 23,8% sont des relais communautaires impliqués dans la vaccination auprès des mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois.
Focus group
Le focus group a été utilisé à l’endroit des femmes enceintes, mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et pères ou conjoints. Il s’agit des commerçants (es), agriculteurs (es) des artisans (es), des conducteurs de taxi et des élèves. Les focus groups ont été constitués par catégorie de sexe avec une taille moyenne de 10 personnes et ont duré en moyenne une heure. Au total 3 focus groups ont été déroulés dans les deux zones sanitaires soit un avec les pères ou conjoints et deux avec des femmes enceintes, mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois. Aussi, il a été pris en compte le critère lié au milieu où ces focus groups devraient se dérouler : pour les femmes enceintes, mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois, un s’était déroulé en milieu urbain (Doko dans Toviklin) et le second en milieu rural (Holou-loko dans Djakotomey). Les entretiens ont porté sur les axes thématiques suivants : information, communication et connaissances des mères /femmes enceintes et pères/conjoints sur covid-19 et la vaccination, leurs attitudes et pratiques, et stratégies de résilience. Le tableau 3 renseigne sur les caractéristiques sociodémographiques des participants au focus group.
|
Participants |
|
Activités socio professionnelles |
Total |
|||||||||
|
Moyenne d’âge |
Commerçant-e |
Agriculteur-trices |
Artisan-e-s |
Conducteurs de taxi |
Elèves |
|
||||||
|
N |
% |
N |
% |
N |
% |
N |
% |
N |
% |
|
||
|
Femmes enceintes |
31, 5 |
2 |
20 |
5 |
50 |
2 |
20 |
0 |
0 |
1 |
10 |
10 |
|
Mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois |
40 |
2 |
25 |
5 |
62,5 |
1 |
12,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
|
Pères ou Conjoints |
37 |
0 |
0 |
4 |
33,3 |
2 |
16,7 |
6 |
50 |
0 |
0 |
12 |
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques des participants au focus group. Groupe sociolinguistique : Adja et Fon.
Table 3. Socio-demographic characteristics of focus group participants. Sociolinguistic group: Adja and Fon.
Au total, 30 personnes ont participé aux focus group. La moyenne d’âge chez les femmes enceintes était de 31 ans et 37 ans chez les pères ou conjoints. 10 femmes enceintes, 8 mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et 12 pères ou conjoints. Chez les femmes (enceintes et mères d’enfants de 0 à 12 mois) l’agriculture était la principale activité, source de revenus (soit respectivement 50% et 62,5%). 50% des pères ou conjoints sont des conducteurs de taxi à 4 roues, à trois roues ou à deux roues.
Observation directe
Cette dernière technique a permis à l’équipe de recherche de documenter l’organisation et la structuration de l’offre de services de vaccination au niveau des formations sanitaires. Elle a consisté à voir la disponibilité des dispositifs de lavage de mains, la disponibilité des équipements de protection contre le Covid-19, ainsi qu’à leur usage pendant les séances de vaccinations. Aussi, a-t-elle consisté à la prise de photo illustrant des comportements des agents de santé, des femmes enceintes, mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et pères ou conjoints au cours des séances de vaccinations notamment le lavage des mains, avant et après la vaccination et le port de masque. L’observation d’interaction directe a été conduite grâce à une grille d’observation et d’appareil photo et a permis de confronter ce que les acteurs disent et ce qu’ils font.
Résultats et analyses
Evolution de la pandémie du Covid-19 en milieu Adja-Fon du Couffo
L’arrivée brutale de covid-19 s’est accompagnée d’une psychose générale avec les premiers messages sur la cause de la maladie, ses modes de transmission et le nombre de décès qu’elle avait déjà fait hors des frontières béninoises. Les populations ont dû composer avec ces premiers éléments d’informations rassemblés sur les réseaux sociaux, auprès de leurs proches résidant en ville et sur les chaînes radio et de télévision. A cette phase, toutes sortes de rumeurs ont renforcé la peur au niveau des populations et des agents de santé et surtout la mise en place des mesures coercitives et disciplinaires instaurées par l’Etat en mars 2020 : établissement du cordon sanitaire, mise en quarantaine systématique par l'État de tout voyageur qui entre sur le territoire par avion ; fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance, fermeture de lieux publics (écoles, universités…), fermeture de commerces ; différentes des mesures libérales faisant appel à la responsabilité individuelle et à l’autodiscipline. Les formations sanitaires publiques étaient donc perçues à ce moment comme des foyers de contamination. Selon les informations recueillies en focus groups (femmes enceintes, mères et gardiennes d’enfants de 0-12 mois et pères et conjoints), 28 personnes sur 30 ont affirmé que la peur d’attraper la maladie avait fait que personne ne voulait allers dans un centre de santé au risque de ramener la maladie dans sa communauté.
Il y a eu ensuite, une courte phase d’adaptation marquée par la levée du cordon sanitaire du 11 mai 2020, la réouverture des lieux publics et l’imposition des gestes barrières (port de masques, lavage régulier des mains, distanciation physique).
Cette deuxième phase sera suivie d’une phase de relâchement du fait que dans ces communautés, il n’y a pas eu des cas de décès au covid-19 ou des cas de contamination en masse. A cette phase, les populations ont une logique « décalée » de celle des agents de santé sur la pandémie. Ils expliquent l’absence de décès ou de cas de contamination de masse de covid-19 par le fait que les africains avaient fini par développer une immunité collective contre la maladie ou encore par le fait que la maladie n’existe pas.
A la date de l’enquête, on pourrait déduire des discours des enquêtés et des observations faites sur sites, qu’une quatrième phase est amorcée et est caractérisée par une méfiance des populations en ce qui concerne les vaccinations. Elle est alimentée par des rumeurs tenues pour vraies par les populations.
Ces logiques guides des pratiques des populations telles que : le non-respect de la distanciation physique et du port des masques même à l’intérieur des formations sanitaires ainsi que le non lavage des mains.
Connaissances sur l’infection au Covid-19
Connaissances des agents de santé et relais communautaires
31,25% (soit 5 sur 16) des agents de santé ont défini avec précision une période d’incubation du virus allant de 21 à 14 jours. Ils sont tous infirmiers diplômés d’Etat et des chefs postes à la date de l’enquête. Deux autres agents de santé (infirmiers brevetés) ont affirmé ne plus se rappeler de la période d’incubation du virus. Les neuf agents de santé restants sont tous des aides-soignantes et ont affirmé qu’elles n’ont aucune idée de cette période. Cependant, 16 sur 16 agents de santé ont connaissance de l’origine de la pandémie, une connaissance sommaire des causes et de ses manifestations par les symptômes (toux, fièvre, respiration difficiles etc.), et les modes de préventions (lavage régulier des mains, port de masque, respect de la distanciation physique).
« Pour reconnaître une personne qui à la maladie à coronavirus, il faut observer si la personne tousse chaque jour, aura mal à la gorge et va commencer par maigrir. Après cela, il faudrait faire le test pour être sûr qu’on est positif ou pas. Ici nous faisons des analyses de Covid-19. C’est par la sage-femme et l’infirmière » (http://aide-soignante.net/, 20/10/2020)
« Comme symptômes du coronavirus, il y a la fatigue, la faiblesse musculaire voire physique et une difficulté respiratoire. Toutes les personnes infectées ne développent pas de la même manière des signes de la maladie. Il y a des sujets qui, leur organisme est faible, donc, ils se développent rapidement. Mais d’autres, leur organisme est assez fort. Eux ils supportent mal. C’est uniquement après le test qu’on peut savoir que, une personne est atteinte ou pas. » (http://aide-soignante.net/, 19/10/2020)
3 sur 5 infirmiers diplômés d’Etat et 1 infirmière brevetée sur 2 ont déclaré posologie à l’appui, chloroquines®, Azithromycine® et vitamine C® comme des médicaments entrant dans le traitement de covid-19. Ces derniers ont été au moins une fois impliqués dans la phase de traitement des cas confirmés de covid-19 dans leur communauté.
Les 2 restants ont affirmé qu’ils ont eu cette information de la part de leur supérieur hiérarchique (médecin chef) à titre informatif.
« Toute information sur le COVID-19 doit être posée à mon chef hiérarchique. Si lui il a des réponses à me donner il me le donne immédiatement. Et s’il n’a pas aussi de réponses, il va chercher. Ils sont les plus informés, car ils font les recyclages. Aussi, les agents du ministère sont-ils passés entre temps pour nous sensibiliser sur l’importance des mesures barrières, comment porter un masque » (http://aide-soignante.net/, 19/11/2020)
15 sur 16 agents de santé (toutes catégories confondues) ont cité les personnes âgées comme les premières personnes à risque d’être plus contaminées par le covid-19, ensuite les « terrains fragiles » (PVVIH, Hyper tendus, asthmatiques, cardiaque) et en dernière position les agents de santé. Le seul agent de santé restant (sage-femme) a cité en première position la catégorie des agents de santé avant de citer la catégorie des « terrains fragiles ». Elle a appuyé cette classification par le fait qu’elle connaît les collègues (à la date de l’enquête) qui en souffrent et qui pour cela sont chez eux.
« Si ça commence pas nous tuer, ça veut dire qu’on [agent de santé] craque déjà. Ça n’a pas encore tué un agent de santé, mais on a présentement des collègues qui sont à la maison parce qu’ils sont dépistés positifs. [...] Il y a des collègues dont je tais leurs noms qui sont dans le milieu [Couffo] et qui sont dépistés positifs et on se connait très bien [...] c’est justement cela qui m’inquiète » (Sage-femme PEV_CSA_Azovè)
En ce qui concerne la contamination chez les enfants, seuls 2 agents de santé (1 IDE et 1 IB) ont affirmé que le covid-19 n’épargne pas les enfants. 3 agents de santé (IDE) ont affirmé que les vaccinations (notamment le BCG) renforcent l’immunité des enfants face au covid-19. Les 10 restants ont affirmé que les enfants ont une immunité naturelle contre covid-19.
« Les personnes les plus à risque d’attraper le Covid-19 sont les personnes âgées. Les petits ne développent pas le mal. Depuis qu’on détecte le mal, je n’ai pas vu d’enfants dépistés positifs au coronavirus. C’est surtout les adultes, les grandes personnes qui en sont atteints » (http://aide-soignante.net/, 19/10/2020)
16 sur 16 pensent qu’une personne qui avait souffert du covi-19 peut être encore contaminée s’il ne respecte pas les gestes barrières. 6 sur 16 agents de santé ont comparé le covid-19 au paludisme pour expliquer le fait que quelqu’un qui a souffert de cette maladie ne peut acquérir une immunité à vie.
Connaissances des femmes enceintes, des mères ou gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et les pères et les conjoints
Les mères, gardiennes d’enfant de 0 à 12 mois et les femmes enceintes avec lesquelles les focus group ont été déroulés n’ont pu donner aucune information précise sur les causes de la maladie.
5 sur 18 ont donné comme mode de transmission « les gouttelettes de salive » et le fait de « se serrer les mains ». Ce qui, selon elles toutes, justifie l’imposition des gestes barrière.
Cependant, les populations nomment le covid-19 à travers des logiques d’interprétation multiples en milieu Adja-Fon du Couffo. En effet, la nomination du Covid-19 par les populations en milieu Adja-Fon se fait en fonction des idées reçues sur la maladie. Il s’agit essentiellement de : l’origine géographique de la maladie, les lieux où elle se propage le mieux, les catégories de personnes les plus touchées, les effets de la maladie sur les relations sociales.
Selon un participant du focus group déroulé avec les pères et les conjoints, le covid-19 est une maladie des chinois du fait de leur penchant pour la consommation des animaux sauvages.
« Ce sont eux qui mangent des insectes ; des trucs bizarres [...] c’est pourquoi ça a quitté chez eux » (participant au focus group pères/conjoints, zohoudji-Bétoumey).
Pour 8 pères et conjoints sur 12 participants au focus group, il s’agit de la maladie de la ville qui ne peut tuer que ceux qui sont « là-bas ».
« Ça ne peut que rester là-bas [...] ça ne peut pas traverser la ville et venir jusqu’ici chez nous.» (Participant au focus group pères/conjoints, zohoudji-Bétoumey).
Par ville, les participants sous-entendent Cotonou, Lomé et Nigéria qui sont des destinations vers lesquelles migrent les jeunes pour des raisons d’emploi.
25 sur 30 participants aux focus group (mères/gardiennes et pères/conjoints) pensent que c’est une maladie pouvant toucher spécifiquement les blancs. En effet, à l’image de la fièvre hémorragique à virus Ebola et Lassa ayant fait des milliers de décès chez les noirs, le covid-19 est spécialement une maladie des blancs.
Enfin, compte tenu des effets des gestes barrières sur les relations interpersonnelles, les populations nomment le covid-19 la « maladie qui fait qu’on ne se salue plus » (Tableau 4)..
|
Appellation de la maladie |
En Adja |
En Fon |
Signification en français |
|
Origine géographique |
tchinùa dɔ |
tchinua zon |
Maladie des chinois |
|
Lieux de propagation |
édjoumè dɔ |
tohomè zon |
Maladie de la ville/du pays |
|
Catégories de personnes touchées |
yovo dɔ |
yovo zon |
Maladie du blanc |
|
Effets sur les relations sociales |
édɔ ina séɔn do do égbé wo |
azɔn dɘ zɔn bɔ é mon sɔ nɔn dogbé nù mè |
La maladie qui fait qu’on ne se salue plus |
Tableau 4. Présentation de la nomination de Covid-19 en milieu Adja-Fon du Couffo.
Table 4. Presentation of the appointment of Covid-19 in the Adja-Fon area of Couffo.
Sources d’informations et de communication sur le Covid-19
Il a été demandé aux agents de santé y compris les relais communautaires quels ont été les canaux d’informations sur le Covid-19, et comment souhaitent-ils avoir plus d’informations sur la maladie. Les résultats à ces questions sont présentés dans le tableau 5 en fonction des statuts / fonction des agents de santé.
|
Acteurs |
Réseaux sociaux |
Voies hiérarchiques |
Médias |
Total |
|||
|
N |
% |
N |
% |
N |
% |
||
|
Infirmiers d’Etat |
2 |
9,5 |
2 |
9,5 |
1 |
4,7 |
5 |
|
Infirmiers Brevetés |
0 |
0 |
1 |
4,7 |
1 |
4,7 |
2 |
|
Sage-femme |
4 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
Aide-soignants (es) |
1 |
4,7 |
3 |
14,3 |
1 |
4,7 |
5 |
|
Relais communautaires |
1 |
4,7 |
4 |
19 |
0 |
0 |
5 |
|
Total |
8 |
38 |
10 |
62 |
3 |
14,3 |
21 |
Tableau 5. Proportions des agents de santé suivant les canaux d’information et de communication.
Table 5. Proportion of health workers by information and communication channel.
Sur 21 agents de santé y compris les relais communautaires ayant répondu à la question, 62% ont répondu avoir eu l’information sur le Covid-19 par la voie hiérarchique.
La proportion des agents de santé qui utilisent la voie hiérarchique comme source d’informations est plus élevée que pour les relais communautaires (19%) et moins élevée que pour les infirmiers d’Etat (9,5%) (Figure 1).
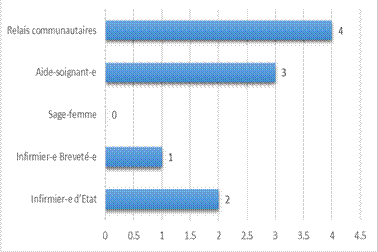
Figure 1. Voie hiérarchique comme source d’information et de communication par agent de santé.
Figure 1. Chain of command as a source of information and communication by health worker.
Les données empiriques sur les canaux d’information chez les femmes enceintes, les mères/gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et pères/conjoints sont restituées dans le tableau 6.
|
Les mères / gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois (milieu rural) |
2/8 mères ou gardienne d’enfants de 0 à 12 mois affirment avoir reçu les informations sur le covid-19 auprès de leurs chefs religieux (Pasteur et Prête Vodou). La moitié aurait pour canaux leurs enfants travaillant en ville (Cotonou, Parakou). Pour toutes informations sur le Covid-19, elles ont indexé le délégué comme personne ressources. |
|
Les femmes enceintes (milieu urbain) |
La majorité (8/10) des femmes enceintes indexent la radio et leur mari ou conjoint comme les canaux par lesquels elles ont prié connaissance des informations sur le Covid-19. Pour toutes informations sur le Covid-19, le Major du centre de santé d’arrondissement (ici CSA Doko) serait le mieux placé pour leur apporté des éclaircissements. |
|
Les pères / conjoints (milieu rural) |
La majorité (11/12) des pères / conjoints ont eu des informations sur la Covid-19 par le biais de la radio, et des réseaux sociaux. Pour toutes autres informations sur la Covid-19, ils estiment que le Chef Village (CV) doit – obligatoirement – être la personne ressource. La principale raison évoquée est que : le Chef village est incontournable dans les communications qui doivent être transmise à la communauté. Toutes communications ne provenant pas du CV et qui concerne la communauté est automatiquement rejetée. |
Tableau 6. Résultats des focus groups sur les canaux d’informations et de communication.
Table 6. Results of focus groups on information and communication channels.
Perception du risque par les catégories enquêtées
Chez les agents de santé et relais communautaires
100% (16 sur 16) des agents, toute catégorie confondue impliquée dans le PEV estiment que le contact physique est un acte privilégié dans la vaccination. Ce qui est contraire aux recommandations dans le cadre de la riposte contre le covid-19. Ils perçoivent le risque de contagiosité dans tous les actes quotidiens associés aux soins, ce qui explique qu’ils se sentent plus à risque d’être touchés par la pandémie.
« Que nous le voulions ou pas, nous, avant de vacciner un enfant ou une mère, tu dois te rapprocher de la dame pour y avoir accès [...] il faut nécessairement se rapprocher de la dame. Le contact n’a jamais été rompu dans la vaccination même avec covid-19. [Donc ce n’est pas possible que dans l’acte de vaccination il n’y ait pas contact ?] Non ce n’est pas possible ce qui augmente le risque d’infection des agents de santé [...] c’est là nos inquiétudes vraiment » (Entretien sage-femme PEV_CSA_Azovè)
« Parce que moi, je suis en contact avec tous les malades, je ne sais pas qui est qui [...] et voilà on ne se contrôle pas dans nos allers et retours, donc ça m’inquiète. Ce qui inquiète le plus, c'est le caractère asymptomatique du virus. Qu’est ce qui prouve que le patient qui vient avec un simple palu n’a pas la maladie ? [...] et si moi je l’attrape, ma petite famille n’est donc pas à l’abri du danger vu que nous sommes encore logés dans le centre donc ça fait peur » (IDE PEV, Sokouhoué)
Une contagiosité pour d’autres groupes de personnes est perçue chez les agents de santé. Pour 16 sur 16 agents de santé les personnes âgées, les « terrains fragiles », les enseignants et les commerçants sont également susceptibles d’être plus contaminés.
« Les agents de santé toute catégorie exerçant pour la santé sont plus à risque d’être contaminés par le covid-19 [...] parce qu’ils sont plus en contact avec la population. Après eux, il y a les enseignants qui sont dans les salles de classes. Les salles de classes sont comme une réunion chaque jour alors qu’ils sont toujours avec les enfants » (Entretien sagefemme PEV_CSA_Azovè).
« Les agents de santé sont les personnes à risque, parce que tout le monde vient vers eux. N’importe quelle maladie on l’amène vers le traitant. Et celui-ci sans le savoir peut être infecté. Mais, il y a aussi les commerçants, qui sont des personnes à risque. Parce qu’il n’y a plus de contrôle dans les maladies. Mais ici au centre de santé, si tu ne portes pas le masque tu ne peux pas faire la consultation » (IDE PEV, Betoumey)
De ce même point de vue, les relais communautaires ont une perception de contagiosité modérée à la date de l’enquête compte tenu des informations qu’ils ont reçues sur la maladie.
« Avec covid [...] aller vers son prochain pour le sensibiliser et le mobiliser nous avait fait peur [...] oui j’ai peur parce que lorsqu’on n’était pas informé sur la maladie, on ne savait pas que rester à distance peut nous éviter la maladie, mais lorsqu’on nous a informé de cela rapidement j’ai compris [...] cela nous a donné le courage de savoir que la maladie ne peut pas nous tuer comme ça» (Entretien relais communautaire _PV CSA Azovè)
De ce fait, ces derniers comparent le covid-19 à la tuberculose de par ses manifestations (signes et symptômes).
Chez les femmes enceintes, les mères/gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et pères/conjoints
Chez cette catégorie, la perception du covid-19 comme la « maladie des blancs » a entraîné une banalisation du risque de contamination même à l’intérieur des formations sanitaires. Notamment le port continuel des masques et le lavage des mains qui ne sont plus respectés (Figure 2).

Figure 2. Vue montrant des femmes enceintes, mères d’enfants et des pères sans masques dans un centre de santé en zone rurale.
Figure 2. View showing pregnant women, mothers of children and fathers without masks in a health center in rural area.
« D’autres femmes disent qu’elles sont étouffées par le masque, ce qui fait que même si on leur exige le port de masque avant de franchir le seuil du centre, après quand elles sont sur les bancs, elles l’enlèvent très vite » (Sage-femme impliquée dans le PEV, Azovè, Novembre 2020)
Cette banalisation s’observe également au niveau de la prévention par dépistage. Pour illustration, il a été mis en place une équipe de dépistage composée d’un médecin chef, d’un major central et d’un technicien de laboratoire, chargée de descendre périodiquement (chaque lundi) dans les centres de santé d’arrondissement pour tester les usagers et agents de santé sur place. Cependant, les usagers adhèrent très peu à cette initiative. Ces derniers estiment que les kits utilisés pour le dépistage viennent « de chez les blancs » ainsi, le fait de les introduire dans leurs narines ou dans leurs bouches pourrait les contaminer. Cette théorie du complot ne saurait être imputée à l’actuelle crise sanitaire. En remontant les perceptions populaires des pandémies en milieu Adja, on se rend compte qu’une maladie qui tue plusieurs personnes à la fois et dans un même espace est un « malheur » qui vient d’ailleurs. Cet « ailleurs » selon les acteurs ne peut qu’être « chez le blanc » qui surement chercherait à « éliminer la race humaine ».
À Azovè par exemple, les usagers des centres de santé n’adhèrent pas aux campagnes de dépistage mises en place par le gouvernement et assurées par l’équipe de la ZS. Ces derniers expliquent leur non adhésion par le fait qu’à l’époque du sida, les préservatifs auraient été contaminés par les blancs et tous ceux qui avaient utilisé ces préservatifs en sont tombés malades ce qui entraîne leur méfiance vis à vis des kits de dépistage de covid-19. Ce faisant, les usagers de cette FOSA ne trouvent pas utile le port de masque pendant les séances de vaccinations des enfants à la maternité.
Les populations se sont appropriées cette rumeur et l’utilisent pour attiser une méfiance excessive à l’égard de toute forme de vaccin en milieu Adja-Fon. Ils la manipulent à travers des interprétations subjectives. Selon 21 sur 21 agents de santé et relais communautaires impliqués dans le programme élargi de vaccination dans le Couffo, les discours selon lesquels « le gouvernement serait en partenariat avec les blancs pour les exterminer par le biais des vaccinations » ont beaucoup influé juste après la levée du cordon sanitaire au Bénin (période du mai et juin).
« Ici à Sokouhoue, les gens ont beaucoup entendu parler de la vaccination liée au Covid-19 qui circulent sur les réseaux sociaux, WhatsApp et quand les gens regardent cela, ils disent que si les gens viennent au Bénin pour dire qu’ils vont vacciner vos enfants contre la Covid-19 il ne faut pas vacciner. […] » (Aide-soignante, 20/10/2020)
Cette rumeur sur un éventuel essai clinique clandestin sur les populations africaines continue de susciter des réactions anti-vaccins à Zohoudji, village décrit comme naturellement hostile à la vaccination par un agent de santé impliqué dans le PEV depuis cinq ans. Selon cet agent de santé, en cette période de crise sanitaire, les populations de ce village préfèrent se replier sur eux même que de faire confiance aux autorités gouvernementales acteurs principaux chargés de la riposte contre la pandémie. A titre illustratif, le relais communautaire impliqué dans le PEV dans ce village coiffant 25 hameaux justifie le refus de cette communauté à participer au dépistage volontaire par le fait que les résultats des tests ne lui sont pas communiqués. Le tableau 7 restitue les données de focus groups sur les perceptions du risque.
|
Les mères / gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois (milieu rural) |
Le virus étant importé et ne sévissant qu’en ville, la totalité (8/8) des mères partagent le même avis que les pères ou conjoints sur la consommation du Sodabi comme moyen d’éviter ou d’être immunisé contre le Covid-19. |
|
Les femmes enceintes (milieu urbain)
|
Pour 4 femmes enceintes Adja sur 10, les noirs sont immunisés contre le Covid-19 à cause de leur alimentation, en particulier par la consommation de sauce faite à base de noix de palme. |
|
Les pères / conjoints (milieu rural) |
10 pères / conjoints sur 12 ont affirmé que la consommation régulière du Sodabi (Vin de palme) immunisait contre le Covid-19. Ils ajoutent que le Covid-19 est une maladie de la ville et ceux sont ceux qui voyage vers la ville ou à l’extérieur qui sont susceptible d’en être victime. |
Tableau 7. Résultats des focus groups sur la perception du risque au covid-19.
Table 7. Results of focus groups on risk perception at covid-19
Attitude des agents de santé face à un éventuel vaccin anti covid-19
A la question suivante : « Si un vaccin contre le COVID-19 était disponible, vous serez prêts à vous faire vacciner ? Pourquoi ? », 87,5 % des agents de santé (14 sur 16) avaient déclaré qu’ils ne pouvaient pas accepter de se faire vacciner s’il arrivait qu’un vaccin contre covid-19 soit disponible. La figure 3 montre ces proportions.
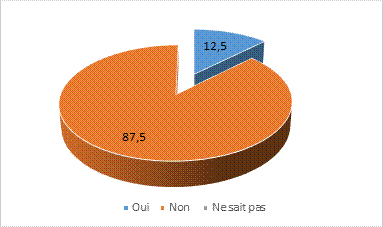
Figure 3. Avis des agents de santé sur leur acceptabilité d'un éventuel vaccin anti covid-19.
Figure 3. Health workers' opinions on their acceptability of a potential covid-19 vaccine.
« Non ! [...] même les chercheurs blancs disent de ne pas accepter les vaccins [...] Si c’est des comprimés peut être oui, mais jamais le vaccin » » (Agent de santé, PEV, Couffo)
« Les gens ont envoyé le vaccin de covid 19 sur les forums, ils ont critiqué de façon négative [...] mais si l’Etat amène, nous on va assumer notre rôle [rire]» (Agent de santé, PEV, Couffo)
Par ailleurs, lorsqu’il qu’il leur a été posé la question suivante : « Si un vaccin contre la COVID-19 était disponible, les gens de cette communauté seront-ils prêts à se faire vacciner ? Pourquoi ? », les avis sont partagés soit 43,75% (7 sur 16) de réponses affirmatives et 43,75 (7 sur 16) de réponses négatives (Figure 4).
« Si on ne sait pas faire même, ils vont nous lyncher. Avec ce que ces gens-là disent, mieux vaut le ministre même vient à la télé et s’injecte d’abord le vaccin devant toute la nation» (Agent de santé, PEV, Couffo).
« La communauté ne sera d’avis à 100% à cause des rumeurs qui avaient circulé entre temps. Il faudra faire des sensibilisations » (Agent de santé, PEV, Couffo).
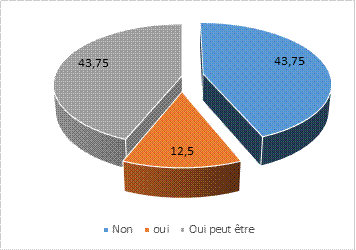
Figure 4. Avis des agents de santé sur l'acceptation d'un éventuel vaccin anti covid-19.
Figure 4. Health worker opinion on acceptance of a potential covid-19 vaccine.
Attitude des femmes enceintes, les mères/gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et pères/conjoints face à la vaccination en période de Covid-19 et à un éventuel vaccin anti covid-19
A la question «si un vaccin contre la COVID-19 était disponible, les gens de cette communauté seront-ils prêts à se faire vacciner ? Pourquoi ? », Les femmes enceintes, les mères/gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois et pères/conjoints se sont montrés réticents face à la vaccination en période de covid-19 et ont exprimé leur méfiance face à un éventuel vaccin anti covid-19 comme le démontre le tableau 8.
|
Les mères / gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois (milieu rural)
|
8/8 des mères relatent l’histoire selon lequel, en Afrique, la peau noire serait plus difficile à fragiliser par le Covid-19. Et que par rancune, les Européens désirent que l’Afrique vive la même tragédie des cas de décès. C’est pour cela ils demandent au gens de se faire vacciner. Selon elles il ne faut pas se faire vacciner contre covid-19. Elles ajoutent que personne ne sait ce que même les agents de santé peuvent faire si on les payait (complot des blancs avec l’Etat) |
|
Les femmes enceintes (milieu urbain)
|
Selon 8/10 des femmes enceintes (toutes Adja), le covid-19 aurait commencé par la vaccination en Europe et cela aurait entrainé des morts ce qui n’était pas le cas de l’Afrique où il y aurait selon elles peu de mort et peu de cas. Ce renforcerait leur méfiance par rapport à la vaccination en cette période-là. |
|
Les pères / conjoints (milieu rural)
|
100% des pères et conjoints sont hostiles à la vaccination en période de Covid-19 puisqu’ils douteraient de leur contenu. Aussi, pour 100% (soit 12/12) des pères ou conjoints, un blanc (Didier Raoul Infectiologue français) aurait incité les Africains à « ne pas prendre le vaccin de Bill Gates contre le Covid-19 ceci contiendrait du poison et les occidentaux veulent anéantir l'Afrique. Ils étayent cela avec l’argument selon lequel en Afrique le Covid-19 n’a pas fait de ravage comme c’est le cas en Europe. |
Tableau 8. Résultats des focus groups sur l’attitude face à la vaccination en période de Covid-19.
Table 8. Results of focus groups on attitudes towards vaccination in the Covid-19 period.
Des logiques guidées par des pratiques multiples
Ces logiques guident des pratiques multiples à savoir :
Les initiatives d’un Chef village pour conjurer le malheur du covid-19
« Lorsque la maladie est apparue et on a appris que cela faisait des ravages chez les blancs et en ville, nous avions peur. Une psychose générale s’est emparée de tout le monde et chacun restait dans son coin. [...] notre chef de village [lui-même est là je ne peux mentir devant lui] avait invité le pasteur pour prier pour toute la communauté ici à Zohoudji. Après cela, il a appelé les leaders des religions endogènes pour conjurer ce malheur et le renvoyer d’où il vient. Il l’a fait de par sa propre initiative. Il a sorti l’argent de sa propre poche pour acheter tout ce qu’il faut [...] boisson, moutons, bœuf, tout [...] » (Participant au focus group pères/conjoints, Zohoudji-Bétoumey).
Consommation de sauce de noix de palme
« Ce n’est pas une maladie pour les noirs [...] si ça vient ça va repartir. Ils nous ont dit de prendre la pâte avec la sauce faite à base de noix de palme. Quand on prend cela, la maladie ne peut plus nous toucher » (Participante au focus group femmes enceinte Doko, Toviklin).
Consommation de Sodabi
« Comme ils nous ont dit que l’alcool lutte contre ça, on en prend beaucoup. D’autres en ont pris et se sont même endettés [...] c’est deux vers le matin et deux vers le soir [...] on en prend aussi pour nous laver les mains » (Participant au focus group pères/conjoints, Zohoudji-Bétoumey).
Stratégies de résilience
Agents de santé et relais communautaire mobilisés pour lever les obstacles à la vaccination
Le mécanisme d’atténuation des attitudes provoquées par les rumeurs sur les vaccins en milieu Adja-Fon du Couffo, repose, selon 100% (21 sur 21) des agents de santé et relais communautaire sur l'Information, l'Éducation et la Communication (IEC).
Tous les 21 agents de santé et relais communautaires ont affirmé que l’IEC se fait essentiellement pendant qu’ils sont en stratégie avancée dans les communautés ou en poste fixe de façon individuelle ou en masse. Les informations communiquées ou échangées à ces occasions consistent à persuader les populations des fausses rumeurs qui circulent.
« C’est la sensibilisation par rapport au covid. S’il y a une minorité qui est venue à la vaccination par exemple, nous les deux responsables nous nous sommes permis de faire des sensibilisations à propos de ce sujet. [...] ce n’est pas parce que quelqu’un est atteint, que cette personne mourra. Mais quand vous venez et qu’on découvre tôt et quand le traitement est vite mis en place, vous serez guéris, ce qui fait que les fréquentations des centres de santé ont repris » (Entretien sagefemme PEV_CSA_Azovè)
Les messages communiqués par les agents de santé et les relais sont généralement de deux types.
Le premier à caractère politique serait plus convaincant selon 2 IDE impliqués dans le PEV.
« Il a fallu des sensibilisations, on a beaucoup parlé avant qu’ils n’acceptent [...] et on leur a dit que si d’ici trois jours l’enfant tombe malade si c’est la fièvre ou bien l’inflammation de la partie, ils peuvent passer au centre de santé [...] que l’Etat ne peut pas vouloir le mal de sa population. Parce que l’Etat ne peut pas dire de prendre les vaccins pour aller tuer la population qui va voter pour eux ? [...] c’est les genres de sujets qu’on aborde. [...] on leur dit, vous maintenant vous refuser la vaccination est ce que vous continuez par prendre “para” et elles disent oui. Je leur dire voilà qu’on ne fabrique rien chez nous, ce sont les blancs qui font tout ; est ce que vous savez ce qui est dans para ? Ça veut dire que les blancs peuvent passer par de simples paras pour nous tuer. Quand on commence par leur expliquer les choses comme ça, ils comprennent » (IDE PEV, Dekpo)
Le deuxième vise à obtenir directement le consentement éclairé des populations.
« [...] c’est la sensibilisation, quand les femmes viennent à la vaccination on les informe que ce n’est pas un nouveau vaccin [...] au début [mai 2020] quand tu vas en stratégie avancée, quand elles te voient tout de suite elles te posent la question pour dire ‘’ah maman ce n’est pas votre nouveau vaccin qui est venu là ? Et on leur dit non c’est toujours les mêmes vaccins qu’on ne peut pas leur donner un autre vaccin sans les avertir [...] on doit t’avertir d’abord avant de le faire, tu dois savoir pourquoi on est entrain de te vacciner » (IDE PEV, Sokouhoué)
Motivation par l’offre de repas
L’offre de repas est une technique utilisée par les agents de santé pour encourager les femmes à venir à la vaccination au centre de santé. Cette technique a été particulièrement observée dans deux centres de santé à savoir Doko et Houédogli. Selon deux agents impliqués dans le PEV (1 IDE et 1 aide-soignant) cette technique encouragerait les femmes à ne pas rester à la maison mais à chaque fois venir au centre de santé.
« [...] c’est ça j’ai fait tout à l’heure et vous avez vu qu’elle me remerciait avant de s’en aller. [...] c’est moi même qui prend moi argent pour leur payer ça. Des fois elles marchent sur une longue distance et quand tu les vois, tu as l’impression qu’elles sont fatiguées. Alors que d’autres ne se dérangent même pas ; elles restent à la maison pour qu’on vienne vers elles donc on les encourage avec ça de temps en temps » (Aide-soignant, PEV, Houédogli)
« Des fois pour les encourager à venir je leur paie du dokô. Parfois pour 1000 fcfa parfois pour 500 fcfa ça dépend de ma poche et du nombre de femmes qui viennent les vendredis. » (IDE PEV, Doko)
Discussion
Les rumeurs sur la santé incitent non seulement à des craintes et au scepticisme inutiles, mais peuvent amener les individus à refuser un recours efficace et ainsi retarder leur traitement (Agbodjavou et al., 2020). Alors que la technologie facilite la diffusion d’informations sur les médias sociaux, la désinformation continue d’influencer dans une large mesure les communautés en termes d’attitudes et d’opinions sur les questions sociopolitiques liées à la santé dans le monde. En particulier, la prolifération des rumeurs sur la santé sur les réseaux sociaux a suscité de vives inquiétudes, notamment dans le contexte de la pandémie mondiale actuelle – Covid-19 - où il fallait également lutter contre une « infodémie » (Zarocostas, 2020). Compte tenu des effets significatifs sur la santé physique et les représentations des communautés, il est donc important d’examiner les rumeurs liées à la pandémie actuelle, rumeurs qui jusqu’ici ont fait obstacles à toutes les mesures d’éradication du virus et ont mis à rude épreuve les politiques de santés des systèmes sanitaires africains.
La présente étude menée à l’échelle des communautés rurales sur la manière dont les rumeurs construisent les attitudes et les pratiques liées à la vaccination en période du Covid-19, a identifié deux facteurs sociologiques et anthropologiques contribuant à l’acceptation des rumeurs sur le Covid-19 et la vaccination, notamment les croyances renforçant l’idée d’une théorie de complot sur l’éradication de la race noire ; d’une maladie ou épidémie « importée » mortelle dans un contexte africain. En outre, l’étude a également révélé que les sources d’informations telles que les chefs de village, les chefs religieux (Pasteur et Prêtre Vodou), les enfants des mères d’enfants de 0 à 12 mois travaillant en ville, les époux des femmes enceintes et les réseaux sociaux ont contribué à l’acceptation des rumeurs sur le Covid-19 et la Vaccination.
Surtout, les résultats de l’étude ont montré que la perception selon laquelle le covid-19 est une épidémie « importée » mortelle pour les africains a fortement influencé les pratiques cultuelles et culturelles telles que la prière, l’immolation d’animaux domestiques pour la protection, la consommation du Sodabi et la sauce à base de noix de palme pour la prévention contre le Covid-19. Cette analyse était conforme aux études précédentes identifiant le mythe de l’alcool comme substance prévenant le « mal » du Covid-19 comme facteur augmentant la probabilité que les communautés rurales acceptent et partagent des informations non vérifiées (Chick, 2020). Les communautés rurales étaient sensibles aux informations négatives relatives aux croyances d’une nouvelle « maladie envoyée par les blancs en Afrique » et étaient plus susceptibles de diffuser des messages non fondés (Nieves-Cuervo et al., 2021 ; Pezzo et Beckstead, 2006). Les rumeurs largement répandues en matière de santé sur les réseaux sociaux contiennent généralement des appels à la méfiance et des incertitudes, et elles étaient donc chargées de craintes et des représentations pour susciter la panique des communautés rurales (Pan et al., 2021). La théorie de la diffusion des représentations et de l’intelligence collective, postule que les informations vérifiées ou pas, transmises s’intensifient chez les personnes dont les connaissances sur la question étaient au préalable limitées (Lahlou, 2011) comme cela a été le cas chez les mères et les gardiennes d’enfants de 0 à 12 mois, les femmes enceintes et les pères/conjoints dans le présent travail.
Contribution au développement : le vaccin anti covid-19 comme clé de relance de l’économie globale et locale
Les mesures de restrictions imposées par les pays à l’avènement de la pandémie ont eu dès le départ une lourde conséquence sanitaire, économique et sociale sur les populations. Plus de 150 millions de personnes supplémentaires sombreront dans la pauvreté extrême en 2021 selon les prévisions statiques actuelles (World Bank, 2021).
Compte tenu de cet état d’urgence, les vaccins anti covid-19 constituent à l’heure actuelle, la clé pour le rétablissement de la santé mondiale. En effet, une vaste et rapide campagne de vaccination contre le covid-19 permettrait d’immuniser le monde contre ce virus, de freiner sa propagation dans nos communautés et de s’assurer de briser la chaîne des mutations hautement endémiques.
A ce jour, plus de 100 pays dont 61 à faibles revenus ont reçu des vaccins contre le covid-19 grâce au COVAX. Il s’agit au total de 38 millions de doses, mais cela reste insuffisant. Si on prenait l’exemple de l’Afrique, il faudrait 1 milliard et demi de dose pour atteindre l’immunité collective et par conséquent rétablir la santé des populations. Le Covax souhaiterait produire plus de deux milliard de doses d’ici la fin de 2021. Ce qui laisse supposer qu’à cette échéance juste une personne sur dix serait vaccinée dans les pays dépendants uniquement de ce dispositif. Il faudrait à ce rythme peut-être 4 à 5 ans pour atteindre 75% de la population mondiale (Guittard, 2021). Suivant ce scénario, il y a donc plus de chances d’assister à de nouvelles mutations du virus, ce qui pourrait créer de nouvelles souches potentiellement pires contre lesquelles le vaccin pourrait ne pas protéger (Challen et al., 2021).
Il est par ailleurs urgent d’avoir la compréhension des éléments qui font obstacle à l’adhésion des populations aux campagnes de vaccination anti-covid-19 afin de parvenir au plus tôt à une immunité collective contre la pandémie.
Conclusion
Le présent travail qu’il convient d’appeler recherche liminaire contribue à juste titre à donner un éclairage sur les éléments susceptibles d’expliquer l’acceptabilité ou non des vaccins contre le covid-19 dans le Sud-Ouest du Bénin. En effet, l’épineuse question de l’acceptabilité des vaccins reste sans réponse, notamment dans les pays d’Afrique où nombreuses rumeurs entravent lourdement leur acceptabilité. Il existe très peu de recherches contextualisées, prenant en compte les réalités sociologiques et anthropologiques pouvant aider à l’élaboration des stratégies de mise en œuvre des campagnes de sensibilisation adaptées aux différents contextes.
References bibliographiques
Agbodjavou K.M., Malou P., Sopoh E.G., Azandjeme C.S., Paraiso M. Et Ouendo E.M., 2020, Perceptions et pratiques de prévention des complications chroniques du diabète : une étude chez les patients externes dans le district sanitaire n°5 de Lomé – Togo. West African Journal of Research for Health, 8, 13-18
Challen, R., Brooks-Pollock, E., Read, J. M., Dyson, L., Tsaneva-Atanasova, K., Danon, L. 2021. Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ, 372.
Chick, J. 2020. Alcohol and COVID-19. Alcohol and Alcoholism, 55(4), 341-342.
Guittard R, 2021, Vaccins contre la covid-19 : quels enjeux en 2021 ? Oxfam, https://www.oxfamfrance.org/financement-du-developpement/vaccins-contre-le-covid-19-quels-enjeux-en-2021/
Lahlou, S. 2011. Difusão de representações e inteligência coletiva distribuída. In: Angela Maria de Oliveira Almeida, Maria de Fatima de Souza Santos and Zeiji Araujo Trinidade (eds.) Teoria das Representações sociais - 50 anos. Rio de Janeiro: TechnoPolitik Editora & UERJ, pp. 59-97.
Nieves-Cuervo, G. M., Manrique-Hernández, E. F., Robledo-Colonia, A. F., Grillo, A. E. K. 2021. Infodemia: noticias falsas y tendencias de mortalidad por COVID-19 en seis países de América Latina. Revista Panamericana de Salud Pública, 45, e44.
Nuzhath, T., Hossain, M. 2020. Secondary impacts of COVID-19: Risk of vaccination reduction and global resurgence of measles. https://doi.org/10.31235/osf.io/97gr6
Pan, W., Liu, D., Fang, J. 2021. An examination of factors contributing to the acceptance of online health misinformation. Frontiers in Psychology, 12, 630268.
Pezzo, M. V., Beckstead, J. W. 2006. A multilevel analysis of rumor transmission: Effects of anxiety and belief in two field experiments. Basic and Applied Social Psychology, 28(1), 91-100.
World Bank, 2021, Rapport 2020 sur la pauvreté et la prospérité partagée : Revers de fortune, Groupe de la Banque mondiale, 24 p.
Zarocostas, J. 2020. How to fight an infodemic. The lancet, 395(10225), 676.