Lakhdar, N.E.Y., Lamri, D., Ouahidi, M.L., 2021 Prévalence de l’obésité et le rapport entre l'indice de masse corporelle et activité physique chez les adolescents scolarisés de Béni Tadjit, Est du Maroc. Antropo, 45, 39-46. www.didac.ehu.es/antropo
Prévalence de l’obésité et le rapport entre l'indice de masse corporelle et activité physique chez les adolescents scolarisés de Béni Tadjit, Est du Maroc
Prevalence of obesity and the relationship between body mass index and physical activity among adolescent students from Beni Tadjit, Est of Morocco
Nour El Yakine Lakhdar1, Driss Lamri2, Moulay Laarbi Ouahidi1
1 Laboratoire Biologie et Sante, Faculté des Sciences, Kenitra, Maroc
2Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation, Rabat-Salé-Kenitra, Maroc
Corresponding author: Nour El Yakine Lakhdar : nourelyakine.lakhdar@uit.ac.ma
Mots-clés : Adolescent, obésité, surpoids, indice de masse, activité physique, sédentarité
Keywords: Adolescent, Obesity, Overweight, Mass index, Physical activity, Sedentary lifestyle
Résumé
Introduction : L’objectif de ce travail était d’étudier la prévalence de l’obésité et la relation entre l’indice de masse corporel (IMC) et l’activité physique chez les adolescents marocains scolarisés et d’identifier les facteurs favorisant la prise pondérale.
Méthodes : Nous avons colligé 320 adolescents, âgés entre 15 et 20 ans dont 168 garçons (56,6%) et 152 filles (43,33%). Il s'agissait d'une enquête descriptive transversale réalisée en 2021; un échantillon représentatif des élèves recrutés dans 3 établissements scolaires publiques. Par le biais d’un questionnaire, les adolescents avaient mentionné leurs caractéristiques sociodémographiques, leur niveau d’activité physique et leur comportement sédentaire, et nous avons mesuré leur taille et leur poids.
Résultats : Le moyen d’âge des adolescents était de 17,73±1,35 ans. Le poids moyen était de 64,13± 9,23 kg, la taille moyenne était de 1,65± 0,089 m. L’IMC moyen était de 23,61± 4,11 kg/m2. L’obésité était de 1,56% qui touche d’avantage les filles que les garçons (1,25 % vs 0,31%). Les filles sonten surpoids plus que les garçons (12,50 % vs 7,81 %). 33,6% des adolescents (dont 23,07% des filles et 23,52% des garçons) passent 1 à 2 heures devant un écran télévisé en moyenne par jour pendant la semaine et 56,4% (15,5% des garçons et 42,30% des filles) passent plus de 5 heures en moyenne par jour pendant le week-end, 43,33% (51,48 des garçons et 32,70% des filles) pratiquent plus de deux jours par semaine une activité sportive à fort intensité et 41,66% des adolescents (21,15% des filles et 30,88% des garçons) pratiquent 1 à 2 jours par semaine une activité de loisirs d'intensité modérée. Au terme de cette étude, on remarque que la prévalence de l’obésité et de surpoids étaient significativement associée à la pratique de l’activité physique (p< 0,01).
Conclusion: Ces données nous incitent à tirer la sonnette d'alarme afin de mettre en place un programme de prévention entrepris très tôt dès l'enfance, qui devrait inclure non seulement des approches individuelles, mais aussi l'environnement social et physique de l’adolescent.
Abstract
Introduction: The objective of this work is to inspect the prevalence of obesity and the relationship between body mass index (BMI) and physical activity among Moroccan adolescent students and to identify factors that promote weight gain.
Methods: 320 participants were selected, aged between 15 and 20 years and divided into 168 boys (56.6%) and 152 girls (43.33%). This was a cross-sectional descriptive survey carried out in 2021 on a representative sample of pupils chosen from 3 Moroccan public schools. Through a questionnaire, adolescents identified their socio-demographic characteristics, physical activity levels and sedentary behaviour, and we measured their height and weight.
Results: The average age of adolescents was 17.73 1.35 years. The average weight was 64.13 9.23 kg, the average height was 1.65 0.089 m. The average BMI was 23.61 4.11 kg/m2. Obesity was 1.56%, which affects girls more than boys (1.25% versus 0.31%). Girls are more overweight than boys (12.50% vs. 7.81%). 33.6% of adolescents (23.07% of girls and 23.52% of boys) spend 1 to 2 hours in front of a television screen on average per day during the week and 56.4% (15.5% of boys and 42.30% of girls) spend more than 5 hours on average per day during the weekend, 43.33% (51.48 of boys and 32.70% of girls) participate in high intensity sports more than two days a week and 41.66% of adolescents (21.15% of girls and 30.88% of (21,15% of girls and 30.88% of boys) engage in moderate leisure activity 1 to 2 days a week. The study found that the prevalence of obesity and overweight was significantly associated with physical activity (p < 0.01).
Conclusion: These data prompt us to sound the alarm in order to set up a prevention program undertaken very early in childhood, which should include not only individual approaches, but also the social and physical environment of the adolescent.
Introduction
Le phénomène de l'obésité prend des proportions inquiétantes au Maroc. 25,2% de la population marocaine ont un surpoids et 10,3% souffrent d'obésité (Rahim et Baali, 2011). Près du un tiers de la population du Maroc, soit 10,3 millions de personnes, connaît des problèmes de surpoids.Une question de santé publique qui prend de l'ampleur depuis dix ans, souligne dans une étude de Haut-Commissariat au Plan (HCP) du Maroc en 2011. Selon cette enquête, menée par le HCP auprès de 2426 ménages, le Maroc a réalisé des progrès notables dans la lutte contre la sous-nutrition. Chez les enfants de moins de cinq ans, l'insuffisance pondérale est ainsi passée de 9,3% en 2004 à 3,1% en 2011, ce qui met le Royaume en très bonne position par rapport à la moyenne mondiale (16%). Les adultes, de plus de 20 ans, ne sont plus que 3,3% concernés contre 3,9% en 2001. En revanche, le Maroc voit apparaître de sérieux problèmes en matière d'obésité. Au total, 10,3 millions de marocains adultes, dont 63,1% de femmes, sont en situation d'obésité ou de pré-obésité, résume le rapport. Parmi ces personnes, 3,6 millions, un adulte marocain sur cinq est concerné par l'obésité grave et morbide. Les femmes sont les plus touchées (26,8%) en particulier en milieu urbain. Sur 10 ans, l'obésité grave et morbide a augmenté de 7,3% par an en moyenne, s'alarme le HCP, relevant que l'inactivité ainsi que les niveaux de vie et d'éducation influent sur ce phénomène. En effet, la fréquence du surpoids et de l'obésité augmente de façon très rapide notamment chez les enfants, devenant ainsi un problème majeur de la santé à l’échelle mondial (Thibault et Rolland-Cachera, 2003), Le Maroc ne semble pas être épargné par le phénomène d′obésité infantile dont la prévalence est en augmentation alarmante. L'obésité infantile constitue un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires, et peut entrainer des problèmes articulaires, respiratoires, métaboliques, endocriniens ou même encore orthopédiques. Au-delà des conséquences somatiques, l'obésité infantile peut entraîner de nombreux troubles psychosociaux. L'obésité chez les enfants présenteun risque important de persistance à l’âge adulte. Ces complications multiples de l'obésité soulignent l'intérêt d'une approche préventive efficace qui devrait être instaurée dès l’enfance (Chiarelli et Marcovecchio, 2008). En effet, il existe une association entre l’excès de poids en bas âge et de nombreuses complications, et cet excès de poids est aussi lié à un risque accru de morbidité et de décès prématuré à l’âge adulte (Chiarelli et Marcovecchio, 2008). Ces conséquences sur la santé physique s’ajoutent aux répercussions psychologiques et sociales en rapport avec la modification de l’image du corps engendrée chez l’enfant par l’obésité. Compte tenu de sa progression rapide dans le monde de nos jours, l’obésité infantile est un phénomène de santé de plus en plus inquiétant. Elle représente l’une des conséquences de la transition nutritionnelle et du mode de vie sédentaire ayant émergés dans de nombreux pays et en particulier en milieu urbain (Gupta et al, 2012). En 2002, l'Organisation Mondiale de la Santé considérait que 60 à 85 % de la population mondiale avait un mode de vie sédentaire, dont deux tiers des enfants, et y attribuait deux millions de morts par an. C’est donc un des problèmes de santé publique les plus sérieux de notre époque, même s'il ne retient pas encore suffisamment l'attention, certains parlent d'épidémie d'inactivité physique (OMS, 2002).
L’activité physique régulière et modérée a des effets bénéfiques sur la longévité en diminuant la mortalité globale et en particulier la mortalité cardiovasculaire. Les données épidémiologiques initiales présentées dans les années 80 sur les anciens élèves d’Harvard (Paffenbarger et al, 1986) ont été amplement confirmées par plusieurs études réalisées dans de larges et diverses populations d’hommes et de femmes d’âge variable (Andersen, 1995). Il est bien admis que l’activité physique a un rôle protecteur contre l’obésité. Cependant, l’association d’un régime hypocalorique adapté est nécessaire (Shephard et Balady, 1999). En outre, l’activité physique a un effet bénéfique sur la répartition des graisses en particulier viscérales et augmente la masse musculaire.
Les épidémiologistes s'inquiètent de la véritable pandémie d'obésité qui se dessine dans l'ensemble du monde occidental, notamment chez les jeunes. La diminution pondérale à la reprise d'une activité physique régulière et modérée est de l'ordre de 6 à 10 % sur 12 mois (Fedala et al, 2015). La perte de poids est d'autant plus importante que l'activité physique ; elle est associée à des efforts diététiques. Comme pour les dyslipidémies, la plupart des études s'accordent sur le caractère suffisant d'une intensité modérée (Charles, 2011). Les évolutions observées dans les pays en voie de développement montrent clairement un parallélisme entre le développement économique, le recul de la pauvreté, l’urbanisation et l’augmentation de la prévalence de l’obésité (Kramoh et al, 2012).
L’objectif de cette recherche est d'évaluer la pratique de l'activité physique chez un groupe des élèves lycéen de la ville de Beni Tadjit au Maroc et d’estimer la prévalence de l’obésité, et du surpoids par l’IMC, et identifier les facteurs favorisant la prise pondérale.
Type de l’étude
Il s'agit d'une enquête descriptive, transversale qui a porté sur un échantillon représentatif d’élèves de l’établissement scolaire de Ibn al-Banna al-MarrakushàBeni Tadjit.
Population étudiée
La population d’étude était composée de 320 élèves âgés de 15 à 20 ans. Ces élèves étaient sélectionnés au hasard parmi des élèves inscrits dans des classes tronc commun, 1ere année et 2eme année du baccalauréat. Les paramètres étudiés sont:
Le poids et la taille.
L’IMC ou indice de Quételet ou le BMI est calculé par la formule mathématique
IMC (kg/m2) = poids (en kg)/taille 2(en m).
L’IMC est reconnu comme étant un critère international d’évaluation de la corpulence. D’après les seuils retenus par l’OMS, le surpoids est défini comme un IMC égal ou supérieur à 25 kg/m2 et l’obésité comme un IMC égal ou supérieur à 30 kg/m2 (OMS, 2010).
Pour définir l'activité physique quotidienne habituelle des élèves lycéen de l’établissement Ibn al-Banna al-Marrakushun un questionnaire leur a été soumis. Ce dernier nous a fourni des informations : le nombre des jours par semaine dont les élèves pratiquants une activité sportive et la sédentarité (télévision) en semaine et pendant le week-end. En effet, les besoins du traitement statistique des données de l'activité sédentaire quantifiées en heures par jour, ont été regroupées en 7 gammes (Je ne regarde jamais, moins de 1 heure, entre 1 et 2 heures, entre 2 et 3 heures, entre 3 et 4 heures, entre 4 et 5 heures, et plus de 5 heures).
Analyse statistique
Le traitement statistique des données a été effectué à l’aide du logiciel SPSS version 20.0. Les variables quantitatives ont été décrites par les moyennes et les écarts-types, et les variables qualitatives ont été décrites par les fréquences et les pourcentages en fonction du sexe et de l’âge. L’existence d’une éventuelle corrélation entre IMC et les différentes variables associées a été précisée par le test de Pearson. Une valeur de p < 0,05 était exigée afin d’affirmer le caractère significatif des résultats et de dégager les facteurs les plus discriminants associés au surpoids dans notre population d’étude.
Résultats
Caractéristiques morphologiques
Notre population d’étude interprétait 320 élèves dont 168 garçons (56,67%) et 152 filles (43,33%) d′âge moyen 17,73±1,35 ans. Les élèves avaient tous eu une mesure du poids et de la taille et un calcul de l’IMC. Le tableau 1 montre que le poids moyen des élèves participants était de 64,13 ± 9,23 kg. L′IMC moyen était de 23,61 ± 4,11 kg/m2. À l’exception de l’âge, on n’avait pas de différences inter-sexes significatives (p< 0,05).
|
|
Ensemble (n=320) Moyenne ± ET |
Filles (n=152) Moyenne ± ET |
Garçons (n=168) Moyenne ± ET |
|
Age (année) |
17,73±1,35 |
17,52±1,43 |
17,88± 1,29 |
|
Taille(m) |
1,65± 0,089 |
1,63± 0,06 |
1,66± 0,09 |
|
Poids(Kg) |
64,13± 9,23 |
62,76±8,32 |
65,14±9,87 |
|
IMC (Kg/m2) |
23,61± 4,11 |
23,64±2,91 |
23,65±4,52 |
Tableau 1. Caractéristiques anthropométriques moyennes de l’ensemble des élèves. ET : écart-type ; IMC : indice de masse corporelle.
Table 1. Average anthropometric characteristics of all students. SD: standard deviation; BMI: body mass index.
Prévalence de l’obésité et du surpoids
Sur 320 élèves pour les quels des mesures anthropométriques ont été prises, et qu’ont rendu les questionnaires complets sans données manquantes, 65 (20,31%) élèves étaient en surpoids et 5 (1,56%) en obésité modérée et 250 (78,12%) en poids normal.
Par ailleurs, les caractéristiques de l’ensemble des adolescents obèses et en surpoids des deux sexes sont résumées dans le tableau 2. La moyenne d’âge est de 17,5±1,51 an. La moyenne de l’IMC est de 28,02± 2,47 Kg/m2.
La figure 1 présente la prévalence de l’obésité et du surpoids en fonction du sexe, les filles sont plus touchés par l’obésité que les garçons (1,25 % contre 0,31%; p < 0,05).
De même, cette étude souligne que les filles sont plus en surpoids que les garçons (12,50 % contre 7,81 %; p< 0,05).
|
|
Ensemble (n=70) Moyenne ± ET |
Filles (n=40) Moyenne ± ET |
Garçons (n=30) Moyenne ± ET |
|
Age (année) |
17,5±1,51 |
18,16± 1,50 |
18,04±1,46 |
|
Taille(m) |
1,60± 0,07 |
1,59± 0,80 |
1,60± 0,06 |
|
Poids(Kg) |
71,92± 5,39 |
72,33±5,6070 |
42±5,03 |
|
IMC (Kg/m2) |
28,02± 2,47 |
28,42±1,95 |
27,50±1,71 |
Tableau 2. Caractéristiques anthropométriques de l’ensemble des élèves obèses et en surpoids. ET : écart-type ; IMC : indice de masse corporelle.
Table 2. Anthropometric characteristics of all obese and overweight students. SD: standard deviation; BMI: body mass index.
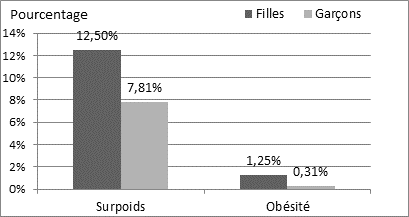
Figure 1. La prévalence de l’obésité et du surpoids chez les deux sexes.
Figure 1. The prevalence of obesity and overweight in both sexes
Activité Physique et Sédentarité
Le tableau 3 montre que 25,93 % de la population étudiée dont 27,77% des filles et 23,57% des garçons passent 2 à 3 heures devant un écran télévisé en moyenne par jour pendant la semaine et 39,06% (40% des garçons et 40,28% des filles) passent plus de 5 heures en moyenne par jour pendant le week-end. En revanche, cette étude montre que 19,69% de la population total pratique un sport qui nécessite une augmentation importante de rythme respiratoire (38,93% des garçons et 6,34% des filles).
|
Paramètres
|
Total |
Filles |
Garçons |
||||
|
N |
% |
N |
% |
N |
% |
||
|
Transport utilisé pour se rendre à l’école |
Voiture |
35 |
10,93 |
20 |
13,31 |
15 |
8,92 |
|
Bus |
90 |
28,12 |
55 |
36,18 |
35 |
20,83 |
|
|
Vélo |
75 |
23,43 |
20 |
13,15 |
55 |
32,73 |
|
|
A pied |
120 |
37,50 |
43 |
28,28 |
77 |
45,83 |
|
|
Télévision en semaine
|
Je ne regarde jamais |
43 |
13,43% |
13 |
7,22% |
30 |
21,42% |
|
Moins de 1h/j |
69 |
21,56% |
40 |
22,22% |
29 |
20,71% |
|
|
1 -2 h/j |
75 |
23,43% |
45 |
25% |
30 |
21,42% |
|
|
2- 3 h/j |
83 |
25,93% |
50 |
27,77% |
33 |
23,57% |
|
|
3 -4 h/j |
50 |
15,62% |
32 |
17,77% |
18 |
12,85% |
|
|
Télévision en week-end |
Je ne regarde jamais |
6 |
01,87% |
00 |
00 ,00% |
06 |
06% |
|
Moins de 1h/j |
7 |
2,18% |
05 |
2,36% |
02 |
02% |
|
|
1 -2 h/j |
24 |
07,5% |
18 |
8,53% |
06 |
06% |
|
|
2- 3 h/j |
35 |
10,93% |
25 |
11,84% |
10 |
10% |
|
|
3 -4 h/j |
51 |
15,93% |
37 |
17,53% |
14 |
14% |
|
|
4 -5 h/j |
72 |
22,5% |
51 |
24,17% |
21 |
21% |
|
|
5 h/j ou plus |
125 |
39,06% |
85 |
40,28% |
40 |
40% |
|
|
Temps de sommeil |
Moins 6 |
35 |
10,93% |
10 |
5,52% |
25 |
17,89% |
|
6h |
93 |
29,06% |
49 |
27,07% |
44 |
31,65% |
|
|
Plus de 6 |
192 |
60% |
122 |
67,40% |
70 |
50,35% |
|
|
Pratiquez des sports qui nécessitent une augmentation importante de la respiration |
Oui |
63 |
19,69% |
12 |
6,34% |
51 |
38,93% |
|
Non |
257 |
80,31% |
177 |
93,65% |
80 |
61,06% |
|
|
Jours / semaine pratiquez-vous une activité sportive à fort intensité |
Moins de 1j |
76 |
23,77% |
46 |
44,23% |
30 |
13,88% |
|
Entre 1j et 2j |
106 |
33,12% |
32 |
30,76% |
74 |
34,25% |
|
|
Plus de 2j |
138 |
43,12% |
26 |
25% |
112 |
51,85% |
|
|
Des activités de loisirs d'intensité modérée |
Oui |
275 |
85,93% |
110 |
78,57% |
165 |
91,66% |
|
Non |
45 |
14,07% |
30 |
21,42% |
15 |
08,34% |
|
|
J /semaine activités de loisirs d'intensité modérée |
Moins de 1j |
105 |
38,18% |
40 |
14,54% |
65 |
23,63% |
|
Entre 1j et 2j |
90 |
32,72% |
30 |
10,90% |
60 |
21,81% |
|
|
Plus de 2j |
80 |
29,09% |
10 |
3,63% |
70 |
25,45% |
|
Tableau 3. Activité physique et sédentarité de l’ensemble des adolescents des deux sexes.
Table 3. Physical activity and sedentary behavior of all adolescents of both sexes.
Par ailleurs, 43,12% (51,85% des garçons et 25% des filles) pratiquent plus de deux jours par semaine une activité sportive à fort intensité et 32,72% (10,90% des filles et 21,81% des garçons) pratiquent entre 1 et 2 jour par semaine une activité de loisirs d'intensité modérée.
Corrélations entre l’âge, l’IMC, l’Activité Physique et la Sédentarité des élèves
Dans cette étude nous avons constaté qu’il y a une corrélation entre l’Activité Physique et l’IMC, et entre la sédentarité et l’IMC chez les deux sexes (p < 0,01). Toutefois, il n’existe pas de corrélation significative pour les autres paramètres (Tableau 4).
|
|
IMC (kg/m2) garçons |
IMC (kg/m2) filles |
|
Âge (ans) |
0,0366 NS |
0, 0431NS |
|
Sédentarité en semaine |
-0,254 S |
-0,234 S |
|
Sédentarité en week-end |
-0,762 S |
0,523 S |
|
Activité physique |
-0,24 S |
0,551 S |
|
Temps de sommeil |
0,073 NS |
0,038 NS |
Tableau 4. Corrélations entre l’âge, l’IMC, l’AP et la sédentarité. IMC : indice de masse corporelle ; NS : corrélation non significative. S : corrélation significative (p < 0,01).
Table 4. Correlations between age, BMI, PA, and sedentary lifestyle. BMI: body mass index; NS: non-significant correlation. S: significant correlation (p < 0.01).
L'ensemble des études menées à la fois dans les pays industrialisés et en développement indiquent une augmentation rapide du nombre d'enfants ayant un surpoids ou une obésité. En 2010, selon les standards de l'OMS, 43 millions d'enfants (dont 35 millions dans les pays en voie de développement) étaient considérés comme étant en surpoids ou obèses; 92 millions étant à risque de surpoids. La prévalence du surpoids (obésité incluse) de l'enfant est passée de 4,2% en 1990 à 6,7% en 2010. Cette tendance devrait atteindre 9,1% en 2020, représentant approximativement 60 millions enfants. Le taux d'obésité dans les pays développés étant 2 fois plus élevé que celui des pays en voie de développement (OMS, 2010).
La prévalence du surpoids (20,31%) et d’obésité (1,56%) de notre populationd’étude pour lesquels des mesures anthropométriques ont été prises, soulignant que les filles sont plus en surpoids que les garçons (12,50 % contre 7,81 %; p< 0,05), concorde avec les résultats trouvés dans la population générale. Une prévalence de de 12,9 % 2,3% a été précédemment révélée chez les adolescents en Maroc (Sebbani et al, 2013). En Tunisie la prévalence de l’obésité a augmenté de 3,3 % à 5,8 % entre 1999 et 2007 (Oulamara et al, 2009). En Algérie, la prévalence de l’obésité était plus importante chez les garçons (2,42 %) que chez les filles (0,54 %). Parallèlement, les garçons sont plus en surpoids (6,66 % contre 2,16%) (Fedala et al, 2015). Cette différence est observée dans la littérature des pays en voie de développement. De même, une prévalence de 17,6% et de 21,6% a été révélée chez les écoliers de 11-17 ans en France et en Grèce respectivement (Souames et al, 2005 ; Krassas et al, 2001) et de 23% chez les écoliers de 16-19 ans en Suède (Petersen et al, 2004). Cette constatationpourrait expliquer par un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et dépensées. Comme signale Regaieg et al. (2014) la différence entre les deux sexes pourrait être expliquée d'une part, par l'âge des enfants puisque, après un rebond pré-pubertaire, il y´a une augmentation de la masse grasse chez la fille alors que celle des garçons diminue. D'autres parts, les garçons à cet âge (15 à 20 ans) seraient plus actifs.
En effet, 25,93 % de la population dont 27,77% des filles et 23,57% des garçons passent 2 à 3 heures devant un écran télévisé en moyenne par jour pendant la semaine, ce qui est expliqué par lecomportement sédentaire chez les élèves. Cette sédentarité était plus accentuée pendant le week-end 39,06% (40 % des garçons et 40,28 % des filles) passent plus de 5 heures. Ces résultats de notre étude convergent avec celles trouvés dans les travaux de Fedala et al (2015).Toutefois, 19,69% de la population total pratique un sport qui nécessite une augmentation importante de rythme respiratoire (38,93% des garçons et 6,34% des filles). Il apparaît intuitivement évident que les sujets inactifs physiquement sont plus à risque de prendre du poids au cours du temps que les sujets physiquement actifs. Cette notion n’est cependant pas si simple à démontrer. En effet, la relation activité physique-obésité peut être considérée comme circulaire. Dans une étude danoise récente, la prise de poids au cours du temps était ainsi associée à une moins grande activité physique de loisirs à l’issue du suivi (Petersen et al, 2004). De plus, peu d’études ont utilisés des mesures objectives d’activité physique, telles que par exemple des enregistrements par accélérométrie ou cardio-fréquencemétrie. Ce type de mesure de l’activité physique serait nécessaire pour mieux comprendre, dans ce domaine, les relations entre la dose (d’activité physique) et la réponse (gain de poids corporel) (Wareham et al, 2005).
D'autres facteurs peuvent influencer le profil pondéral des enfants, tel que leur poids à la naissance (Bedoui et al, 2004). La prévalence du surpoids est plus importante en phase pubertaire. La différence entre garçons et filles, peut être expliquée par les particularités de la croissance liées au genre et l’évolution différente de la répartition de la masse grasse selon le sexe (Oulamara et al, 2009). Dans les pays industrialisés, cette différence entre les sexes est plus prononcée de façon variable, chez le garçon que chez la fille, ce qui a été rapporté par plusieurs études (Gaha et al, 2002).
Notre étude de recherche a révélé une corrélation significative (p < 0,01) entre l’Activité Physique et IMC, et entre la sédentarité et IMC chez les deux sexes. Cette association dévoile les bienfaits de l’activité physique sur la santé de la population en matière pondérale. En effet, la relation entre la sédentarité et l’obésité des adolescents a fait l’objet d’une revue de la littérature de Must et Tybor (2005), qui conclut à partir d’études prospectives, que l’augmentation de l’activité physique et la réduction des comportements sédentaires sont protecteurs vis-à-vis de la prise de poids chez l’enfant et l’adolescent. Bien que, le risque relatif à développer une obésité, représenté par l’odds ratio, ne soit pas toujours significatif, l’étude de Gortmaker et al (1996) montre que le risque présente une surcharge pondérale est 4,6 fois plus élevé pour les enfants regardant la télévision plus de 5 heures par jour comparativement aux enfants passant moins de 2 heures par jour devant l’écran. Dans le même ordre d’idée, chez les jeunes enfants australiens (6 ans) le risque de développer une surcharge pondérale à l’âge de 8 ans est augmenté de 40 % chaque heure supplémentaire passée devant la télévision Burke et al (2005). Cette relation reste significative après ajustement au poids de naissance, à l’indice de masse corporelle maternel, au statut de fumeur de la mère et au niveau d’activité physique. Le lien entre le déclin de l’activité physique et l’augmentation de la corpulence a été souvent observé (Kimm et al, 2005). De plus, plusieurs études transversales et longitudinales étayent le lien entre sédentarité et masse grasse, confirmant la relation entre la sédentarité et l’obésité chez les jeunes et la relation inverse.
En effet, ces résultats sont inquiétants dans la mesure où l’on sait que le temps passé devant un écran dépasse les 5h en moyenne par jour, d’où la prédisposition à un développement de surpoids et d’obésité. À ce titre, dans beaucoup de pays, les enfants et les adolescents sont actuellement encouragés à pratiquer une activité physique modérée.
La prévalence de la surcharge pondérale et de l'obésité chez l'enfant est en augmentation galopante. Les chiffres apportés par les différentes études nous incitent à tirer la sonnette d'alarme afin d'analyser les facteurs de risque de l'excès pondérale infantile dans le but de planifier et de mettre en place un programme de prévention entrepris très tôt les l'enfance.
Il paraît important d’informer les élèves sur les effets néfastes d’une exposition prolongée devant un écran, et de les encourager à pratiquer une activité physique modérée, afin de modifier les habitudes de sédentarité.
Références
Andersen, R., 1995 Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does it Matter? Journal of Health and Social Behavior. 36(1):1–10.
Bedoui A, Alouane L, Belhoula L. 2004. Influence de la période périnatale sur la genèse de l'obésité chez l'enfant d'âge scolaire. In XIIIéme Rencontre Scientifique de Nutrition, (résumé). Paris.
Burke, V., Beilin, L. J., Simmer, K., et al. 2005. Predictors of body mass index and associations with cardiovascular risk factors in Australian children: a prospective cohort study. International Journal of Obesity, 29(1), 15-23.
Charles, M. A. 2011. Obésité: que nous dit l’épidémiologie?. Cahiers de Nutrition et de Diététique, 46(4), 167-172.
Chiarelli, F., Marcovecchio, M. L. 2008. Insulin resistance and obesity in childhood. European Journal of Endocrinology, 159(suppl_1), S67-S74.
Fedala, N., Mekimene, L., Haddam, A. E. M., Fedala, N. S. 2015. Association entre l'indice de masse corporelle, l'activité physique et la sédentarité chez les adolescents algériens [The Association between Body Mass Index, and Physical Activity and sedentary of Algerian adolescents]. International Journal of Innovation and Applied Studies, 10(2), 489-497.
Gaha, R, Ghannem, H, Harrabi, I, Ben Abdelazi, A, Lazreg, F, HadjFredj, A. 2002. Study of overweight and obesity in a population of urban school children in Sousse, Tunisia. Arch Pediatr. 9(6): 566-571
Gortmaker, S. L., Must, A., Sobol, A. M., Peterson, K., Colditz, G. A., Dietz, W. H. 1996. Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 150(4), 356-362.
Gupta, N., Goel, K., Shah, P., Misra, A. 2012. Childhood obesity in developing countries: epidemiology, determinants, and prevention. Endocrine Reviews, 33(1), 48-70.
Kimm, S. Y., Glynn, N. W., Obarzanek, E., Kriska, A. M., Daniels, S. R., Barton, B. A., Liu, K. 2005. Relation between the changes in physical activity and body-mass index during adolescence: a multicentre longitudinal study. The Lancet, 366(9482), 301-307.
Kramoh, K. E., N’goran, Y. N. K., Aké-Traboulsi, E., et al, 2012. Prévalence de l’obésité en milieu scolaire en Côte d’Ivoire. Annales de Cardiologie et d'Angéiologie, 61, 145-149.
Krassas, G. E., Tzotzas, T., Tsametis, C., Konstantinidis, T. 2001. Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Thessaloniki, Greece. Journal of pediatric endocrinology & metabolism: JPEM, 14, 1319-26.
Must, A., Tybor, D. J. 2005. Physical activity and sedentary behavior: a review of longitudinal studies of weight and adiposity in youth. International journal of obesity, 29(2), S84-S96.
OMS (2002). Rapport sur la santé dans le monde : 2002 : réduire les risques et promouvoir une vie saine. Organisation mondiale de la Santé. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42522
OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 2010. Physical activity and health in Europe: evidence for action. Report of the Regional Office for Europe of the WHO.
Oulamara, H., Agli, A. N., Frelut, M. L. 2009. Changes in the prevalence of overweight, obesity and thinness in Algerian children between 2001 and 2006. International Journal of Pediatric Obesity, 4(4), 411-413.
Paffenbarger Jr, R. S., Hyde, R., Wing, A. L., Hsieh, C. C. 1986. Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. New England Journal of Medicine, 314(10), 605-613.
Petersen, L., Schnohr, P., Sørensen, T. I. A. 2004. Longitudinal study of the long-term relation between physical activity and obesity in adults. International journal of obesity, 28(1), 105-112.
Rahim, S., Baali, A., 2011, Étude de l’obésité et quelques facteurs associes chez un groupe de femmes marocaines résidentes de la ville de Smara (sud du Maroc). Antropo, 24, 43-53. www.didac.ehu.es/antropo
Regaieg, S., Charfi, N., Trabelsi, L., Kamoun, M., Feki, H., Yaich, S., Abid, M. 2014. Prévalence et facteurs de risque du surpoids et de l’obésité dans une population d’enfants scolarisés en milieu urbain à Sfax, Tunisie. Pan African Medical Journal, 17(1).
Sebbani, M., Elbouchti, I., Adarmouch, L., Amine, M. 2013. Prévalence de l’obésité et du surpoids chez les écoliers de primaire à Marrakech, Maroc. Revue d'épidémiologie et de santé publique, 61(6), 545-549.
Shephard, R.J., Balady, G.J., 1999. Exercise as cardiovascular therapy. Circulation. 99(7): 963-972
Souames, M., Brun, P., Losfeld, P. 2005. Surpoids et régime alimentaire chez l'adolescent: étude dans les collèges du département des Hauts-de-Seine. Archives de pédiatrie, 12(10), 1540-1543.
Thibault H, Rolland-Cachera MF. 2003. Prevention strategies of childhood obesity. Arch Pediatr. 10(12), 1100-1108.
Wareham, N. J., van Sluijs, E. M., Ekelund, U. 2005. Physical activity and obesity prevention: a review of the current evidence. Proceedings of the Nutrition Society, 64(2), 229-247.
