
Diallo, T., Diara, A., Coulibaly, S.K., Toure, A.A.P., Koumaré, B.Y., Maïga, A., 2020. Etude de l’usage rationel des pesticides dans l’agriculture periurbaine : cas de Baguineda au Mali. Antropo, 44, 41-47. www.didac.ehu.es/antropo
Etude de l’usage rationel des pesticides dans l’agriculture periurbaine : cas de Baguineda au Mali
Study of the rational use of pesticides in periurban agriculture: the case of Baguineda in Mali
Tidiane Diallo1,2*, Abdourahamane Diara1,3, Sanou Khô Coulibaly1,4, Alamine Alassane dit Papa Toure1, Benoit Yaranga Koumaré1,2, Ababacar Maïga1,3.
1Faculté de Pharmacie de Bamako, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, Mali.
2Laboratoire National de la Santé de Bamako, Mali.
3Institut National de Recherche en Santé Publique de Bamako, Mali.
4Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie de Bamako, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, Mali.
*Auteur correspondant : Docteur Tidiane Diallo. Email: tidiallo2017@gmail.com
Mots clés : Pesticides, Cultures maraîchères, Baguinéda, Mali.
Keywords: Pesticides, Vegetable crops, Baguinéda, Mali.
Résumé
Les pesticides sont utilisés dans les pays en développement en quantités excessives ou inadaptées et laissent ainsi inévitablement des résidus qui pourraient nuire à la santé humaine et à l’environnement.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques des maraîchers de Baguinéda quant à l’utilisation rationnelle des pesticides.
Une enquête a été réalisée auprès des 120 maraîchers. Le questionnaire a porté sur les pesticides utilisés, la préparation des solutions des pesticides, la protection des maraîchers pendant l’usage des pesticides, la gestion d’emballages des pesticides et les caractéristiques socio-professionnelles des maraîchers.
Les résultats ont montré que le maraîchage est généralement pratiqué par les hommes (100 %), et concerne principalement la culture des légumes fruits (salade, persil, aubergine et tomate). Les pesticides sont systématiquement appliqués, notamment les herbicides et les insecticides, à titre préventif et fréquemment.
La majorité de maraîchers n’a pas suivi une formation sur les pesticides (78 %), ne se protège pas adéquatement pendant l’usage des pesticides (84 %) et jette les emballages des pesticides au champ (30,83 %).
Au terme de notre étude, il ressort que les pesticides sont utilisés sans respect des bonnes pratiques d’utilisation. Cette pratique est liée à l’ignorance de la majeure partie des maraîchers. La formation des maraîchers de Baguinéda sur l’utilisation rationnelle des pesticides permettra de réduire les risques d’intoxication liés à l’usage non rationnel des pesticides.
Abstract
Pesticides are used in developing countries in excessive or inappropriate amounts and thus inevitably leave residues that could harm human health and the environment.
The objective of this study is to assess the knowledge, attitudes and practices of market gardeners in Baguinéda regarding the rational use of pesticides.
A survey was carried out among 120 market gardeners. The questionnaire covered the pesticides used, the preparation of pesticide solutions, the protection of market gardeners during the use of pesticides, the management of pesticide packaging and the socio-professional characteristics of market gardeners.
The results showed that market gardening is generally practiced by men (100 %), and mainly concerns the cultivation of fruit vegetables (salad, parsley, eggplant and tomato). Pesticides are systematically applied, including herbicides and insecticides, preventively and frequently.
The majority of market gardeners have not received training on pesticides (78 %), do not protect themselves adequately while using pesticides (84 %) and throw away pesticide packaging in the field (30.83 %).
At the end of our study, it appears that pesticides are used without respecting good use practices. This practice is linked to the ignorance of most of the market gardeners. Training Baguinéda market gardeners on the rational use of pesticides will reduce the risks of poisoning linked to the non-rational use of pesticides.
Introduction
Les pesticides désignent tous les produits chimiques ou biologiques destinés à détruire des éléments vivants considérés comme nuisibles (microbes, animaux ou végétaux) ou destinés à s’opposer à leur développement (Idrissi et al, 2010).
Afin de répondre à une demande croissante et atteindre des niveaux de production économiquement viables, les maraîchers utilisent des pesticides contre les phytophages, les attaques parasitaires et les maladies fongiques. Parmi la gamme de pesticides utilisés, les insecticides se retrouvent en tête suivis des fongicides. Si l’utilisation de ces produits est souvent nécessaire pour que les producteurs atteignent leurs objectifs de production, il demeure important de rappeler que les pesticides sont toxiques et leur usage ne saurait être admis ou encourager qu’à condition de maîtriser parfaitement les modes d’usage ainsi que les risques pour la santé humaine et les milieux naturels susceptibles d’être affectés. En effet les pesticides sont utilisés dans les pays en développement en quantités excessives ou inadaptées et la récolte des fruits et légumes est faite sans respect des délais de sécurité. Ils laissent ainsi, inévitablement des résidus qui pourraient nuire à la santé humaine et à l’environnement (Kanda et al, 2013).
De 1990 à 2010, il y a eu une augmentation de plus de 261 % des importations de pesticide en Afrique (Bon, 2016). Cette situation concerne aussi le Mali, car plus de 5400 tonnes de pesticide sont utilisés par an, soit une valeur sur le marché de 17 milliards de FCFA. La part de l’agriculture s’élève à 90 % de l’ensemble des pesticides utilisés au Mali (PAN, 2006).
De nombreux pesticides autorisés sont connus comme étant très dangereux pour la santé, cancérigènes possibles, des perturbateurs du système hormonal, reprotoxiques…, par les agences sanitaires officielles de l’Union Européenne et des Etats-Unis. De nos jours, nous assistons à une utilisation des pesticides sans aucune mesure réglementaire des bonnes pratiques d’utilisations. Ces actes peuvent être les causes d’intoxication aux pesticides. L’emploi des pesticides doit se faire selon les bonnes pratiques agricoles et de vente afin de protéger la santé des utilisateurs (FAO, 2002).
Au Mali, les pesticides sont parfois abandonnés en plein air ou gardés dans des magasins inadaptés. La population s’intoxique par l’utilisation des anciens récipients pour des travaux domestiques (réservoir d’eau, ustensiles de cuisine...) et/ou par la consommation d’aliments mal traités. Les utilisateurs s’intoxiquent à travers des mauvaises pratiques : non utilisation des EPI et les bonnes pratiques d’utilisation de ces produits (déconditionnement, stockage,…).
Methodologie
Il s’agissait d’une étude transversale prospective sur l’évaluation des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des maraichers sur l’usage rationnel des pesticides à Baguinéda.
Etaient inclus dans notre étude, les hommes et femmes maraichers dont la tranche d’âge est comprise entre 18 et 60 ans et qui utilisaient les pesticides pour le traitement et l’entretien de leur surface de culture.
N’étaient pas inclus de l’étude les maraichers qui n’ont pas utilisés les pesticides au moins de deux ans et les cas de refus. La taille de notre échantillon était constituée de 12 maraichers par village soit 120 maraichers dans dix villages de Baguinéda et environ où cette activité était menée. Nous avions procédé à un échantillonnage exhaustif par inclusion de tous les maraichers répondant à nos critères d’étude. Afin de collecter les données, nous avions commencé par introduire à l’aide d’un questionnaire qui avait pris en compte :
- Les paramètres sociodémographiques des enquêtés ;
- Les pesticides utilisés dans le traitement des parcelles ;
- Les connaissances, attitudes et pratiques des maraîchers sur l’usage rationnel des pesticides.
- Le consentement éclairé des enquêtés a été demandé pour leurs inclusions dans l’étude. Il a été expliqué à tous les participants les intérêts de l’étude, ainsi leur participation était libre et volontaire. Les informations recueillies ont été traitées dans l’anonymat et la confidentialité.
Les données collectées sur tablette à l’aide du logiciel Excel ensuite transférer sur un ordinateur dans un logiciel Word puis analyser à l’aide du logiciel Epi-Info version 7.1.5.
Resultats
Les données sociodémographiques des maraichers à Bamako et Baguinéda
Nos résultats ont montré qu’à Baguinéda 100 % des maraîchers étaient de sexe masculin, la tranche d’âge 40 à 49 ans était la plus représentative avec 27,5 % ; 48,3 % n’avaient aucun niveau scolaire et 45,8 % des maraichers avaient plus de 25 ans d’expérience professionnelle.
|
Variable |
N (%) |
|
Sexe |
|
|
Homme |
120 (100) |
|
Femme |
0 (0) |
|
Tranche d’âge |
|
|
20 à 29 |
15 (12,5) |
|
30 à 39 |
30 (25,0) |
|
40 à 49 |
33 (27,5) |
|
50 à 59 |
18 (15,0) |
|
≥ 60 ans |
22 (18,3) |
|
Niveau d'étude |
|
|
Aucun |
58 (48,3) |
|
Primaire |
27 (22,5) |
|
Secondaire |
27 (22,5) |
|
Supérieur |
8 (6,7) |
|
Expérience professionnelle |
|
|
Moins de 3 ans |
2 (1,7) |
|
3 à 10 ans |
20 (16,7) |
|
10 à 25 ans |
43 (35,8) |
|
Plus de 25 ans |
55 (45,8) |
Tableau 1. Données sociodémographiques des maraichers (Baguinéda, N : 120).
Table 1. Socio-demographic data of market gardeners (Baguinéda, N: 120).
Mesures de protection lors des traitements phytosanitaires
Dans notre étude 75 % de la population à Baguinéda utilisaient au moins le masque comme moyen de protection pendant le traitement des cultures.
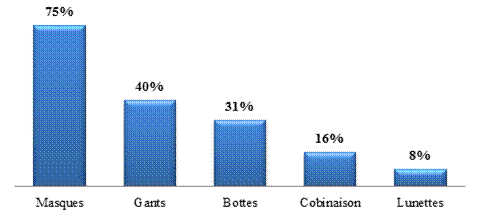
Figure 1. Utilisation des EPI par les maraichers
Figure 1. PPE use by market gardeners
Gestion des emballages par les maraîchers
Dans notre étude 30,83 % des maraichers jetaient les emballages vides au champ, 16,66 % les brulaient.
|
Variable |
N (%) |
|
Gestion des emballages (plastiques) après usages |
|
|
Jetés au champ |
37 (30,83) |
|
Enterrés ou jetés dans une décharge |
28 (23,33) |
|
Brulés |
20 (16,66) |
|
Enterrés au champ |
17 (14,16) |
|
Jetés dans une décharge |
9 (7,50) |
|
Garder au champ pour réutilisés |
4 (3,33) |
|
Coupés puis jetés |
2 (1,66) |
|
Enterrés dans une décharge |
2 (1,66) |
|
Jetés près du canal |
1 (0,83) |
|
Réutilisés après lavage |
1 (0,83) |
Tableau 2. Conduites à tenir par les maraichers après usage (Baguinéda, N : 120).
Table 2. Post-use behaviour of market gardeners (Baguinéda, N: 120).
Problèmes sanitaires rencontrés par les maraichers
Les résultats de notre étude ont montré qu’à Baguinéda 24 % des maraichers ressentaient des maux de têtes après le traitement des cultures.
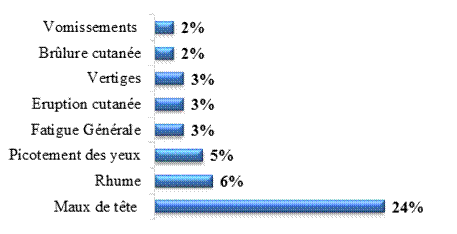
Figure 2. Différents problèmes de santé rencontrés par les maraichers
Figure 2. Different health problems encountered by market gardeners
Répartition des maraîchers en fonction des mesures prophylactiques
Nous avions trouvé que dès l’apparition des premiers symptômes d’intoxication à Baguinéda 18 % des maraichers prenaient du lait. De telles pratiques sont dangereuses car les aliments riches en lipides peuvent favoriser l’absorption des substances toxiques moins lipophiles par l’organisme.
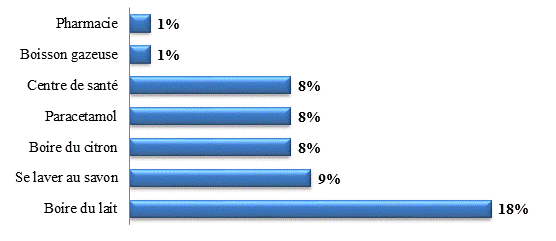
Figure 3. Pratique effectuée par les maraichers lors d’un problème de santé
Figure 3. Practice performed by market gardeners during a health problem
Discussion
Dans notre étude 100 % des maraichers étaient de sexe masculin. Ce résultat superposable à celui de Toe (2010) au Burkina Faso qui avait trouvé 98,3%. Cette forte proportion des hommes s’explique par le fait que les femmes ne sont généralement pas habilitées à appliquer le traitement phytosanitaire dont exigent ces cultures. En effet, le traitement phytosanitaire est fastidieux (acquérir le produit, préparer la solution et l’appliquer au moyen d’un pulvérisateur), et compliquer pour les non-initiés. Toutefois, nous avons noté une présence effective des femmes dans les exploitations où elles s’adonnent parfois à la cueillette, à l’arrosage et à la commercialisation des denrées récoltées.
La tranche d’âge la plus représentée avec 27,5 % des maraichers était de 40 à 49 ans. Ces résultats sont identiques à ceux de Toe (2010) au Burkina Faso qui avait trouvé 29,4 % pour les maraichers de 40 à 50 ans. Ce phénomène s’explique par le fait que ce secteur demande une fraicheur physique du fait de la pénibilité des travaux champêtres. Il a été retrouvé à la suite de l’enquête que 48,3 % des maraichers n’ont aucun niveau scolaire. Ces résultats sont similaires à celui de Wade (2003) à Dakar qui avait trouvé 55 %. Cela s’explique par le fait que les individus à faible niveau d’instruction ont des difficultés à trouver un emploi dans le secteur formel, ce qui justifie en partie leur forte représentativité dans le maraîchage où l’activité n’exige pas de compétence spécifique.
Avec des moyens de protection dérisoires, les maraichers travaillent dans des conditions alarmantes car étant exposés à un niveau de risque élevé d’intoxication par les pesticides. En effet nos résultats obtenus montrent de façon globale que seulement 16 % utilisent la combinaison complète, et 75 % de la population utilisaient au moins le masque comme moyen de protection pendant le traitement des cultures. Ces résultats sont similaires à celui d’une étude menée au Togo ou 84 % des maraichers portent des masques (Kanda et al, 2013).
Les champs des maraîchers étant majoritairement installés le long de cours d’eau pour des facilités d’arrosage, une partie des emballages abandonnés au champ finit dans le cours d’eau emportés par des vents violents ou des eaux de ruissellement. Il en est de même pour des pesticides accumulés dans le sol qui, après des fortes pluies, sont charriés dans les eaux du ruissellement vers les cours d’eau et des particules volatiles pendant le traitement dont certaines se déposent directement dans les cours d’eau.
Il a été trouvé dans notre étude que 30,83 % des maraichers jetaient les emballages vides au champ. Ces résultats sont similaires à celui d’une étude [9] au Cameroun ou 37,96% des maraichers jetaient les emballages vides au champ (Tchamadeu et al, 2017).
Selon une étude (Congo, 2013), cette pratique (déchets des pesticides et matériels contaminés y compris) n’est pas bonne car pendant la combustion, certains pesticides produisent des fumées hautement toxiques dont l’inhalation et/ou le contact sont nocifs pour l’homme et les animaux. De même, l’auteur souligne que l’enfouissement des emballages (pratiqué par 15,82 % des maraichers), des reliquats et déchets de pesticides présentent le risque de contamination des nappes souterraines.
De plus les résultats des malaises recensés, (maux de tête 24 %, rhume 6 %, picotement des yeux 5 %) et l’absence totale d’accident ni de maladies liées aux pesticides tendent à montrer un niveau de connaissance satisfaisant sur la toxicité des produits. Des résultats similaires sont rapportés au Bénin qui stipulent que les paysans ont une connaissance des risques liés aux produits même s’ils ne connaissent pas les effets sur les insectes et les plantes (Fayomi et al, 1998).
A la suite d’un malaise 18 % des maraichers buvaient du lait, seulement 8 % des maraichers se rendaient dans un centre de santé. Ces résultats sont similaires à celui d’une étude menée au Togo où l’auteur avait trouvé que 6% des maraichers se rendaient dans un centre de santé (Guissou, 1985). Il est a noté que certains utilisent des moyens locaux pour pallier les malaises ressentis : se laver au savon, boire du citron ou prendre des médicaments traditionnels. Ces mauvaises pratiques constituent des facteurs de risques d’intoxication. Dans une étude intitulée le lait : moyen de lutte contre les intoxications (Guissou, 1985), l’auteur ajoute que le seul cas objectif pour lequel le lait peut être utilisé comme antitoxique est celui de l’intoxication aux fluorures. Donc de telles pratiques sont dangereuses car les aliments riches en lipides (substances lipophiles) peuvent favoriser l’absorption des substances toxiques moins lipophiles (insecticides) par l’organisme entraînant ainsi une aggravation de l’intoxication (Dümmler et Schwab, 1993).
Conclusion
Les maraîchers peu instruit pratiquent une agriculture maraîchère à risques fondée sur un comportement empirique en ce qui est de l’utilisation des pesticides et de la gestion des effets néfastes issus de cette utilisation, mais également des emballages. La diversité des modes de traitements phytosanitaires s’explique par la non-formation des exploitants.
L’application des pesticides nécessite beaucoup de précautions, mais surtout une maîtrise des bonnes pratiques en la matière.
Références bibliographiques
Bon, H., 2016. Pratiques d’utilisation des pesticides par les producteurs agricoles en Afrique Sub-saharienne. https://www.aprifel.com/wp-content/uploads/2020/08/debon_cirad.pdf
Congo, A. K. 2013. Risques sanitaires associés à l’utilisation de pesticides autour de petites retenues: cas du barrage de Loumbila. Thèse de Master, Ingénierie de l’eau et de l’environnement, Institut International d’Ingénierie, Ouagadougou, Burkina Faso.
Dümmler, C., Schwab, A., 1993. Pesticides et agriculture tropicale: dangers et alternatives. Margraf. Weikersheim, Germany.
FAO. 2002. Directives sur la bonne pratique de l’application terrestre de pesticides. http://www.fao.org/3/Y2767F/Y2767F00.htm
Fayomi, B., Lafia, E., Fourn, L., Akpona, S., Zohoun, T. 1998. Connaissance et comportement des utilisateurs de pesticides au Bénin. Afr Newsl, 2, 40-43.
Guissou, I.P., 1985. Le lait : moyen de lutte contre les intoxications. Notes et documents burkinabè. 16(1) : 2-6.
Idrissi M., Aït Daoud N., Bencheikh SR. 2010. Pesticides, définition et classification. Toxicologie Maroc. 4, 3-4
Kanda, M., Djaneye-Boundjou, G., Wala, K., Gnandi, K., Batawila, K., Sanni, A., Akpagana, K. 2013. Application des pesticides en agriculture maraîchère au Togo. VertigO: la revue électronique en sciences de l’environnement, 13(1).
PAN (Pesticide Action Network, Africa). 2006. Identification des acteurs impliqués dans la gestion des pesticides au Mali. Rapport provisoire. http://www.on-mali.org/pdf/mali_rapportidacteursfinal.pdf
Tchamadeu, N. N., Nkontcheu, D. B. N., Nana, E. D. 2017. Evaluation des facteurs de risques environnementaux liés à la mauvaise utilisation des pesticides par les maraîchers au Cameroun: le cas de Balessing à l’Ouest Cameroun. Afrique science, 13(1), 91-100.
Toe, A.M., 2010. Étude pilote des intoxications dues aux pesticides agricoles au Burkina Faso. Secrétariat de la Convention de Rotterdam. Final report. http://www.pic.int/Portals/5/Workshop/Burkina/Rapport%20final%20SHPF_Burkina_Fr.doc
Wade, C.S., 2003 L’utilisation des pesticides dans l’agriculture périurbaine et son impact sur l’environnement: étude menée dans la région de Thiès. Thèse de pharmacie, Dakar: UCAD.