
Kaoutar, K., Hilali, M.K., Loukid, M., 2019. Insatisfaction corporelle, et attitude à l’égard de poids chez l’adolescent scolarisé au Maroc. Antropo, 42, 45-53. www.didac.ehu.es/antropo
Insatisfaction corporelle, et attitude à l’égard de poids chez l’adolescent scolarisé au Maroc
Body dissatisfaction and attitude towards weight among Moroccan school-adolescents
Kamal Kaoutar, Mohamed Kamal Hilali, Mohamed Loukid
Laboratoire d’Ecologie Humaine, Département de Biologie, Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
Correspondence: Dr Kamal Kaoutar, Laboratoire d’Ecologie Humaine, département de Biologie, Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. Kamal.kaoutar@edu.uca.ma
Mots-clés: Insatisfaction corporelle, Attitude à l’égard de poids, Adolescent scolarisé, Maroc.
Keywords: Body dissatisfaction, Attitude towards weight, School-aged adolescent, Morocco.
Résumé
Objectif : Evaluer l’association entre l’état nutritionnel, l’image du corps et l’insatisfaction corporelle d’un groupe d’adolescents marocains.
Echantillon : 1.407 adolescents scolarisés âgés de 12 à 18 ans dont 656 garçons (46,6%) et 751 filles (53,4%).
Méthodes : Les données de notre étude proviennent d’une enquête par questionnaire et des mesures anthropométriques, réalisée en 2010. Les variables retenues sont l'âge, le sexe, l'état nutritionnel et l’insatisfaction corporelle.
Résultats : Dans l’ensemble des adolescents enquêtés, 34,8% étaient insatisfaits de leur corpulence. Selon le sexe, 42,7% des filles sont insatisfaites de leur corps contre seulement 25,8% des garçons. 68,2% des adolescents âgés de 10 à 12 ans perçoivent leur poids corporel normal, alors que 23% des adolescents âgés de 16 à 18 ans le perçoivent élevé. La perception d’un poids normal concerne spécialement les adolescents du groupe défavorisé que leurs homologues du groupe favorisé, soit respectivement 77,6% et 58,6%. L’étude de l’attitude à l’égard du poids selon l’état nutritionnel des adolescents montre que 40,6% des adolescents maigres souhaitent gagner du poids, 70,1% des normo- pondéraux souhaitent maintenir leur poids actuel. Tandis que, 79,4% des adolescents en surpoids désirent aussi le perdre. En effet, ce sont les maigres et ceux en surcharge pondérale qui sont les plus nombreux parmi les adolescents exprimant une insatisfaction corporelle. La présente étude confirme une forte association entre l’IMC et l’insatisfaction à l’égard de la silhouette, tant chez les garçons (χ² = 195,20 ; p < 0,001) que chez les filles (χ² = 148,41 ; p < 0,001).
Conclusion : Les différences observées trouvent sens à travers l’analyse, qui souligne l’impact majeur des modèles socioculturels sur l’appréhension « subjective » du corps. Elles montrent la nécessité de prendre en compte les modèles culturels qui s’appliquent aux corps féminins et masculins.
Abstract
Objective: To assess the association between the nutritional status, the body image and the body dissatisfaction of a group of Moroccan adolescents.
Sample: 1407 school-aged adolescents aged 12 to 18, including 656 boys (46.6%) and 751 girls (53.4%).
Results: Overall, 34.8% of the adolescents surveyed were dissatisfied with their corpulence. By gender, girls are more dissatisfied with their bodies than boys. They are more likely to perceive a high weight than boys 42.7% against 25.8%. The study of weight perception by age group shows that 68.2% of adolescents aged 10 to 12 years perceive at normal body weight, 23% of adolescents aged 16 to 18 years perceive at high body weight. The perception of normal weight especially concerns adolescents in the disadvantaged group than their counterparts in the advantaged group, 77.6% and 58.6% respectively. The study of the attitude towards weight according to the nutritional status of adolescents shows that 40.6% of skinny adolescents want to gain weight, 70.1% of normal weight want to maintain their current weight. While, 79.4% of overweight teens also want to lose it. Indeed, it is the skinny and those who are overweight who are the most numerous among adolescents expressing bodily dissatisfaction. The present study confirms a strong association between BMI and dissatisfaction with the silhouette, both in boys (χ² = 195.20; p <0.001) and in girls (χ² = 148.41; p<0.001).
Conclusion: The differences observed find meaning in the analysis, which highlights the major impact of socio-cultural models on the "subjective" apprehension of the body. They show the need to take into account the cultural models that apply to female and male bodies.
Introduction
L’adolescence, dont l’étymologie vient du latin « adolescentia » signifie « grandir vers » (Cloutier et al., 2008). Il s’agit de la période intermédiaire séparant l’enfance de l’âge adulte et caractérisée par des transformations chez l’individu. La puberté correspond aux processus biologiques menant à la capacité de procréer du jeune adulte. Elle entraine de nombreuses transformations corporelles dont certaines sont apparentes comme la taille, la proportion des tissus corporels (adipeux et musculaires) ou les caractéristiques sexuelles secondaires. A côté des transformations physiques que peut endurer l’adolescent, son activité mentale connait également une restructuration importante avec l’avènement de nouveaux outils de pensée sur le plan de l’environnement physique et social (Cloutier et al., 2008).
Selon Cloutier et al. (2008), l’image corporelle correspond à la perception que l’individu a de son propre corps. Il s’agit de la somme des jugements conscients et inconscients que nous portons à l’égard de notre corps (Beyeler et al., 2006). Elle peut être plus ou moins négative selon la perception que l’on a de corps. Lorsqu’elle est négative, on parle de l’insatisfaction corporelle (Rousseau et al., 2011). En effet, Le corps perçu est la manière dont les individus se classent et évaluent leur poids (maigre, normal, trop gros...) (Rousseau et al., 2011). La différence entre le corps perçu et le corps désiré permet d’évaluer l’insatisfaction corporelle. Celle-ci constitue une notion indispensable pour étudier comment les individus perçoivent leur corps (Cash, 2002). Le surpoids pourrait entrainer chez l'individu de l’insatisfaction à l'égard de son corps ; sentiment extrêmement courant pendant l’adolescence, (Devaud et al., 1994 ; Ricciardelli et McCabe, 2001 ; Smolak et Levine, 2002), ce qui pourrait favoriser ainsi le développement, le maintien et le renouvellement de troubles alimentaires : pratique des régimes en vue de réduire son poids corporel (Neumark-Sztainer et Hannan, 2000; Stice et al., 2000 ; Calderon et al., 2004) et atteindre le corps idéal. En effet, l’image du corps, attitude de chacun envers son propre corps, en particulier sa taille, sa forme et son esthétique (Cash et Pruzinsky, 1990) semble fortement corrélé, de tous les facteurs associés, à l’indice de masse corporelle (Friedman et Brownell, 1995 ; McCabe et Ricciardelli, 2003 ; Paxton et al., 2006 ; Baali et al, 2013). Ainsi, les actions de gain ou de perte du poids corporel entreprises par les adolescents, par l’adoption de régimes alimentaires sont associées à leur corpulence (ou IMC) et au degré de satisfaction corporelle (Ledoux et al., 2002). Mais, ces comportements auront à long terme des répercussions négatives sur la santé de l'adolescent (anxiété, troubles métaboliques et alimentaires…). Ainsi, l’objectif de notre étude est d’évaluer, auprès d’un groupe d’adolescents, la relation entre l’état nutritionnel, le surpoids et l’insatisfaction corporelle.
Méthodes
Type et population d’étude
Il s’agissait d’une enquête transversale dont la population d’étude était constituée de 1.407 enfants et adolescents scolarisés habitant la ville de Marrakech et 3 communes rurales Amzmiz, Tahnaoute et Tamslohte, âgés de 12 à 18 ans. Cette population a été sélectionnée de manière aléatoire selon un plan d’échantillonnage stratifié en grappes à deux niveaux. Ainsi, ont été sélectionnés successivement un échantillon de collèges et lycées (réparties par communes) puis un échantillon des classes dans chaque collège ou lycée sélectionnés. Les élèves âgés de moins de 12 ans ou de plus de 18 ans et ceux ayant des données incomplètes, aberrantes ou absentes n’ont pas été inclus.
Mesures anthropométriques
L’enquête s’est déroulée pendant les séances d’éducation physique suivant un planning établi au préalable avec les responsables de chaque établissement.
Pour chaque enfant, nous avons relevé : la taille, en cm, à l’aide d’une toise verticale, graduée de 0,1 cm ; le poids, en kg, par une balance pèse-personne correctement tarée et suffisamment précise (type Seca, précision de 0,1 kg).
Les mensurations ont été prises sur les enfants à torse nu sans chaussures. Les instruments de mesures sont vérifiés régulièrement et changés en cas de nécessité.
Analyses statistiques
L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel SPSS version 19.0. L’analyse statistique a consisté en des comparaisons de fréquences (test du χ2) et de moyennes (test de Student). Le seuil de signification a été fixé à 0,05.
Pour comprendre les différentes associations entre les variables définissant l’environnement socio-économique, nous avons appliqué l’analyse factorielle des correspondances multiples. Cette méthode permet la description des relations entre plusieurs variables qualitatives classées en modalités et la synthèse des associations qu’elles entretiennent entre elles. L’algorithme utilisé, par cette méthode, permet l’extraction d’un nombre limité de facteurs décrivant la matrice multidimensionnelle tout en minimisant la perte de l’information brute. La méthode est basée sur l’analyse d’homogénéité par les moyennes de moindres carrés alternés (homogeneity analysis by means of alternating least squares).
Résultats et discussion
Les variables introduites dans l’analyse factorielle des correspondances multiples ainsi que leurs modalités sont résumées dans le tableau 1.
Les valeurs propres des deux premiers facteurs, qui résument le plus l’ensemble de l’information introduite, sont de 0,427 pour le premier facteur (axe horizontal) et de 0,184 pour le deuxième (axe vertical).
La contribution des différentes variables à ces deux facteurs est représentée par la figure 1. Il en ressort que la profession du père, l’activité de la mère, le niveau d’instruction du père, la densité et le milieu de résidence contribuent particulièrement au premier facteur alors que le moyen de transport familial et le type d’habitat n’affichent pas de différence importante entre les deux facteurs. Le type de ménage et la cohabitation entre ménages sont proches de l’origine des deux dimensions de l’analyse.
|
Variables |
Modalités |
|
Profession du père
|
- CSP1(les grands commerçants et les professions libérales) ; - CSP2 (les fonctionnaires et les cadres) ; - CSP3 (les artisans, les salariés, les ouvriers, les employés, les agriculteurs, les manœuvres, les chauffeurs de taxi et de camions¸ les aides commerçant et les journaliers ou saisonniers). |
|
Activité de la mère
|
- Mère active - Mère au foyer |
|
Niveau d’instruction du père |
- Analphabète (niv1) - Coranique/ primaire (niv2) - Secondaire /supérieur (niv3) |
|
Densité
|
- Densité faible - Densité élevé |
|
Milieu de résidence |
- Urbain - Rural |
|
Moyen de transport familial
|
- Aucun - Vélo - Moto - Voiture |
|
Type d’habitat
|
- Villa - Maison individuelle - Appartement - Maison en pisé |
|
Cohabitation entre ménages
|
- Ménage simple - Cohabitation de deux ménages - Ménages multiples |
|
Taille de ménage
|
- Famille réduite (2 à 3 personnes) - Famille moyenne (4 à 6 personnes) - Famille nombreuse (7 personnes et plus) |
Tableau 1. Modalités des variables socio-économiques introduites dans l’analyse des correspondances.
Table 1. Modalities of the socio-economic variables introduced in the correspondence analysis.
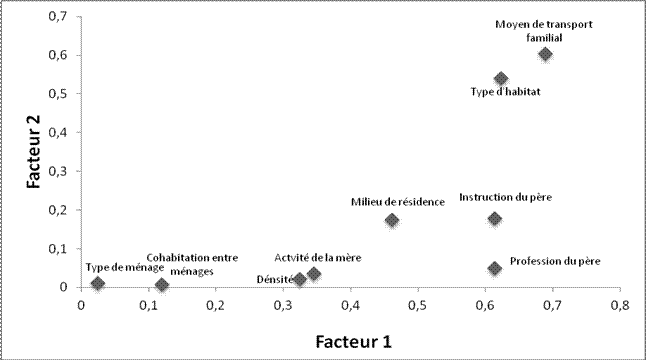
Figure 1. Contribution des variables socio-économiques aux deux premiers facteurs de l'AFC.
Figure 1. Contribution of socio-economic variables to the first two factors of AFC.
Il ressort de cette analyse, une forte corrélation entre le niveau socio-économique du père, le niveau d’instruction du père, l’activité de la mère, la densité et le milieu de résidence. On constate une opposition nette selon l’axe 1 par rapport à l’origine. Ainsi, deux groupes s’individualisent:
- un premier groupe ou groupe « favorisé » constitué des pères fonctionnaires, grands commerçants et ceux exerçant une profession libérale, d’un niveau d’instruction élevé, avec des mères actives et une densité faible.
- un deuxième groupe ou groupe « défavorisé », associe les pères artisans, salariés, ouvriers, employés, agriculteurs, manœuvres, chauffeurs de taxi et de camions, aides commerçants, d’un niveau d’instruction primaire ou analphabètes, avec les mères au foyer et une densité élevée.
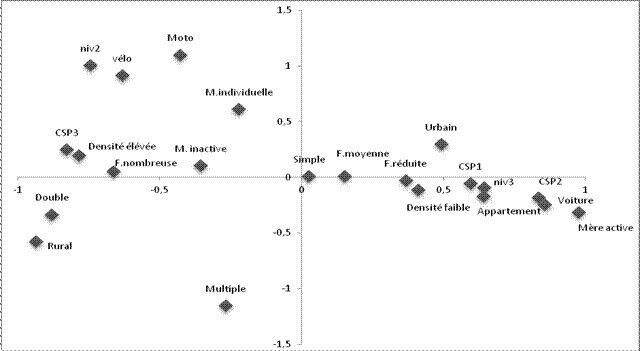
Figure 2. Association des différentes caractéristiques socio-économiques, obtenue par l'AFC.
Figure 2. Association of different socio-economic characteristics, obtained by the AFC.
Perception pondérale
Perception pondérale par genre
Dans l’ensemble des adolescents enquêtés, 34,8% étaient insatisfaits de leur corpulence. Cette insatisfaction est beaucoup plus observée chez les filles que chez les garçons. En effet, 42,7% des filles perçoivent leur poids élevé contre seulement 25,8% des garçons (Figure 3).
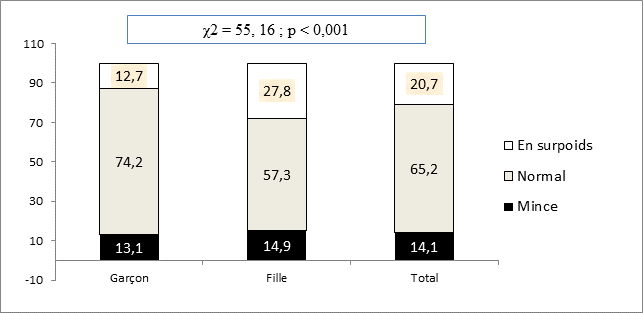
Figure 3. Perception pondérale par genre.
Figure 3. Weight perception by gender.
Le même constat a été trouvé dans d’autres études maghrébines et européennes. En Tunisie, les filles étaient moins satisfaites de leur apparence physique que les garçons (27% contre 19%) et avaient plus peur de prendre de poids (24% contre 13%) (Ben Abdelaziz et al., 2002). En Algérie, 56% des adolescents se percevaient normaux pondéraux, alors que 32% se percevaient plus gros. Les filles sont plus nombreuses à se voir en surpoids ou obèses que les garçons (36% contre 27%). Cependant les garçons se voient plus en corpulence normale par rapport aux filles (62% contre 51%) (SEMEP, 2009). Dans une étude suisse réalisée en 2006, 59,4% des garçons et 53,1% des filles de 11 à 15 ans se disent à peu près du bon poids. Les filles (36%) sont proportionnellement plus nombreuses que les garçons (24,1%) à se trouver un peu ou beaucoup trop grosses. A l’inverse, la proportion de garçons qui déplorent une certaine maigreur (16,5%) est plus élevée que celle des filles ayant la même perception (10,8%). Les préoccupations relatives au poids sont dans l’ensemble plus marquées chez les filles que chez les garçons et elles s’accroissent entre les groupes d’âge chez les filles (Delgrande Jordan et Annaheim, 2009).
Perception pondérale par classe d’âge et par groupe socioéconomique
L’étude de la perception pondérale par classes d’âge montre que 68,2% des adolescents âgés de 10 à 12 ans perçoivent leur poids corporel normal, 23% des adolescents âgés de 16 à 18 ans perçoivent leur poids corporel élevé (figure 4). La perception d’un poids normal concerne spécialement les adolescents du groupe socioéconomiquement défavorisé que leurs homologues du groupe favorisé, soit respectivement 77,6% et 58,6%.
Cependant, la proportion des adolescents qui perçoivent un poids élevé est importante chez les adolescents du groupe favorisé par rapport à ceux issus du groupe défavorisé, soit respectivement 25,9% et 11,1% (figure 4).
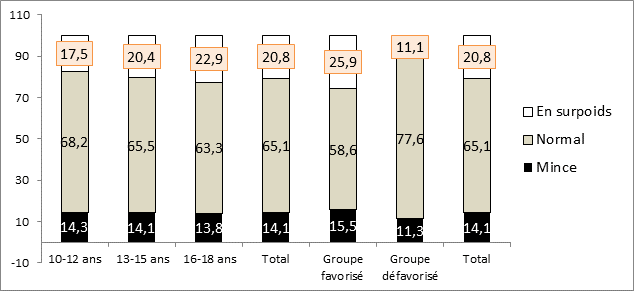
Figure 4. Perception pondérale par classe d’âge et par groupe socioéconomique.
Figure 4. Weight perception by age and socioeconomic group.
Attitude à l’égard du poids et état nutritionnel
L’étude de l’attitude à l’égard du poids selon l’état nutritionnel des adolescents montre que 40,6% des adolescents maigres souhaitent gagner du poids, 70,1% des normo- pondéraux souhaitent maintenir leur poids actuel. Tandis que, 79,4% des adolescents en surpoids désirent aussi le perdre. En effet, ce sont les maigres et ceux en surcharge pondérale qui sont les plus nombreux parmi les adolescents exprimant une insatisfaction corporelle.
Plusieurs recherches ont précédemment établi un lien entre l’IMC et l’insatisfaction de l’image corporelle (McCabe et Ricciardelli, 2003; Ohring et al., 2002; Presnell et al., 2004). La présente étude confirme une forte association entre l’IMC et l’insatisfaction à l’égard de la silhouette, tant chez les garçons (χ² = 195,20 ; p < 0,001) que chez les filles (χ² = 148,41 ; p < 0,001) (Figures 5 et 6).
Il n’est pas surprenant de remarquer que celles qui présentent un surplus de poids, soit de l’embonpoint ou de l’obésité, désirent de façon quasi unanime une silhouette plus mince. On peut par ailleurs constater que 14,2 % des filles de poids normal désirent gagner de poids et 24,2 % désirent une silhouette plus mince.
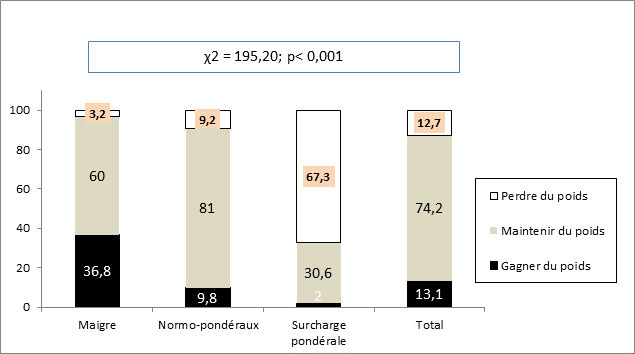
Figure 5. Insatisfaction à l'égard de sa silhouette selon l’IMC chez les garçons.
Figure 5. Dissatisfaction with Body Shape by BMI for Boys.
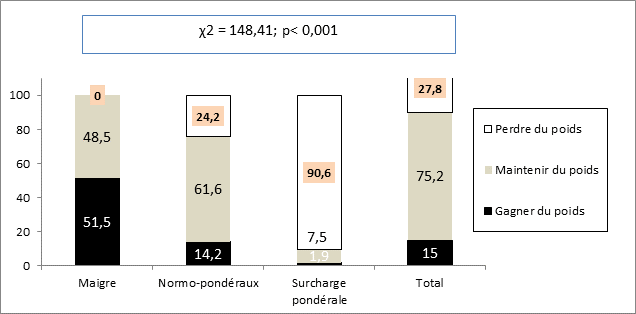
Figure 6. Insatisfaction à l'égard de la silhouette selon l’IMC chez les filles.
Figure 6. Dissatisfaction with Body Shape by BMI for Girls.
Conclusions
Dans notre étude, filles et garçons se distinguent, de manière très nette, en ce qui concerne l’auto-évaluation de leur corpulence, les filles se percevaient comme plus « grosses », en moyenne, que les garçons. D’un autre côté, lorsque l’on met en relation l’auto-évaluation de la corpulence et l’IMC, La présente étude confirme une forte association entre l’IMC et l’insatisfaction à l’égard de la silhouette, tant chez les garçons que chez les filles. Les différences observées trouvent sens à travers l’analyse, qui souligne l’impact majeur des modèles socioculturels sur l’appréhension « subjective » du corps. Elles montrent la nécessité de prendre en compte les modèles culturels qui s’appliquent aux corps féminins et masculins.
Remerciements. Nous tenons à remercier très vivement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, particulièrement les directeurs, les professeurs et les élèves ainsi que la Direction de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la Région Marrakech Tensift-Al Haouz.
Références bibliographiques
Baali A., Amor H., Omghar S., Rovillé-Sausse F., 2013. Satisfaction corporelle et genre : étude d’un groupe de marocains adultes de la ville de Marrakech, Maroc. Biométrie Humaine et Anthropologie, 31, 83-89.
Ben Abdelaziz A., Lazreg F., Gaha R., Bel Aid S., Ghannem H., 2002. Le comportement alimentaire des adolescents scolarisés en milieu urbain (Sousse-Tunisie). MHA (Sousse), 14(40), 45-50.
Beyeler SL., Bigler-Perrotin, et al., 2006. L’image corporelle, un concept de soins. ISC Image Corporelle / DSI / HUG. Genève.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/direction_des_soins/documents/concept_ic_22oct06.pdf
Calderon, LL., Yu, CK., Jambbazian P., 2004. Dieting practices in high school students. Journal of the American Dietetic Association, 104, 1369-1374.
Cash, T. F., 2002. A “negative body image”: Evaluating epidemiological evidence. Dans Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice, édité par T. Cash and T. Pruzinsky (New York: The Guilford press) p 269-276.
Cash, T. F., Pruzinsky, T. E. 1990. Body images: Development, deviance, and change. New York: Guilford Press.
Cloutier, R et Drapeau, S., 2008. Psychologie de l’adolescent, 3ème édition. Montréal, Gaëtan Morin Editeur, Chenelière éducation.
Delgrande Jordan, M. Annaheim, B. 2009. Habitudes alimentaires, activité physique et statut pondéral chez les élèves de 11 à 15 ans en Suisse. Situation en 2006 et évolution récente - Résultats de l'Enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Lausanne: Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).
Devaud C., Michaud PA., Narring F., 1994. Perceptions corporelles, comportements et dysfonctions alimentaires parmi les adolescents suisses : une enquête nationale. Rev Med Suisse Romande; 114 : 1009-15.
Friedman, MA., Brownell, KD., 1995. Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin; 117, 3-20.
Ledoux, M., Mongeau, L., Rivard, M., 2002. Poids et image corporelle, dans Enquête Sociale et de santé des enfants et adolescents québécois 1999 (Québec, Institut de la statistique du Québec), Chapitre 14, pp. 311-344.
Mccabe, MP., Ricciardelli, L.A., 2003. Body image and strategies to lose weight and increase muscles among boys and girls. Health Psychology, 22, 1: 39-46.
Neumark-Sztainer, D., Hannan, P.J., 2000. Weight-related behavior among adolescent girls and body: Results from a national survey. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 154, 569-577.
Ohring R. Graber JA., Brooks-Gunn J., 2002. Girl’s recurrent and concurrent body dissatisfaction: Correlates and consequences over 8 years. International Journal of Eating Disorders, 31, 404-415.
Paxton SJ., Neumark-Sztainer D., Hannan PJ et Eisenberg ME., 2006. Body dissatisfaction prospectively predicts depressive mood and low self-esteem in adolescent girls and boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35, 4: 539-549.
Presnell K., Bearman SK., Stice E., 2004. Risk factors for body dissatisfaction in adolescent boys and girls: A prospective study. International Journal of Eating Disorders, 36, 389–401.
Ricciardelli, L.A., Mccabe, M.P., 2001. Dietary restraint and negative affect as mediators of body dissatisfaction and bulimic behavior in adolescent girls and boys. Behaviour Research and Therapy, 39, 11: 1317-1328.
Rosseau A., Rusinek S et al., 2011. Influences socioculturelles médiatiques et insatisfaction corporelle chez les adolescents françaises. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 59 :163-168.
SEMEP (2009) Etude du surpoids, de l’obésité et des facteurs associés au surpoids chez les élèves du cycle moyen scolarisé dans les collèges publiques de l’EPSP Bouzareah. Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive. http://www.sante.dz/semep_epsp_bouzareah.pdf
Smolak, L., Levine, M., 2002. Body image development in adolescence, Dans Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice, édité par T. Cash and T. Pruzinsky (New York: The Guilford press) p.74-82.
Stice, E., Hayward, C., Cameron, RP., Killen, JD., Taylor, CB., 2000. Body image and eating disturbances predict onset of depression among female adolescents: A longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 109, 438-444.