
Karabinta, Y., Maïga, F., Karambe, T., Guindo, B., Gassama, M., Dicko, A., Tall, K., Savané, M., Thiam, H., Keita, A., Faye, O., Diop, S., 2019. Avantages et contraintes lies à l’accompagnement des patients hospitalisés dans le Service de Dermatologie du Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM), Mali. Antropo, 42, 37-43. www.didac.ehu.es/antropo
Avantages et contraintes lies à l’accompagnement des patients hospitalisés dans le Service de Dermatologie du Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM), Mali
Advantages and constraints of accompanying patients hospitalized in the Dermatology Department of the National Centre for Disease Control Support (CNAM), Mali
Y. Karabinta1, 2, F. Maïga4, T. Karambe1, B. Guindo1, M. Gassama1, 2, A. Dicko1, 2, K. Tall 1, M. Savané1, H. Thiam2, 4, A. Keita1, O. Faye1,2, , S. Diop2, 3
1 Centre national d’Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM), Bamako, Mali.
2 Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie.
3 Direction Enseignement et Recherche en Santé Publique
4 Centre de Santé de Référence Commune III du District de Bamako
Auteur correspondant : Dr Karabinta Yamoussa, ykarabinta@yahoo.com
Mots clés : Accompagnement, Avantages et Contraintes, Service de Dermatologie du CNAM.
Key words: Accompaniment, Benefits and Constraints, Dermatology Department of CNAM.
Résumé
Un accompagnant se définit comme : une personne, suffisamment proche du patient pour le comprendre et le représenter. Il est un prolongement de la présence familiale ou parentale au sein des structures hospitalières. Nous nous sommes fixés comme objectifs d’étudier la problématique de l’accompagnement des patients au service de dermatologie du CNAM, décrire l’apport des accompagnants dans la prise en charge finanière, matérielle, logistique et psychoaffective des patients et déterminer les contraintes cognitives et environnementales liées à l’accompagnement.
Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et descriptive de tous les cas d’accompagnements des patients hospitalisés d’au moins pendant 15 jours dans le service de dermatologie du CNAM durant la période de Janvier 2018 à Juin 2018 soit 6 mois.
Au terme de cette étude, nous avons colligé au total 204 accompagnants et 45 agents de santé. Le sexe féminin a représenté 64% des cas. L’âge des accompagnants variait de 36 à 55 ans avec une moyenne d’âge à 41 ans. Les accompagnants étaient mariés dans 85%. Les accompagnants résidaient à Bamako dans 76,5%. 62,3% des accompagnants avait au moins une expérience dans l’accompagnement des patients. Les accompagnants étaient des permanents dans 88,7% des cas.
Malgré les contraintes et les travers liés à l’accompagnement des patients au service de dermatologie du CNAM, il reste un phénomène de grande vitalité qui témoigne éloquemment de l’étendue et de la solidité des réseaux de solidarité en Afrique.
Abstract
An accompanying person is defined as: a person, sufficiently close to the patient to understand and represent him; it is an extension of the family or parental presence within the hospital structures. Our goal is to study the problematic of patient support in the dermatology department of the CNAM, to describe the contribution of the accompaniers in the financial, material, logistic and psychoaffective care of the patients and to determine the cognitive constraints. environmental aspects of support.
This was a prospective, cross-sectional and descriptive study of all cases of accompaniment of hospitalized patients for at least 15 days in the dermatology department of the CNAM during the period from January 2016 to June 2016, i.e. 6 months.
We collected a total of 204 carers and 45 health workers. Female gender accounted for 64% of cases. The age of the caregivers ranged from 36 to 55 years old with an average age of 41 years. The accompanying persons were married in 85%. Accompanying persons resided in Bamako in 76.5%. 62.3% of the accompanying persons had at least one experience in the accompaniment of the patients. Accompanying persons were permanent in 88.7% of cases.
Despite the constraints and limitations associated with the support of patients in the dermatology department of the CNAM, it remains a phenomenon of great vitality that speaks eloquently of the extent and strength of solidarity networks in Africa.
Introduction
L'accompagnement du patient hospitalisé est un phénomène universel. Certaines maladies surtout aigues comme les urgences dermatologiques (les toxidermies graves, les dermatoses bulleuses auto-immunes, les cancers cutanés…) nécessitent un séjour plus ou moins longue à l’hôpital et la participation des aidants naturels (père, mère, frère, sœur, tante, cousin, conjoint, etc.). Si l’hospitalisation s’avère nécessaire ces aidants naturels deviennent des accompagnants.
Si dans les pays développés, le système d’accompagnement est organisé par un système de sécurité sociale cohérent, une bonne organisation des centres de soins et une disponibilité des moyens matériels, financiers et humains (De Hennezel, 1995), demeure moins dans les pays en voie de développement où le système s’organise dans l’espace d’entraide sociale pour les raisons de faible ratio de personnel de santé par habitant : un infirmier pour 10.022 habitants au Mali (MS, 2005) alors que l'OMS recommande un infirmier pour 5.000 habitants (OMS, 2005), la solidarité africaine qui trouve un cadre d’expression en toute occasion, heureuse ou malheureuse, le soutien économique devrait accompagner d’autres formes de soutien.
En effet, certains patients peuvent bénéficier d’un soutien matériel considérable et se sentir moralement rejeté, d’autres n’ont pas de soutien économique mais perçoivent une remarquable solidarité morale.
Le service de dermatologie du CNAM reçoit et hospitalise toutes les urgences dermatologiques. Il s’ensuit souvent un engorgement du service par les malades et leurs accompagnants. La prise en charge d’un malade accompagné est sans doute différente de celle d’un malade non accompagné. La présente étude a pour but de déterminer les avantages et les contraintes liés à l’accompagnement d’un malade dans un milieu hospitalier dermatologique de Bamako.
Matériels et Méthode
Notre étude s’est déroulée dans service de dermatologie du CNAM, une des structures sanitaires de référence au niveau nationale du Mali. Le Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie est situé en commune IV du district de Bamako en plein centre-ville au quartier Djicoroni Para près du Camp Beret Rouge. Il est spécialisé dans la prise en charge des affections dermatologiques. Il est facilement accessible par la majorité de la population du district de Bamako.
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive des cas d’accompagnement des malades pour une durée d’au moins 15 jours durant la période du 1erJanvier 2018 au 30 Juin 2018 soit 6 mois. Les critères d’inclusion ont été les suivants:
Les accompagnants des patients hospitalisés au moins pendant 15 jours dans le service, quel que soit le sexe durant la période de notre étude. Ont été exclus de cette étude les visiteurs, les accompagnants des patients qui n’ont pas voulu répondre au questionnaire pour diverses raisons, les accompagnants des patients qui ont moins de 15 jours d’hospitalisation.
Les variables suivantes ont été analysées dans la population d’étude : Données sociodémographiques, Apport de l’accompagnant, Contraintes de l’accompagnant, Avis des accompagnants sur le personnel, Avis du personnel sur les accompagnants.
Les données ont été recueillies à travers une fiche d’enquête. Le traitement et l’analyse statistique des données ont été réalisés à l’aide du logiciel SPSS 18.0 et les Saisies avec les logiciels Microsoft Word.
L’étude a été menée après un consentement éclairé des accompagnants, du personnel ; et un accord administratif du CNAM a été obtenu. Les numéros d’identification ont garanti l’anonymat des participants.
Resultats
Au total 204 accompagnants et 45 agents de santé ont été inclus de Janvier 2018 au Juin 2018 dans notre étude. Les résultats suivants illustrent l’ensemble des données sur ces 204 accompagnants et 45 agents. Le sexe féminin a représenté 64% avec un ratio de 0,56 (Figure 1).
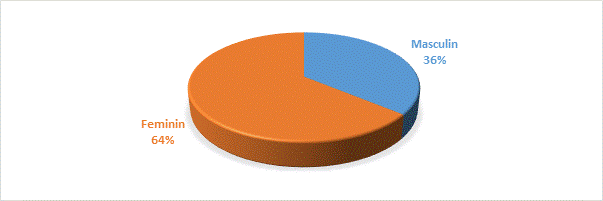
Figure 1. Répartition des cas selon le sexe.
Figure 1. Gender distribution of cases.
Les accompagnants avaient un âge compris entre 36 et 55 ans avec une moyenne d’âge des accompagnants à 41 ans (Table 1). Les accompagnants avaient de professions variés : Fonctionnaire (16,2%), Commerçant (32,4%), Artisan (11,3%), Scolaire (7,8%), Cultivateur (14,2%), Femme au foyer (15,7%), Autres (2,4%). Ils provenaient de Bamako dans 76,5%, de Kayes dans 3,4%, de Koulikoro dans 7,8%, de Sikasso dans 4,4%, de Ségou dans 3,9%, de Mopti dans 1,0%, de Kidal dans 1,0% et des Autres localités dans 2,0%.
Les accompagnants étaient mariés dans 85% des cas, Divorcé dans 2% cas, Célibataire dans 10% des cas et Veufs dans 3% des cas. Plus de la moitié des accompagnants (62,3%) avait au moins une expérience dans l’accompagnement des patients. Les accompagnants étaient des permanents dans 88,7% des cas, temporaire dans 10,8% des cas et intermittents dans 0,5% des cas. Le nombre moyen d’accompagnants par patient était de 3±1,1 avec une médiane de 4 accompagnants. Ils étaient des aidants naturels (Pères, Mères, Enfants, Conjoints, Frères et Sœurs) dans 75,5% des cas. La quasi-totalité (98,5%) des patients était prise en charge financièrement par les accompagnants. Les accompagnants étaient capables de réconforter leur malade dans 75,5% des cas.
Le nursing du malade était assuré à 1% par les accompagnants. Les courses du malade étaient effectuées par les accompagnants dans 99,5% cas. Les contraintes de temps et de lieu étaient retrouvées chez les accompagnants dans 77% des cas.
L’accompagnement avait un impact négatif chez 77,5% des cas par rapport à l’activité habituelle des accompagnants. La devanture d’hospitalisation du service dermatologique était le lieu d’hébergement des accompagnants dans 82,4% des cas.
Les accompagnants méconnaissaient les règles de l’hôpital, et les risques d’infections nosocomiales dans 97% des cas. 68,1% des accompagnants pense que le service est bien organisé. 51% des accompagnants pense que le personnel du service est très disponible. Les accompagnants étaient satisfaits des prestations dans 71,6% des cas. La plupart du personnel (62%) pense que les accompagnants gênent les malades et ses activités. Tout le personnel interrogé pense qu’il est nécessaire de faire accompagner un malade au service d’hospitalisation dermatologique.
|
|
Effectif |
% |
|
Age (an) |
|
|
|
15-35 |
70 |
34,3 |
|
36-55 |
116 |
56,9 |
|
56 et plus |
18 |
8,8 |
|
Statuts Matrimonial |
|
|
|
Marrié |
174 |
85 |
|
Célibataire |
21 |
10 |
|
Voeufs |
7 |
3 |
|
Divorcés |
2 |
1 |
|
Experience en accompagnement |
|
|
|
pas experience |
77 |
37,7 |
|
experimenté |
127 |
62,3 |
|
Type d’accompanying |
|
|
|
Permanent |
181 |
88,7 |
|
Temporaire |
22 |
10,8 |
|
Intermittent |
1 |
0,5 |
Tableau 1. Répartition des cas selon l’age, Statut matrimonial et l’Experience en accompagnement. L'âge médian des soignants était de 41 ans. ils étaient mariés dans 85% des cas et avaient moins d'expérience dans l'accompagnement des patients dans 62% des cas.
Table 1. Breakdown of cases by age, marital status and experience in accompaniment. The median age of caregivers was 41 years. They were married in 85% of cases and had less experience in accompanying patients in 62% of cases.
Discussion
Limites de la Méthodologie
Notre étude a été menée dans le service de dermatologie du CNAM. Nous avons effectué une étude prospective sur 204 accompagnants des patients hospitalisés pendant au moins 15 jours et 45 agents du service. Par ailleurs, pour des modalités opérationnelles, nous avons convenu des définitions suivantes : Un accompagnant permanent est un accompagnant toujours présent auprès de son malade du début de l’hospitalisation jusqu’à la sortie. Un accompagnant temporaire est un accompagnant qui se fait remplacer par un autre dans la journée. Un accompagnant intermittent est celui qui reste momentanément auprès de son malade sans se faire remplacer. La seule étude locale disponible sur l’accompagnement est celle de Bamba (2000) ne permet pas de faire la comparaison des pathologies à cause d’un énorme biais de recrutement (l’étude de Bamba s’est déroulée dans un service de Gynéco-obstétrique). Bamba n’avait retenu que deux types d’accompagnants : les permanents et les intermittents.
Enfin contrairement à Bamba (2000) qui a fixé dans ses critères d’inclusion une durée d’hospitalisation d’au moins 48 heures, nous avons ramené la durée d’hospitalisation à une valeur minimale de 15 jours, cela permet de cerner la promptitude des proches du patient à organiser son accompagnement et le séjour bref des patients au service de dermatologie.
Donnees socio-demographiques des accompagnants
Nous avons recensé pendant les 6 mois de l’étude, 204 accompagnants (soit 34 accompagnants par mois) dont 36,3% d’hommes et 63,7% de femmes, un peu plus de la moitié des accompagnants avait un âge compris entre 36 et 55 ans avec un âge médian de 41 ans. L’étude de Bamba (2000), effectuée à l’hôpital du point-G dans le service de Gynéco-obstétrique a permis de recenser 100 malades (soit 16,6 patient par mois), toutes de sexe féminin en raison de la vocation du service. Les commerçants constituaient la majorité des accompagnants dans notre étude avec 32,4%. Nous n’avons retrouvé que 15,7% de femme au foyer contre 61,19% chez Bamba.
Cependant, si l’on y ajoute les scolaires, les chômeurs, les cultivateurs, les artisans et éleveurs, nous atteignons le taux de 46,5% d’accompagnants sans emploi formel. Gbikpi (1978) a retrouvé un taux encore plus élevé (95,83%). Il est parfaitement compréhensible que les familles assignent la mission d’accompagnement à ceux de leurs membres qui jouissent d’une grande flexibilité dans leurs occupations professionnelles. Il semble par ailleurs, selon l’expérience de Gbikpi (1978) que plus l’hospitalisation est de longue durée, plus le taux d’accompagnants sans emploi formel est élevé.
Avantages et contraintes d’accompagnement des patients
La fréquence de l’accompagnement a été de 100%, les patients avaient un nombre d’accompagnant compris entre 1 et 3 dans plus de trois quart (75,5%) des cas. Le nombre moyen d’accompagnants était de 3±1,1 avec une médiane de 4 accompagnants par patient, ce qui confirme le caractère fréquent de cette pratique en Afrique. Bamba (2000) aborde dans le même sens en notant l’existence d’au moins un accompagnant auprès de 98% de ses patients, avec une moyenne de 1,28 accompagnant par patient.
On notait parfois des cas pléthoriques (jusqu’à 10 accompagnants chez certains patients dans notre série), ce qui n’est pas sans inconvénients sur les structures sanitaires. Mais il existe aussi l’autre extrême, où le patient peut ne pas avoir d’accompagnant; ce phénomène de non accompagnement était surtout observé chez des patients Psychiatriques et certains alcooliques où le patient est pratiquement abandonné par ses proches, comme s’il était socialement mort. C’est dans les années 1970-1980 que l’école psychiatrique dakaroise, pour freiner cette dérive, a formalisé et codifié l’accompagnement en créant le concept de « l’institution accompagnant », faisant de la paire « patient-accompagnant » un couple quasiment indissociable Gbikpi (1978). Ce modèle parfaitement superposable au modèle traditionnel africain peut être envisagé dans les services médico-chirurgicaux, devant des cas chroniques ou des cas d’indigence occasionnant parfois la fuite de responsabilité des proches.
Plus 75% de nos accompagnants avaient un niveau d’instruction nul ou primaire ; Bamba (2000) avait noté que 73,43% de ses accompagnants ne savaient ni lire ni écrire. Ce bas niveau d’instruction des accompagnants est préjudiciable au respect des règles hospitalières. La plupart des accompagnants (96%) méconnaissait les règles de l’hôpital, et les risques d’infections nosocomiales.
De ce fait, 96% des accompagnants dans notre série ont déclaré ignorer l’existence d’un règlement intérieur à l’hôpital lequel règlement étant l’un des moyen pour comprendre les droits et devoir de tout un chacun; le même nombre n’avait pas de notions sur l’hygiène hospitalière ni sur les risques d’infections nosocomiales et 96% n’avaient pas d’information sur les règles de sécurité à l’hôpital. Ces données interpellent fortement les autorités hospitalières si l’on sait que parmi leurs moyens de communication avec les accompagnants se trouve le fait de placarder des messages écrits à l’intention d’une population largement illettrée ou sous-lettrée. Comme relation entre patients et ses accompagnants, Nous avons noté que 75,5% de nos accompagnants étaient des aidants naturels (père, mère, frère, sœur, enfant) de leurs patients. Ce résultat est comparable à celui de Bamba (2000) et de Gbikpi (1978) qui trouvèrent respectivement un taux de 66,41% et de 70% de liens directs.
Kuingue (1995) et Diarra (2006) ont fait remarquer que le lien de parenté influe sur la prise en charge des dépenses de santé.
Par ailleurs il est à noter que les conjoints ne constituent pas forcément le plus grand nombre d’accompagnant, ce sont les frères et sœurs des patients qui accompagnent le plus souvent (1 cas sur 6). Dans notre étude 75,5% des accompagnants étaient des aidants naturels ce qui souligne le devoir d’assistance filial qui est de règle dans les sociétés africaines. Le rôle des accompagnants se situait à plusieurs niveaux (l’appui psychoaffectif au patient) : Dans notre série l’accompagnant est source d’information (75,5%), de confidence, mais surtout de réconfort et d’apaisement (75%). Ce résultat est comparable à celui de Gbikpi (1978) qui l’a cerné de très près et a même esquissé des archétypes en fonction des déviances qui peuvent résulter d’une appropriation erronée ou excessive du rôle ; c’est ainsi qu’il signale l’existence d’accompagnants complices, compréhensifs, médiateurs, somatisant, mais aussi résignés, mercenaires, etc.
Les accompagnants jouaient également un rôle d’aide logistique et l’appui aux soins. Le caractère artisanal de la gestion hospitalière dans bons nombres de pays africains impose la nécessité d’une présence physique à côté du patient ; c’est ainsi qu’émerge « l’accompagnant valet chargé des tâches domestiques (cuisine, lessive, vaisselle, déplacement du patient, courses incessants allers et retours entre salles d’hospitalisation d’une part et services administratifs, laboratoires, services d’imagerie et pharmacie d’autre part).
De Hennezel (1995) signale en effet qu’en Europe aussi, les familles s’impliquent car beaucoup de soignants refusent de s’investir dans les soins de nursing (hygiène corporelle du patient, mobilisation, surveillance, massage de confort) pourtant indispensables à la prévention des souffrances liées à l’immobilisation (escarres, hypotonie etc.) (De Hennezel, 1995 ; Bankineza, 1992).
Cette « prise de fonction » de l’accompagnant dans le système de santé telle que constatée dans notre étude est certainement due à l’insuffisance qualitative et quantitative du personnel soignant.
A peu près dans notre étude tous les accompagnants ont apporté un soutien financier à leurs patients et cet apport a été affecté dans 63,3% des cas aux frais d’ordonnance, de nourriture et d’hospitalisation. L’absence d’ « assurance maladie » augmente ainsi de façon considérable les charges des familles, et plus particulièrement des accompagnants qui enregistrent par ailleurs un manque à gagner dans leurs revenus du fait de leur immobilisation à l’hôpital. Plusieurs auteurs (Bamba, 2000 ; Gbikpi, 1978 ; Kuingue, 1995 ; Diarra, 2006 ; Mariko, 2002) ont mis en exergue la fragilité de la prise en charge par la famille et son impact sur la promptitude avec laquelle les traitements sont institués. Autant Gbikpi (1978) pense que la présence de l’accompagnant entraîne la démission du personnel soignant, autant nous pensons que cette même présence contribue à accentuer la démission des autorités sanitaires (et donc de l’Etat) dans la prise en charge financière de certains patients dont, malgré la présence de l’accompagnant, restent de véritables cas sociaux. Il s’avère que 62,2% du personnel socio-sanitaire du service de dermatologie affirment que les accompagnants les gênent dans leurs activités. Dans 60% des cas le personnel de santé est convaincu que les accompagnants gênent les malades dans leurs repos. Presque 46,7% du personnel socio-sanitaire du service de dermatologie pensent que les accompagnants favorisent les infections nosocomiales.
Les accompagnants ne disposent d’aucune structure spéciale pour le repos et les repas, 82,4% dorment à la devanture du service dans notre étude. Autre chiffre, 10,3% des accompagnants, à cause du caractère inapproprié des locaux, deviennent malgré eux des accompagnants intermittents en adoptant d’aller se reposer et se restaurer à domicile.
Le problème de l’hébergement de l’accompagnant est clairement posé.
Conclusion
L’accompagnant n’est cependant ni reconnu par les textes, ni prévu dans l’espace physique hospitalier de nos pays, ce qui semblerait être une des contraintes majeures de l’accompagnement des patients dans nos structures.
Malgré ces contraintes et ces travers liés à l’accompagnement des patients au service de dermatologie du CNAM, il reste un phénomène de grande vitalité qui témoigne éloquemment de l’étendue et de la solidité des réseaux de solidarité en Afrique.
Financement. Cette recherche a été financée par notre initiative personnelle et avec le soutien de toute l'équipe de dermatologie du CNAM.
Remerciements. Nous tenons à exprimer leur gratitude aux patients et à leurs accompagnateurs pour leur participation à ce stade. Nous sommes redevables au personnel Dermatologie du CNAM, Faculté de médecine et d'odontostomatologie, Université des sciences, techniques et technologies de Bamako.
Conflit d'intérêt. Les auteurs déclarent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.
Références
De Hennezel, M., 1995. La mort intime. Paris : Robert Laffont. 232p.
MS, 2005. Rapport bilan du Ministère de la santé (juin 1992 à mars 2002), Cellule de Planification et de Statistique. Ministère de la santé, Bamako (Koulouba).
OMS, 2005. Utilisation des services de santé de premier niveau au Mali : Analyse de la situation et perspective. Avril 2005. Département du développement humain ; document de travail N°6.
Bamba, B., 2000. Place des accompagnants (es) dans le système de soins : Cas du service de Gynécologie obstétrique de l’Hôpital National du point G. Thèse Med, FMPOS, Bamako; n°1, 30p.
Gbikpi, P. A., 1978. L’accompagnant dans une institution Psychiatrique (à propos de 20 cas). Thèse Med, Dakar, n°21, 177p.
Kuingue, A. S., 1995. Problème et comportement lié à la santé et à la reproduction des ménages et groupe à risque dans le cercle de Kolondièba . These Med, FMPOS, Bamako, n°37,167p.
Diarra, K., 2006 Evaluation de la qualité de la consultation gynécologique au C.S.Ref de la commune IV du district de Bamako. Thèse Med, FMPOS, Bamako, n°45, 100p.
Bankineza, E. M., 1992 Etude rétrospective des activités du service de chirurgie B à l’Hôpital National du Point G. Thèse Med, FMPOS, Bamako, n° 51, 182p.
Mariko, M., 2002. Malades Indigents Hospitalisés: prise en charge à l’Hôpital du Point G. Thèse Med, FMPOS, Bamako, n° 68, 71p