
Kaoutar, K., Hilali, M.K., Loukid, M., 2019. Les
facteurs d’inactivité physique et de sédentarité chez les enfants scolarisés au
Maroc : Cas de la Wilaya de Marrakech. Antropo, 41, 17-24.
www.didac.ehu.es/antropo
Les facteurs d’inactivité physique et de sédentarité chez
les enfants scolarisés au Maroc : Cas de la Wilaya de Marrakech
Sedentary lifestyle and its
associated factors among school children in Morocco: Case of the
Wilalya of Marrakech
Kamal Kaoutar, Mohamed Kamal Hilali, Mohamed Loukid
Laboratoire d’Ecologie
Humaine, département de Biologie, Faculté des Sciences Semlalia, Université
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
Correspondence : Dr Kamal
Kaoutar, Laboratoire d’Ecologie Humaine, département de Biologie, Faculté des
Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. Kamal.kaoutar@edu.uca.ma
Mots-clés: Mode de vie, Lieu
de résidence, Genre, Enfants scolarisés, Marrakech, Maroc.
Keywords: Lifestyle, Area of residence, Gender, School children, Marrakesh,
Morocco.
Résumé
Objectif : Appréhender
l'effet du milieu de résidence (urbain-rural) et du genre sur le mode de vie d’un
groupe d’enfants scolarisés marocains.
Echantillon : 1407 enfants
âgés de 12 à 18 ans dont 920 (65,4%) d’origine urbaine et 487(34,6%) d’origine
rurale. Les résultats présentés dans ce travail proviennent d’une enquête transversale
à visée étiologique réalisée entre 2008 et 2010 dans des établissements
scolaires de la Wilaya de Marrakech. Notre matériel de base est constitué d'un
questionnaire et de mesures
anthropométriques.
Le mode de vie des enfants a été évalué par le comportement
sédentaire (pratique ou non d'une activité sportive extrascolaire, moyen de
transport utilisé pour se rendre à l’école, temps passé devant la télévision ou
de l’ordinateur).
Résultats : Au-delà de
l’activité sportive scolaire, 48,6% de l’ensemble des adolescents enquêtés
pratiquaient des activités physiques extrascolaires collectives et
individuelles. La pratique des activités physiques extrascolaires chez les
adolescents enquêtés varie de 1 à 6 fois par semaine, avec une moyenne de 1,15
fois par semaine (écart-type = 1,47). Selon le sexe, la pratique d’activité
physique extrascolaire était fréquente chez les garçons que chez les
filles : 67,7% contre 30,8% et ce quel que soit l’âge considéré. L’étude
de la pratique des activités physiques extrascolaires selon le milieu de
residence des enquêtés a révélé que cette habitude ne diffère pas entre les
adolescents habitant le milieu urbain et leurs homologues du milieu rural, soit
respectivement 48,7% et 48,5%.
Dans
l’échantillon enquêté, 66,8% des adolescents utilisaient des transports actifs
pour se rendre aux établissements scolaires avec 56,5% à pied et 10,3% par
vélo.
L’étude du mode
de transport des adolescents selon le milieu de résidence a montré que parmi
les adolescents habitant le milieu rural, 83,1% utilisaient le transport actif
pour se rendre à l’école. Au contraire, 59,1% des adolescents du milieu urbain
se déplaçaient par des moyens de transports motorisés.
Les adolescents
enquêtés consacrent en moyennes 12,88 heures par semaine à regarder la
télévision, 7,21 heures devant l’ordinateur, et 6,72 heures aux jeux vidéo.
Selon le sexe,
les filles globalement, consacrent plus de temps à la télévision que les
garçons (t = -4,59 p< 0,001).
Conclusion : Il parait,
selon les résultats de cette étude, que l’urbanisation a considérablement affecté
le mode de vie des adolescents surtout en milieu urbanisé. La mise en oeuvre
des politiques de santé publique ciblant l’enfant, afin de promouvoir les
modèles alimentaires et de mode de vie plus sain sont amplement demandés.
Abstract
Objective: Understanding the effect of the area of
residence (urban-rural) and gender on the lifestyle of a group of Moroccan
school children.
Sample: 1,407 school children aged 12 to 18, of whom
920 (65.4%) are of urban origin and 487 (34.6%) are of rural origin. The
results presented in this work come from a cross-sectional etiological survey
conducted between 2008 and 2010 in schools in the Wilaya of Marrakesh. Our
basic material consists of a questionnaire and anthropometric measurements.
The children
lifestyle was assessed by sedentary behaviors (practice or not of out of school
physical activity, means of transport used to get to school, time spent in
front of the television or the computer).
Results: Beyond the school physical activity, 48.6% of
all the adolescents surveyed practiced extracurricular physical activities. The
practice of out-of-school physical activity among the adolescents surveyed
varies from 1 to 6 times a week, with an average of 1.15 times (standard
deviation = 1.47). According to sex, the practice of extracurricular physical
activity was frequent among boys than among girls: 67.7% against 30.8% and
whatever the age considered. The study of the practice of extracurricular
physical activities according to the place of residence of the respondents
revealed that this habit does not differ between the adolescents living in the
urban environment and their counterparts of the rural environment, respectively
48.7% and 48.5%.
In the
sample surveyed, 66.8% of adolescents used active transportation to get to
school, with 56.5% walking and 10.3% cycling.
The study
of the mode of transportation of adolescents by place of residence showed that
83.1% of adolescents living in rural areas used active transportation to get to
school. On the contrary, 59.1% of urban adolescents get school by motorized
means of transportation.
The
adolescents surveyed spend an average of 12.88 hours per week watching
television, 7.21 hours in front of the computer, and 6.72 hours in video games.
By gender, girls overall spend more time on television than boys (t = -4.59 p
<0.001).
Conclusion: It appears from the results of this study
that urbanization has been affected the lifestyle of adolescents. Implementing
public health policies targeting the child, in order to promote healthier
eating and lifestyle patterns is strongly needed.
Introduction
Importante période de transition dans le cours du
développement humain, l’adolescence est considérée comme une période centrale
dans le développement de l’individu, et elle se caractérise par de nombreuses
et importantes transformations qui touchent tous les aspects du développement (Calixte, 2007).
Chez l’adulte la
pratique d’une activité physique régulière est reconnue comme un déterminant
majeur de l’état de santé des individus et des populations. A l’inverse, un mode de vie sédentaire est associé
à une mortalité totale plus élevée et au développement des pathologies
chroniques. Différentes études indiquent que les processus morbides associés à
ces pathologies et favorisés par un comportement sédentaire, débutent précocement, dans l’enfance ou l’adolescence (Simon et
al., 2005).
Le mode de vie ou style de vie, est l’ensemble des manières
à vivre. Il regroupe les loisirs qui occupent le temps libre des adolescents et
peuvent générer un bénéfice pour l’adolescent qui les pratique. Ils jouent un
rôle déterminent dans le processus d’intégration des adolescents dans leur
environnement social, culturel et économique. A l’adolescence, le mode de vie
des adolescents change, et ils deviennent plus intéressés par les loisirs qui
occupent leurs temps libre (Beauvais,
2001).
Dans les pays
émergents, la présence du double fardeau de la malnutrition (maigreur et
obésité) s’inscrit dans un contexte de « transition nutritionnelle » caractérisée
par un développement urbain intense, « une modernisation » des
habitudes alimentaires et une baisse de l’activité physique (Omran, 1997 ; Popkin, 2001 ; El
Rhazi, 2010).
Au Maroc, au cours des 25 dernières années, l'introduction
récente et la prolifération rapide de la technologie a rendu les enfants et les
adolescents plus sédentaires. Regarder la télévision, utiliser un ordinateur,
ainsi que jouer à des jeux vidéo (sur console ou PC) sont devenus des
passe-temps très en vogue chez les jeunes au Maroc surtout en milieu urbanisé.
Ceci notamment à cause de l'accessibilité et du coût à la baisse de cette
technologie.
Selon l’enquête nationale anthropométrique réalisée par le Haut-Commissariat
au Plan (HCP), et concernant la population adulte de 20 ans et plus, 33%
d’entre elles sont affectées par le surpoids et 17,9% présentent une obésité
sévère morbide (HCP, 2011). De manière générale, la prévalence du surpoids chez
les marocains (adultes de 20 ans et plus) a sensiblement progressé entre 2001
et 2011 pour afficher un record de 33% alors qu’auparavant 27% en étaient
affectés. Constat similaire et plutôt grave pour l’obésité sévère et morbide dont
le taux de prévalence est passé de 10,7% à 17,9% (HCP, 2011).
Selon l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé
Familiale (Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, 2012), la prévalence de surpoids
incluant l’obésité chez les enfants de moins de cinq ans est de 12,5 %, le même
taux est retrouvé chez les enfants urbains et ruraux. Les enfants issus du
niveau socioéconomique le plus élevé sont les plus touchés par le surpoids avec
14,4% contre 11,9% chez les enfants issus du niveau socioéconomique le plus
bas. Peu d’enquêtes documentent l’anthropométrie des enfants de plus de cinq
ans et les adolescents. Ainsi, l’objectif principal de ce travail est d’étudier
le mode de vie d’un groupe enfants scolarisés de la wilaya de Marrakech.
Sujets
et méthodes
Il s’agit d’une enquête
transversale à visée étiologique et
rétrospective réalisée entre 2008 et 2010 auprès de 1.407 adolescents
scolarisés de la wilaya de Marrakech, 481 garçons (47,2%) et 537 filles
(52,8%), provenant de 11 établissements scolaires.
Un questionnaire
a été adressé aux adolescents. Il comprend des informations sur les adolescents
et leurs parents (l’âge, lieu de naissance, état familial, niveau
d’instruction, activité, catégories socio-professionnelles selon quatre
modalités (Orban-Segebarth, 1982) ; CSP1 : parents sans profession, CSP2 : les
artisans, employés ouvriers, aides commerçants, agriculteurs, salariés, manœuvres,
chauffeurs, CSP3 : les fonctionnaires et cadres moyens et CSP4 : les
professions libérales, cadres supérieurs, et grands commerçants).
L’enquête s’est
déroulée sous forme d’une interview avec chaque élève individuellement. Le
principe de volontariat pour la participation ainsi que la confidentialité et
l’anonymat du questionnaire ont été respectés.
Le comportement sédentaire a été évalué par la pratique ou
non d’une activité sportive, le mode de transport (actif ou passif) et le
nombre d’heures passé par jour devant un écran (télévision, ordinateur…) ;
indicateur de sédentarité actuellement le plus utilisé impliquant une situation
assise prolongée.
La saisie et le traitement statistique des données ont été
réalisés à l’aide du logiciel SPSS, version 10*.
Résultats
et discussion
Caractéristiques sociodémographiques et
culturelles
L’âge chronologique des élèves enquêtés représente l’âge
exact au moment de l’enquête, obtenu par la différence entre la date de
l’enquête et la date de naissance (en jour, mois, année) (Tableau 1).
L’âge des enfants enquêtés varie de 12 à 18 ans avec une
moyenne de 14,96 (écart-type = 1,66 ans).
L’écart entre les âges moyens des garçons et des filles est
statistiquement non significative (test t de student = 0,047 ; p = 0,962).
|
Classes
d’âge |
Ensemble |
Garçons |
Filles |
|||
|
N |
% |
N |
% |
N |
% |
|
|
10-12
ans (prépubères) |
217 |
14,5 |
97 |
14,8 |
120 |
16,0 |
|
13-15
ans (pubères) |
735 |
52,2 |
348 |
53,0 |
387 |
51,5 |
|
16-18
ans (post pubères) |
455 |
33,3 |
211 |
32,2 |
244 |
32,5 |
|
Total |
1407 |
100 |
656 |
100 |
751 |
100 |
Tableau 1. Répartition des élèves par sexe et par classes d’âge
Table 1. Distribution of school children by sex and
age group
L’âge des mères, en nombre de 1.351, varie de 26 à 60 avec
une moyenne de 41,18 ans (écart-type = 5,47 ans), alors celui des pères, en
nombre de 1.292 varie de 30 à 75 ans, avec une moyenne de 48,28 ans (écart-type
= 6,32 ans).
Selon la répartition des parents par classe d’âge, nous
constatons que 74,3% des pères dépassent
l’âge de 45 ans contre seulement 28% des mères (Tableau 2).
|
Variables |
Modalités |
Mères |
Pères |
||
|
N |
% |
N |
% |
||
|
Classes d’âge |
25-34 ans |
115 |
8,5 |
7 |
0,5 |
|
35-44 ans |
858 |
63,5 |
325 |
25,2 |
|
|
45 ans et plus |
378 |
28,0 |
960 |
74,3 |
|
|
Origine géographique |
Marrakech |
567 |
40,7 |
524 |
39,3 |
|
Autres régions de Marrakech |
368 |
26,4 |
375 |
28,2 |
|
|
Autres villes de Maroc |
459 |
32,9 |
433 |
32,5 |
|
|
Statut matrimonial |
Marié (e) ou remarié (e) |
1305 |
93,6 |
1317 |
98,9 |
|
Divorcé (e) ou veuf (ve) |
89 |
6,4 |
15 |
01,1 |
|
|
Niveau d’instruction |
Aucun |
573 |
41,1 |
310 |
23,4 |
|
Primaire |
142 |
10,2 |
207 |
15,5 |
|
|
Secondaire |
331 |
23,7 |
327 |
24,5 |
|
|
Supérieur |
348 |
25,0 |
488 |
36,6 |
|
Tableau 2. Caractéristiques
sociodémographiques et culturelles des parents des enfants. N :
Effectif ; % : Pourcentage
Table 2. Sociodemographic and cultural
characteristics of parents of children
Au moment de
l’enquête, l’étude du statut matrimonial des parents des adolescents enquêtés
montre une dominance des parents en situation de mariage : 93,6% des mères
et 98,9 % des pères.
Activité physique extrascolaire
Au-delà de
l’activité sportive scolaire, 48,6% de l’ensemble des adolescents enquêtés
pratiquaient des activités physiques extrascolaires collectives et
individuelles. La pratique des activités physiques extrascolaires chez les
adolescents enquêtés varie de 1 à 6 fois par semaine, avec une moyenne de 1,15
fois par semaine (écart-type = 1,47).
La fréquence des
enfants de notre échantillon qui pratiquaient une activité physique extrascolaire
était supérieure à celle trouvée chez les enfants de la ville de Marrakech en
2009-2010 et qui était de 32,8% (Laassakri,
2014), mais largement inférieure à celles de leurs
homologues français respectivement, 63,5% (Génolini et Escalon, 2010), 73,8% (HBSC, 2007) et 83,0% (Thibault
et al., 2010).
Selon le sexe,
la pratique d’activité physique extrascolaire était fréquente chez les garçons
que chez les filles : 67,7% contre 30,8% et ce quel que soit l’âge
considéré. La fréquence de la pratique des activités physiques extrascolaires
n’est pas uniforme entre les filles et les garçons. Ces derniers déclaraient
les pratiquer plus que les filles soit respectivement 1,70 fois par semaine
(écart-type = 1,56) et 0,63 fois par semaine (écart-type = 1,56). La différence entre les deux moyennes est statistiquement significative
(t= 10,50 ; p < 0,001).
Nos résultats
concordent avec ceux des études françaises qui ont montré aussi que le niveau
d’activité sportive est plus important chez les garçons que chez les filles (HBSC, 2007 ; Thibault et al., 2010 ; Génolini et Escalon,
2010).
Par rapport aux
classes d’âge, la pratique de l’activité physique extrascolaire était maximale
entre l’âge de 13 et 15 ans chez les deux sexes (Figure 1).
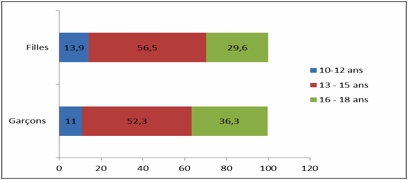
Figure
1. Activité physique extrascolaire par sexe et par
classes d’âge
Figure 1. Out of school physical activity by sex and age group
L’étude de la
pratique des activités physiques extrascolaires selon le milieu de residence
des enquêtés a révélé que cette habitude ne diffère pas entre les adolescents
habitant le milieu urbain et leurs homologues du milieu rural, soit
respectivement 48,7% et 48,5%. L’analyse statistique n’a montré aucune
différence significative entre ces 2 variables. Pourtant, plusieurs travaux ont
montré la présence d’une corrélation entre la situation socioéconomique et la
pratique des sports de loisirs (Coggins
et al., 1999 ; Kremarik,
2000 ; Dowler, 2001). Cette
différence peut être expliquée par le fait que les adolescents vivants dans des
conditions socio-économiques modestes ont moins de possibilités financières
pour accéder aux équipements, aux programmes et aux activités favorisant un
mode de vie dynamique (Popkin et al., 2005). De plus, les parents
appartenant au groupe défavorisé sont en général moins instruits, moins
conscients des bienfaits de l’activité physique (Kafatos et al., 1999 ;
Dowler, 2001) et disposent de revenus bas (Sobal et al.,
1989), de plus, leurs enfants se sentent moins sûrs dans leurs environnements
et s’inquiètent davantage de la criminalité et de l’absence de sécurité dans
leurs voisinage (Peters, 2002).
Moyen de transport des adolescents
Différents
moyens de transport sont utilisés par les élèves pour se rendre à leurs
établissements scolaires. Ils dépendent de la proximité de ces établissements
du lieu de résidence, de l’accessibilité, et de la disponibilité du moyen de
transport utilisé (El Youbi, 2004). Dans
l’échantillon enquêté, 66,8% des adolescents utilisaient des transports actifs
pour se rendre aux établissements scolaires avec 56,5% à pied et 10,3% par
vélo.
L’étude du mode
de transport des adolescents selon le milieu de résidence a montré que parmi
les adolescents habitant le milieu rural, 83,1% utilisaient le transport actif
pour se rendre à l’école. Au contraire, 59,1% des adolescents du milieu urbain
se déplaçaient par des moyens de transports motorisés. Le mode de transport des
adolescents apparait bien lié aux conditions socioéconomiques de leurs familles
(chi-deux = 104,34 ; p<0,001). Les adolescents issus du milieu urbanisé
poursuivaient plus leurs études dans des établissements scolaires privés, de ce
fait, ils bénéficiaient plus de moyens de transport motorisés (transport scolaire,
emmené par leurs parents, ou avoir leurs propre moyens motorisés).
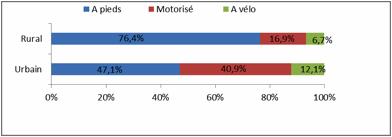
Figure
2. Moyen de transport des élèves par milieu de
résidence
Figure 2. Means of transportation of students by area
of residence
Temps passé
devant un écran
Les écrans
(télévision, ordinateur, consoles de jeux, portables, tablettes, smartphones,
…) envahissent les foyers, et absorbent une part importante du temps libre des
enfants et des adolescents. Les adolescents enquêtés consacrent en moyennes 12,88
heures par semaines à regarder la télévision, 7,21 heures devant l’ordinateur,
et 6,72 heures aux jeux vidéo.
Selon le sexe,
les filles globalement, consacrent plus de temps à la télévision que les
garçons (t = -4,59 p< 0,001).
Dans la même
ligne d’idées, les résultats de cette enquête montrent que les enfants du
milieu urbain passaient plus de temps à regarder ou à utiliser la télévision,
l’ordinateur et l’internet que leurs homologues du milieu rural (Tableau 3).
|
|
Total |
Urbain |
Rural |
Test t |
|
Télévision |
12,88
(7,28) |
14,28
(7,77) |
10,36
(5,39) |
9,92 ;
p<0,001 |
|
Ordinateur |
7,21
(9,17) |
10,01(9,73) |
1,96
(4,76) |
17,27 ;
p<0,001 |
|
Internet |
6,72
(9,1) |
9,52(9,73) |
1,47
(4,27) |
17,32 ;
p<0,001 |
Tableau 3. Temps moyen
hebdomadaire (en heures) passé devant un écran selon le milieu de résidence.
Table 3. Average weekly time (in hours) spent in front of a screen by area of
residence.
Le développement
socioéconomique et sanitaire des ménages, avec l’urbanisation accélérée de la
société marocaine et l’entrée massive de la technologie de l’information et de
la communication (TIC) aux ménages, avec la facilité d’accès à l’internet ont
contribué majoritairement au changement
de mode de vie des adolescents surtout en milieu urbanisé.
Par ailleurs,
selon les résultats d’une enquête ayant porté sur un échantillon de 723
élèves de la ville de Marrakech, près de 84% se sont avérés avoir des valeurs
d’IMC «normales» et 16 % présentent un problème nutritionnel lié à
l’insuffisance pondérale ou à la surcharge pondérale voire à l’obésité. Selon
le sexe, la prévalence des problèmes nutritionnels (insuffisance pondérale ou
surpoids et obésité) était plus importante chez les garçons que chez les filles
qui affichent des prévalences respectives de 19,5% et de 13,8% (Kaoutar et
al., 2012). Dans cette étude
les auteurs ont révélé que la surcharge pondérale (surpoids et obésité)
était plus importante chez les enfants qui sont utilisateurs d’ordinateur et
d’internet à raison de plus de deux heures par jour. En plus, le surpoids et
l’obésité étaient présents de manière proéminente chez les élèves qui sont
motorisés ou qui utilisent la voiture familiale comme moyen de transport pour
aller à l’école (Kaoutar et al., 2012).
En effet, l’activité
physique et la sédentarité sont deux facteurs indépendants exerçant un effet
inverse sur le risque de surpoids (Schneider
et al., 2007 ; Lioret et al., 2007). L’augmentation des
activités sédentaires au cours des dernières décennies exerce un effet délétère
sur la balance énergétique, en diminuant les dépenses liées à l’activité
physique et en augmentant les apports caloriques alimentaires à travers une
augmentation du grignotage et de la taille des portions consommées. La nature
des activités sédentaires aggrave le risque de surpoids, l’usage de la
télévision semblant induire le risque le plus élevé, notamment chez les jeunes
enfants (Rey-López et al., 2007).
Il est alors
nécessaire de tirer la sonnette d’alarme et de réagir dans le but de préserver
la santé des adolescents. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des
programmes d’éducation nutritionnelle, en se basant sur le programme scolaire,
et sur les médias, et de combattre les comportements sédentaires. De plus,
sensibiliser les adolescents des bienfaits des sports extrascolaires et du
danger de l’usage excessif des écrans sur leur santé et sur leurs relations
familiales. En effet, il est indispensable de faciliter l’accès à la pratique
d’activité physique en créant et en
augmentant les lieux publics dédiés, et ceci pour tous les adolescents quels
que soient les niveaux sociaux et économiques.
Remerciements. Nous tenons à
remercier très vivement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la
réalisation de ce travail, particulièrement les directeurs, les professeurs et
les élèves ainsi que la Direction de l’Académie Régionale de l’Education et de
la Formation de la Région Marrakech Tensift-Al Haouz.
Références Bibliographiques
Beauvais
C. 2001. Le développement personnel et les activités récréatives chez les
jeunes: un état de la question. Document de recherche des RCRPP n° F/16.
Calixte,
J. 2007. Milieu familial et réussite scolaire. Université d’Etat d’Haïti (UEH).
Faculté des Sciences Humaines. https://www.memoireonline.com/02/09/1981/m_Milieu-familial-et-reussite-scolaire.html
Coggins A, Swanton, Crombie H. 1999. Physical activity and inequalities.
A briefing paper. London, Health Education Authority.
Dowler, E. 2001. Inequalities in diet and physical activity in Europe. Public Health Nutrition.
4(2B):701-709.
El
Rhazi K. 2010. Transition nutritionnelle, facteurs associés et émergence des
maladies chroniques au Maroc: étude transversale en population générale adulte.
Thèse Doctorat, Université sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès Maroc.
El Youbi, A.
2004. La scolarisation et l’emploi des adolescents. Dans L’adolescence en
question : analyse des résultats de l’enquête sur les adolescents dans les
milieux semi urbain et rural de Marrakech. Centre d’études et de recherches
démographiques (CERED) in collaboration with (UNFPA), Morocco, pp.10-79.
Génolini J.P., Escalon H., 2010. Activités physiques, sportives et
sédentaires. La santé des collégiens en
France. Données françaises de l’enquête internationale Health Behaviour in
School aged Children (HBSC).
HBSC. 2007. Habitudes alimentaires et activités physiques chez les
adolescents de 11 à15 ans en Midi-Pyrénées. Résultats du volet régional de
l’enquête HBSC. ORS Midi-Pyrénées.
HCP. 2011. Enquête Nationale Anthropométrique. Haut-Commissariat au Plan du
Maroc(HCP). www.hcp.ma, Centre National de Documentation, Rabat
Kafatos, A.,
Manios, Y., Markatji, I., Giachetti, I., de Almeida, M. D. V., Engstrom, L. M.
1999. Regional, demographic and national influences on attitudes and beliefs
with regard to physical activity, body weight and health in a nationally
representative sample in the European Union. Public health nutrition, 2(1a),
87-96.
Kaoutar
K., Hilali MK., Loukid M. 2012. IMC et facteurs associés à la
sédentarité des adolescents de la ville de Marrakech (Maroc). Biom. Hum. et
Anthropol. 30 (3-4), p. 109-117.
Kremarik, F.
2000. A family affair: Children’s participation in sports. Canadian Social
Trends, 58, 20-24.
Laassakri A. 2014 Mode de vie, comportement alimentaire et état
nutritionnel des adolescents de la ville
de Marrakech. Thèse de Doctorat. Université cadi Ayyad,
Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech. 222p.
Lioret S., Maire
B., Voalatier JL., Charles MA. 2007. Child overweight
in France and its relationship with physical activity, sedentary behaviour and
socioeconomic status. Eur. J. Clin
Nutr., 61 : 509-16.
Ministère de la
Santé du Royaume du Maroc. 2012. Enquête Nationale sur la Population et la
Santé Familiale [ENPSF‐2011].
Omran A. 1997. The epidemiological transition. A theory of the
epidemiology of population change. Milbank Mem Fund. Q: 49(4): 509-38.
Orban-Segebarth
R., Plissart C. et Brichard M.C. 1982. Relations entre la stature et quelques
facteurs mésologiques chez des enfants demeurant en Belgique, Bull. Soc. Roy. Belge Anthrop.
Préhist, 93, 87-95.
Peters, A. 2002. Is your community child-friendly? Canadian Social Trends, 11: 2-5.
Popkin BM. 2001. The nutrition transition and obesity
in the developing world. World. J. Nutr., 131: 871S-3S.
Popkin BM., Duffey K., Gordon-Larsen, P. 2005. Environmental influences
on food choice, physical activity and energy balance. Physiology et Behaviour, 86(5):603-613.
Rey-Lopez JP., Vicente-Rodriguez G., Biosca M., Morenol A. 2007. Sedentary behaviour and obesity dvt in children and adolescents. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis.,
18(3) : 242-51.
Schneider M., Dunton GF., Cooper DM. 2007. Media use and obesity in
adolescent females. Obesity, 15, 2328-2335.
Simon C., Klein
C., Wagner A. 2005. La sédentarité des enfants et des adolescents, un enjeu de
santé publique. Journal de Pédiatrie
et de Puériculture, 18, 217–223.
Sobal J., Stunkard AJ. 1989 Socioeconomic status and obesity: a review
of the literature. Psychological
Bulletin, 105(2) 260-275.
Thibault H, Contrand B, Saubusse E, Baine M,
Maurice-Tison S. 2010. Risk factors for overweight and obesity in French
adolescents: Physical activity, sedentary behavior and parental
characteristics. Nutrition,
26:192-200.