
Attazagharti, N., Soulaymani, A., Ouami, L., Mokhtari, A., Soulaymani, B. R., 2009, Intoxications médicamenteuses et facteurs de risque influençant l’évolution des patients. Antropo, 19, 33-39. www.didac.ehu.es/antropo
Intoxications médicamenteuses et facteurs de risque influençant l’évolution des patients
Medicinal intoxications and risk factors influencing the evolution of patients
N. Attazagharti1,
A. Soulaymani2, L. Ouami2, A. Mokhtari1, B. R.
Soulaymani2
1Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté
des sciences, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
2Centre
Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. Rabat.
Correspondance: Attazagharti N. Laboratoire de Génétique et
Biométrie, Faculté des sciences, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc. E-mail :
Nabila_at1975@hotmail.com
Mots clés : Accidentelle, Ingestion, Intoxication, Médicaments, Volontaire.
Key words: Accidental, Ingestion, Intoxication, drugs, voluntary.
Resume
Les intoxications médicamenteuses sont dues à l’ingestion accidentelle ou volontaire de médicaments. La voie orale demeure la voie d’absorption la plus utilisée, le risque ou les conséquences dépendent de la quantité ingérée et de la nature des produits.
Ce travail, fondé sur l’analyse statistique de 8501 cas d’intoxications
médicamenteuses déclarés entre 1980 et 2005, à l’unité de toxicivigilance du
centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, a montré que l’âge moyen de
la population intoxiquée est de 21,02±0,12 ans, 68% des intoxiqués sont de sexe
féminin, le sexe ratio est ainsi de 0.46, avec une différence hautement
significative P<0,001 en faveur du sexe féminin ![]() : 1156,88. Les intoxications
médicamenteuses ont lieu surtout en milieu urbain avec 88%, le
: 1156,88. Les intoxications
médicamenteuses ont lieu surtout en milieu urbain avec 88%, le ![]() : 4166,76 est à une valeur hautement
significative P<0,001.
: 4166,76 est à une valeur hautement
significative P<0,001.
En ce qui concerne les signes cliniques, 43,16% des patients représentent des troubles digestifs associés ou non à des signes neurologiques 32,46%, cardiovasculaires 11,86%, respiratoires 7,94%, neurovégétatifs 2,82%, cutanés 1,04% ou rénaux 0,36%.
8,23% des patient se présentent en classe I, 61,22% en classe II, 30,47% en classe III et 0,08% en classe IV. Le taux de létalité pour la classe de gravité III et IV à l’admission est respectivement de 1,83 % et 100%.
Le taux de létalité
générale est de 0,95% soit 53 décès sur l’ensemble des intoxiqués.
Abstract
Medicinal intoxications are due to the voluntary or accidental ingestion
of medicines. The oral tract remains the most used way of absorption. The risk
and consequences depend on the ingested quantity.
This work is based on the statistical analysis of 8501 cases of
medicinal poisoning declared to the toxicvigilance unit of the Poison Control and Pharmacovigilance
Center of Morocco between
1980 and 2005. The results showed that the mean age of poisoned population was 21.02±1.12 years and that 68% were female cases. The
sex-ratio of 0.46 was highly significant (![]() : 1156.88; p<0.001).
Moreover, the medicinal intoxications occur more often in urban zones with 88%
(
: 1156.88; p<0.001).
Moreover, the medicinal intoxications occur more often in urban zones with 88%
(![]() : 4166.76; p<0.001).
: 4166.76; p<0.001).
As far as the clinical signs are concerned, 43.16% of patients displayed
digestive troubles associated or not with neurological (32.46%), cardiovascular
(11.86%), respiratory (7.94%), neurovegetative (2.82%), cutaneous (1.04%) or
renal signs (0.36%).
Furthermore, 8.23% of patients were admitted with class I, 61.22% with
class II, 30.47% with class III and 0.08% with class IV. The lethality rates of
the admission classes III and IV were 1.83% and 100% respectively.
The general lethality was 0.95%, 53 of poisoned patients died.
Introduction
Qu’elles soient accidentelles ou volontaires, les intoxications médicamenteuses sont un véritable fléau dans de nombreux pays du monde, ainsi une cause fréquente d’admission aux urgences et en réanimation.
Le Maroc est l’un des pays concerné par cette pathologie toxicologique. La déclaration de tous les cas d’intoxications est devenue obligatoire à partir de 1980, suite à une circulaire ministérielle; chaque province et préfecture médicale du royaume devraient fournir au centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc le relevé de tous les cas d’intoxications.
Au Maroc l’intoxication d’origine médicamenteuse occupe la deuxième place après les intoxications par piqûres de scorpions représentant ainsi 23% du total des intoxications. En 2002 la première cause d’appel au CAP de Lille pour des enfants de moins de 15 ans était les intoxications médicamenteuses 19% (Mathieu-Nolf, 2004).
La présente étude vise à déterminer les facteurs qui peuvent influencer l'évolution de des intoxications médicamenteuses au Maroc. Et de connaître les facteurs épidémiologiques et cliniques affectant la sévérité de cette pathologie afin d'améliorer la gestion de cette dernière et réduire la morbidité et la mortalité provoquées par les intoxications médicamenteuses.
Dans les pays occidentaux, la prédominance des intoxications médicamenteuses rend compte du pourcentage faible 3% des intoxications admises en réanimation (Watson et al., 2004).
Parmi les intoxications aigues en France, les médicaments occupent toujours la première place (Bismuth, 1997). En France, l’incidence annuelle actuelle des intoxications médicamenteuses volontaires est estimée à environ 4 pour 1000 habitants (Lambert et al., 1997).
De 1993 à 2002, en Angleterre et Pays de Galles, le taux de mortalité standardisé par intoxication médicamenteuse est passé de 9 à 7 par million d’habitants (Morgan et al., 2004).
Materiels et
methodes
Les fiches de déclaration des cas d’intoxication (fiches de Toxicivigilance, FTV) recueillies par le centre anti poison du Maroc entre 1980 et 2005.
Notre étude regroupe toutes les FTV où le diagnostic d’intoxication médicamenteuse a été retenu lors de leur premier passage dans une structure sanitaire. La FTV comporte beaucoup de renseignement sur le patient et elle est remplie par le personnel médical ou paramédical de ces structures sanitaires.
La méthodologie consiste en la saisie de toutes les données et puis en l’analyse statistique de ces derniers. Les analyses statistiques consistent au calcul de la létalité spécifique d’un facteur donné qui se réalise par le calcul du nombre de décès causé par l’intoxication médicamenteuse et le nombre des intoxiqués.
Le test de ![]() , qui permet de savoir si une différence est
significative.
, qui permet de savoir si une différence est
significative.
L’estimation du risque relatif (RR) qui mesure l’association de présence ou d’absence d’un facteur et l’occurrence d’un événement. Il y a une différence significative dans l'occurrence d'un certain événement si l'intervalle de confiance de 95% pour le rapport relatif de risque n'inclut pas 1.
Resultats et
interpretations
Les intoxications par médicaments touchent toutes les tranches d’âge avec une prédominance chez les patients dont la tranche d’âge est comprise entre 20-30 ans. La moyenne d’âge des patients est de 21,02± 0,12 ans.
Le sexe ratio (homme /femme) est de 0,46, le milieu urbain 88% est plus touché que le milieu rural 12%.
8,23% des patient se présentent en classe I, 61,22% en classe II, 30,47% en classe III et 0,08% en classe IV. Les signes cliniques les plus répondus sont les signes digestives et neurologiques représentant respectivement 43,16% et 32,46% du total des signes. L’évolution est favorable dans 99% des cas, 1% des patients décèdent.
Afin de déceler la distribution des enfants de celle des adultes, nous avons reparties les patients selon la tranche d’âge inférieur à 15 ans ou supérieur ou égale à 15 ans. Le nombre maximal d’intoxication et de décès est observé chez les femmes dont l’âge est supérieur ou égale à 15 ans avec 26 cas de décès pour les femmes et 19 cas pour les hommes. La létalité spécifique est élevée chez le sexe masculin 17,45% appartenant à la tranche d’âge supérieur ou égale à 15 ans, elle de 8,42% chez le sexe féminin de la même classe d’âge. Pour les patients de la tranche d’âge inférieur à 15 ans, cette létalité est de 5% pour le sexe féminin et 7,25% pour le sexe masculin. Le sexe ratio m/f des décès est légèrement en faveur du sexe masculin avec une valeur de 1,41.
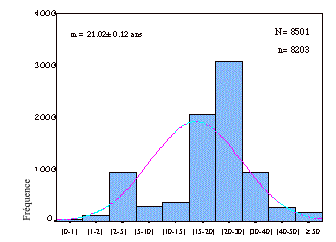
Figure 1. Répartition de l’intoxication selon l’âge
Figure 1. Repartition of cases according to the age
|
Sexe |
Féminin |
Masculin |
|
|
|
Total |
|
|
68% |
32% |
|
|
|
8382 |
|
Milieu |
Urbain |
Rural |
|
|
|
|
|
|
88% |
12% |
|
|
|
7215 |
|
Classe à l’admission |
Grade I |
Grade II |
Grade III |
Grade IV |
|
|
|
|
8,23% |
61,22% |
30,47 |
0,08% |
|
2867 |
|
Signes cliniques |
Digestifs |
Neurolo- giques |
Cardiovas- culaires |
Respira- toires |
Neurovégé-tatifs |
|
|
|
43,16% |
32,46% |
11,86% |
7,94% |
2,82% |
7792 |
|
Evolution |
Guérison |
Décès |
|
|
|
|
|
|
99% |
1% |
|
|
|
5509 |
Tableau 1. Caractéristiques des intoxiqués.
Table 1. Characteristics
of intoxicated patients.
|
L’âge des intoxiqués |
<15 ans |
≥15 ans |
||||||
|
|
21% |
97% |
||||||
|
Sexe des intoxiqué |
Féminin |
Masculin |
Féminin |
Masculin |
||||
|
|
51,89% |
48,11% |
73,18% |
26,82% |
||||
|
Evolution selon le sexe et l’âge |
Décès |
Favorable |
Décès |
Favorable |
Décès |
Favorable |
Décès |
Favorable |
|
|
n= 3 |
n=598 |
n=4 |
n=548 |
n=26 |
n=3057 |
n=19 |
n=1069 |
|
Létalité spécifique |
5% |
7,25% |
8,42% |
17,45% |
||||
Tableau 2. Létalité spécifique selon l’âge et le sexe.
Table 2. Specific lethality according to age and sex.
|
|
|
Fréquence |
Décès |
RR |
IC95% |
|
P |
|
sexe |
Masculin |
2634 |
30 |
0,58 |
0,30-0,32 |
1156,88 |
< 0,001 |
|
Féminin |
5748 |
23 |
|||||
|
milieu |
Urbain |
6328 |
33 |
0,41 |
0,12-0,13 |
4103,18 |
< 0,001 |
|
Rural |
887 |
11 |
|||||
|
Classe d’admission |
III |
873 |
16 |
3,637 |
0,68-0,71 |
435,19 |
< 0,001 |
|
IV |
2 |
2 |
|||||
|
âge |
<15 ans |
1720 |
7 |
0,25 |
4,01 E-02 |
6803,99 |
< 0,001 |
|
≥15 ans |
6483 |
45 |
4,90 E-02 |
Tableau 3. Facteur de sévérité en relation avec
l’évolution des patients.
Table 3. Severity factor in relation with the evolution of patients.
|
Type de médicaments |
Circonstance |
Evolution |
Létalité spécifique ‰ |
|||
|
Volontaire Suicidaire |
Accidentelle |
Favorable |
Décès |
|||
|
Anxiolytique |
858 |
97,20% |
271 |
1038 |
4 |
3,8 ‰ |
|
Anticonvulsivant |
264 |
99,24% |
79 |
314 |
8 |
24,8 ‰ |
|
Neuroleptique |
140 |
95,71% |
42 |
156 |
2 |
12,6 ‰ |
|
Antalgique antipéryitique |
146 |
95,90% |
40 |
196 |
- |
- |
|
Antihistaminique |
118 |
99,15% |
40 |
127 |
1 |
7,80 ‰ |
|
Antibiotique |
99 |
95,95% |
38 |
120 |
- |
- |
|
Contraceptifs oraux |
72 |
93,05% |
42 |
110 |
- |
- |
|
Antidépresseur |
82 |
98,78% |
19 |
76 |
2 |
25,6 ‰ |
|
Antiparkinsonien |
21 |
90,47% |
9 |
22 |
1 |
43,4 ‰ |
|
Antiasthmatique |
31 |
100% |
10 |
37 |
1 |
26,31 ‰ |
|
Médicament non précisé |
2469 |
98,78% |
797 |
2818 |
34 |
12,06 ‰ |
Tableau 4. Létalité spécifique au type de médicament
administré.
Table 4. Specific
lethality according to the type of ingested drugs.
|
Région |
Fréquence |
Nombre de décès |
Létalité spécifique ‰ |
|
Grand Casablanca |
1179 |
2 |
5,06 |
|
Doukala -Abda |
598 |
5 |
8,30 |
|
Mekhnès-Tafillelt |
518 |
1 |
1,92 |
|
Tanger- Tetouan |
481 |
3 |
6,2 |
|
Tadla Azilal |
454 |
10 |
21,55 |
|
Souss- massa -Daraa |
400 |
11 |
26,76 |
|
Marrakech -Tensift al Haouz |
372 |
4 |
10,63 |
|
Oriental |
294 |
2 |
6,75 |
|
Taza- Al Houceima |
286 |
1 |
3,48 |
|
Fès-Boulmane |
663 |
3 |
11,36 |
|
Chaouia Ourdigha |
216 |
3 |
13,69 |
|
Gharb chrarda beni hssen |
123 |
2 |
16 |
|
Rabat-salé- Zemour-Zaer |
102 |
1 |
9,71 |
|
Laayoun Boujdour |
50 |
- |
- |
|
Guelmim-Es-Semara |
36 |
- |
- |
|
Oued Dahab Lagouira |
- |
- |
- |
Tableau 5. Létalités spécifiques aux régions.
Table 5. Specific lethality according to the regions.
Le tableau 3 représente le calcul du risque relatif (RR) des facteurs d’aggravation influençant sur le pronostic vital des patients intoxiqués. On constate à partir de ces résultats que la classe d’admission est le seul facteur qui présente une association significative avec les décès. Le RR est de 3,63 (IC95% : 0,68%-0,71%). On peut dire donc la classe III ou IV est un facteur de risque qui influence sur le pronostic vital des intoxiqués.
La répartition des cas selon les classes de médicaments incriminés montre que les anxiolytiques viennent au premier rang avec un pourcentage de 46,43% suivis par la classe des anticonvulsiants 13,8% puis par la classe des neuroleptiques 8%.
La plut part des intoxications volontaires sont d’origine suicidaire puisque qu’il représentent une valeur supérieur à 90% chez toutes les familles de médicaments représentées sur le tableau. Le taux de létalité spécifique le plus élevé est observé dans la famille des médicaments des parkinsoniens avec un taux de 43,4‰. Je signale que je n’est traiter dans mes le tableau 5 que les familles de médicament dont on a retrouvés des cas de décès.
Le tableau 5 montre que les fréquences les plus élevées ont été enregistrées dans la région de la grande Casablanca avec 21,9% des cas de l’ensemble des régions du Maroc, la province de Casablanca représente 1381 cas de l’ensemble des intoxications dans cette région. Le nombre le plus élevé de décès est observé dans la région de Souss-Massa- Daraa avec 11 cas de décès et avec un taux de létalité spécifique 26,76 ‰.
Discussion
L’analyse des données des fiches de recueillis auprès du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc à l’unité de toxicivigilance, conduit aux constatations et résultats suivants :
La moyenne d’âge des intoxiqués est de 21,02± 0,12 ans, avec une prédominance chez la tranche d’âge comprise entre [20-30] ans, en 2002 les intoxications médicamenteuses représentaient 45% des appels aux CAP américains avant l’âge de 19 ans (Watson et al., 2003).
Le sexe féminin est plus
touché par cette pathologie et représente 68,57%, le sexe ratio est ainsi de
0,46. Le nombre maximal d’intoxication et de décès est observé chez les femmes
dont l’âge est supérieur ou égale à 15 ans avec respectivement. La létalité
spécifique est élevée chez le sexe masculin 17,45% ayant un âge supérieur ou
égale à 15 ans en comparaison avec le sexe féminin de la même classe d’âge
8,42% et ceux de la tranche d’âge inférieur à 15 ans qu’ils soit de sexe
masculin ou féminin. Le sexe ratio m/f des décès est largement en faveur du
sexe masculin.
Concernant le lieu de résidence des intoxiqués, nos résultats montrent que les intoxications médicamenteuses ont lieu en milieu urbain dans 88% des cas ceci s’explique par le fait de l’éloignements géographique des structures sanitaires du milieu rural, et l’absence des médecins spécialistes sont autant des facteurs qui ne favorisent pas la consommations des médicaments mais par contre de l’automédication traditionnel qui s’exerce par la majorité de la population du milieu rural se basant ainsi sur d’autres préparations à base d’autres produits ainsi les médicament restent un produit moins consommable dans le milieu rural 12% contrairement au milieu urbain ou la consommation augmente d’une années à l’autre.
En ce qui concerne les signes cliniques, la majorité des patients s’est présentée avec des troubles digestifs (43,16%) associés ou non à des signes neurologiques (32,46%), des signes cardiovasculaires (11,865%), des signes respiratoires (7,94%), des signes neurovégétatifs (2,82%), des signes cutanés (1,40%) ou encore des signes rénaux (0,36%). Les symptômes varient selon le type et la quantité de médicaments consommés. Les manifestations neurologiques les plus fréquentes regroupent tous les degrés d’altération de la conscience jusqu’au coma, En France, les intoxications aux neuroleptiques semblent rester stable, le pourcentage variant cependant entre 4,7% et 8,4%. (Billy et al., 1998). Les complications respiratoires dues à l’altération de la conscience (dépression respiratoire centrale, obstruction mécanique des voies aériennes supérieures, pneumopathie, d’inhalation) sont fréquentes au cours des intoxications médicamenteuses et peuvent altérer le pronostic d’intoxications a priori bénignes ou prolonger le séjour en réanimation (Bradberry et al., 1999; Isbister et al, 2004).
Le taux de létalité
spécifique à l’âge et au sexe a permis de distinguer différentiels groupes, un
premier groupe dont la létalité reste élevée et qui est constitué par les
enfants dont l’âge est <15, cela peut être due expliqué par le fait que les
parents laissent en effet traîner des médicaments qu’ils jugent inoffensifs et
aussi par le fait qu’à l’allaitement puisque la plupart des médicaments passent
dans le lait maternel. La banalisation de cet acte ne fait qu’aggraver la
situation.
Un deuxième groupe dont la létalité est plus élevée, composé de personnes adulte dont l’âge est supérieur ou égale à 15 ans, cet intoxication est généralement volontaire (tentative de suicide) chez les adultes contrairement à celle du premier groupe qui est due à un acte accidentel. Les suicides de jeunes enfants sont rares, mais ne doivent pas être ignorés: ils doivent être systématiquement évoqués en cas d’ingestion de médicament après l’âge de six ans, au-delà du quel l’intoxication accidentelle devient moins plausible (Cremer et al., 2004).
La répartition des cas selon les classes de médicaments incriminés montre que les anxiolytiques viennent au premier rang avec un pourcentage de 46,43% suivis par la classe des anticonvulsiants 13,8% puis par la classe des neuroleptiques 8%. Les médicaments les plus fréquemment en cause avant six ans étaient les antalgiques (16,6% des médicaments), les topiques cutanés (15,8%) ; les antitussifs et apparentés (11,4%), les médicaments gastro-intestinaux (7,1%), et les antibiotiques et les antiparasitaires (6,2%) (Watson et al., 2003). L’intoxication volontaire aux médicaments psychotropes reste l’étiologie la plus fréquente en Europe (Isacsson et al., 1995).
Les intoxications accidentelles représentent 24,43% tan disque, les suicidaires représentent une valeurs très élevée 75,56%. Les médicaments restent très largement les principaux responsables des intoxications accidentelles domestiques (Baudet et al., 2004).
La plut part des intoxications volontaires sont d’origine suicidaire puisque qu’il représentent une valeur supérieur à 90% chez la totalité des familles de médicaments étudiés. A l’adolescence, la majorité des intoxications est volontaire. L’absorption de médicaments en est la plus fréquente à cet âge: 65 à 86% des cas selon (CDC, 1995; Choquet el al, 2003; Le Heuzey et al., 1995).
Les intoxications volontaires sont plus grave chez les garçons que chez les filles, et les médicaments ingérés sont plus toxiques (CDC, 1995 ; Choquet el al, 2003).
On constate à partir de ces résultats
que la classe d’admission est le seul facteur qui présente une association
significative avec les décès. Le RR est de 3,63 (IC95% : 0,68%-0,71%). On peut dire donc la classe III ou IV est un
facteur de risque qui influence sur le pronostic vital des intoxiqués.
Le taux de létalité est de 0,95% soit 53 décès sur l’ensemble des intoxications médicamenteuses. Il y aurait plus de 2000 décès par intoxication médicamenteuse chaque année en France (Saviuc et al., 1999). Aux Etats-Unis, dans l’état de l’Utah, il était relevé une augmentation d’un facteur 5 du nombre du mort toxiques passant de 79 en 1999 à 391 en 2003 (CDC, 2005).
Conclusion
Au terme de cette étude, nous concluons que les intoxications par médicaments constituent un réel problème de santé publique.
Les intoxications médicamenteuses très fréquentes au Maroc, ont des conséquences économiques pour les individus, les familles, les communautés, les entreprises et l’état. Elles font également peser un lourd fardeau sur les systèmes de soins de santé.
Pour maîtriser les facteurs de risque, des compagnes de sensibilisation et d’information du grand publique doivent être organisé avec la participation de professionnels du système publique.
Ces divers actions de prévention doivent être programmées dans tous les établissements public et privés afin d’améliorer le comportement des utilisateurs et de les responsabiliser sur les règles d’utilisation des médicaments en toute sécurité.
Références
Baudet, M., Amouroux, N., Houin, G., 2004, Intoxications accidentelles domestiques. EMC- Toxicologie-Pathologie, 1, 29-34.
Billy, F., Montaz, L., Perault, M.C., Vandel,
B., 1998, Étude des intoxications médicamenteuse volontaires reçues dans une
unité d’acceuildes urgences, Therapie 53, 553-558.
Bismuth,
C. 1997, Les intoxications médicamenteuses aiguës, Rev. Prat. 47, 714–715
Bradberry, S.M., Vale, J.A., 1999, Intoxications par les antidépresseurs. In : A. Jaeger and J.A. Val, Editors, Intoxications aiguës, Elsevier, Paris, pp. 232-248.
CDC, 1995, Fatal and nonfatal suicide attempts among adolescents—Oregon, 1988-1993. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 44, 312-315.
CDC, 2005, Increase in poisoning deaths caused by non-illicit drugs, Utah, 1991-2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 54, 33-36.
Choquet, M., Granboulane, V., 2003, Jeunes suicidants à l’hôpital. Le Carnet Psy 85, 14-19.
Cremer, R., Mathieu-Nolf, M., 2004,
Epidémiologie des intoxications de l’enfant. Archive de Pédiatrie, 11, 677-679
Isbister, G.K., Downes, F., Sibbritt, D., Dawson, A.H., Whyte, I.M., 2004, Aspiration pneumonitis in an overdose population: frequency, predictors and outcomes. Crit. Care. Med. 32, 88-93.
Isacsson,
G., Wasserman, D., Bergman, U., 1995, Self-poisonings with antidepressants and
other psychotropics in an urbanarea of Sweden. Ann. Clin.
Psychiatry. 7, 113-118
Lambert, H., Manel, J., Bellou, A., el Kouch, S., 1997, Morbidité et mortalité par intoxications médicamenteuses aigues en France. Rev. Prat. 47: 716-720.
Le Heuzey, M.F., Isnard, P., Badoual, A.M., Dugas, M., 1995, Enfants et adolescent suicidants. Arch Pediatr 2, 130-135.
Mathieu-Nolf, M., 2004, Rapport d’activité 2002 du centre antipoison des régions Nord, Pas-de-Calais, et Picardie. Centre Antipoisons de Lille.
Morgan,
O., Griffths, C., Baker, A., Majeed, A., 2004, Fatal toxicity of
antidepressants in England and wales 1993-2003. Health Stat. Q. 23, 18-24.
Saviuc, P., Hanna, J., Dnel, V., 1999, Épidémiologie des intoxications: plus de 2000 par an. Rev. Prat. 481, 2054-2057.
Watson, W.A., Litovitz, T.L.,
Klein-Schwartz, W, Rodggers, G.C., Youniss, J., Reid, N., Rouse, W.G., Rembert,
R.S., Borys, D., 2004, 2003 Annual Repport of the American Association of
Poison Control Centres Toxic Exposure Surveillance System. Am. J. Emerg. Med.
22, 335-404.
Watson, W.A., Litovitz, T.L., Rodgers, G.C., Klein-Schwartz, W., Youniss, J., Rose, S.R., 2003, 2002 Annual Report of the American Association of Poison Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am. J. Emerg. Med. 21, 353-421.