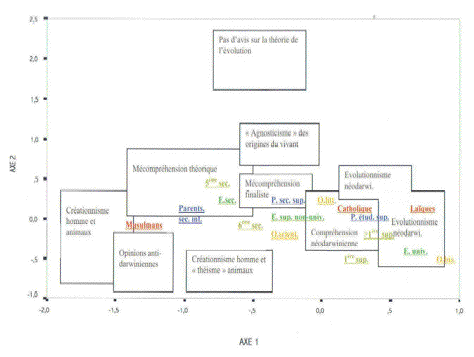Perbal, L., Susanne, C. et Slachmuylder
J.-L., 2006, Evaluation de l’opinion des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur de Bruxelles
vis-à-vis des concepts d’évolution (humaine). Antropo, 12, 1-26. www.didac.ehu.es/antropo
Evaluation
de l’opinion des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur de Bruxelles vis-à-vis des concepts
d’évolution (humaine)
Evaluation
of the students opinion about the (human) evolution in the secondary and
postsecondary education in Brussels.
(Secondary school consists of an education level for teenagers from 12 to 18 years old. Are considered as postsecondary all types of education conducted after secondary school.)
Laurence Perbal1,
Charles Susanne2 et Jean-Louis Slachmuylder3
1
Université Libre de Bruxelles, Aspirante FNRS en Philosophie des sciences
(unité ULB640), Campus du Solbosch, CP175, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050, Brussels, Belgium, lperbal@ulb.ac.be.
2
Vrije Universiteit Brussel, Anthropologie, Pleinlaan 2, 1050 Brussels,
Belgium, scharles@vub.ac.be.
3 Université Libre de Bruxelles, Anthropologie et génétique humaine, Campus du Solbosch, CP192, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050, Brussels, Belgium, jlsla@tiscalinet.be.
Mots clés: évolution, enseignement, créationisme, anti-évolutionisme
Key words: evolution, education, creationism, antievolutionism
Résumé
Le refus de la théorie de l’évolution semble principalement motivé par des raisons religieuses et les attaques anti-darwiniennes se multiplient en Europe. Nous avons donc entrepris d’évaluer l’opinion des étudiants bruxellois vis-à-vis du concept d’évolution et des théories darwinienne et néodarwinienne de l’évolution. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons procédé à une enquête par questionnaire à choix multiples. Au sein de l’échantillon total (1163 individus), près d’un quart des répondants a choisi les réponses adhérant à l’explication créationniste de l’origine de l’homme. Cette part est moins importante quand il s’agit des animaux, signalant la spécificité de la problématique qui entoure l’homme dans les débats entre évolution et création. Dans le cadre de notre étude, la très grande majorité des étudiants choisissant les réponses créationnistes sont de confession musulmane. Nous avons pu montrer que les convictions religieuses influencent négativement la compréhension, l’acceptation et l’opinion des étudiants vis-à-vis de la théorie de l’évolution et à l’inverse, le degré d’instruction tend à les favoriser. Mais ces influences varient en fonction de la confession, catholique ou musulmane, des étudiants.
Abstract
The rejection of the theory of evolution seems to be mainly due to religious beliefs and the antidarwinian attacks increase in Europe. Therefore we decided to evaluate the Brussels students opinion about evolution and about the (neo)darwinian theory. We conducted a survey using a multiple-choice questionnaire for this purpose. Almost a quarter of the total sample of respondent (1163 respondents) choose the responses that accept the creationist explanation of the origin of human beings. This ratio is lower as far as the animals are concerned, refering to the specificity of human being in evolution/creation debates. In this survey, most of students, who choose the creationist reponses, are Muslim. We demonstrated that religious beliefs have a negative influence on the students’s understanding, acceptation and opinion about the theory of evolution whereas the educational level tends to improve it. But these influences change functions of students religious identity, Catholic or Muslim.
I. Introduction
I.1. La théorie
de l’évolution
Le 24 novembre 1859, Charles Darwin (1809-1882), naturaliste britannique, publie De l’Origine des Espèces au Moyen de la Sélection Naturelle puis, en 1872, La Descendance de l’Homme et la Sélection Sexuelle. Dans ces ouvrages, il remet non seulement en question l’idée d’un monde créé par Dieu il y a quelques milliers d’années mais de plus, il refuse à l’homme une quelconque place privilégiée, qu’il soit la finalité de la création ou celle des processus évolutifs, comme le défendait Jean-Baptiste Lamarck avant lui (1744-1829). Non seulement l’homme est, en partie, le résultat du hasard (Gould, 1991) mais en plus, il fait partie intégrante de la nature et est donc soumis aux mêmes lois que n’importe quel autre être vivant. Il base sa théorie sur deux principes fondamentaux: les espèces n’ont pas été créées en l’état et le moteur de l’évolution est la sélection naturelle. Ainsi, la théorie de l’évolution oblige l’homme à deux remises en questions essentielles. Premièrement, elle rend impossible une lecture littérale des textes de la Genèse et invite plutôt à les interpréter de façon symbolique. Deuxièmement, elle réintroduit l'homme dans la nature alors qu'il s'en croyait détaché en tant qu'élu de Dieu. Il n’est «plus que» l’espèce humaine. La théorie de l’évolution au moyen de la sélection naturelle de Charles Darwin est donc rendue publique en 1859. Grâce à une multitude de preuves récoltées pendant plus de vingt ans, il réussit au fil des ans à convaincre les biologistes. Ensuite, au début des années 1940, naît la théorie synthétique de l’évolution, aussi appelée néodarwinisme. «En faisant le lien entre les paléontologues, les généticiens, les botanistes et les autres, la théorie synthétique, comme son nom l’indique, a rassemblé les biologistes sous la bannière de l’évolutionnisme darwinien.» (Mayr E. dans N.A. Campbell, 1995). Il est vrai que la façon dont se déroule les processus d’évolution est toujours discutée, notamment en ce qui concerne le rôle de la sélection naturelle (Gould et Eldredge, 1993). Mais il est indéniable que la théorie de l’évolution, dont le personnage phare est Charles Darwin, représente les racines conceptuelles de toute la biologie actuelle. Cette phrase de Dobzhansky (1973), généticien américain fondateur du néodarwinisme, a été maintes fois citée: «Rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’évolution.» Et pourtant, l’acceptation de l’évolution n’est toujours pas la règle à travers le monde.
Du point de vue théorique, aucun des concepts de la théorie de
l’évolution («lutte pour l’existence», «adaptation»,
«reproduction différentielle», «variation interindividuelle»,...) ne peut se comprendre indépendamment
des autres (Mayr, 1982). Ils forment un tout cohérent, le squelette conceptuel
de la théorie de l’évolution. C’est peut-être pour cette raison que l’évolution
est souvent considérée comme une des matières les plus difficiles à comprendre
(Desmates et al.,
1995). En effet, de nombreuses études ont montré que la plupart des étudiants
entre et sort des salles de classes avec d’importantes mécompréhensions de la
théorie de la sélection naturelle (Firenze, 1997). Ces mécompréhensions
concernent surtout les concepts de variation et d’adaptation. Les variations
sont souvent perçues comme le résultat des modifications environnementales: les
variations suivent les pressions de sélection et ne les précèdent pas.
L’environnement joue alors un rôle instructif et pas sélectif (Kupiec et
Sonigo, 2000). C’est l’opposition classique entre les conceptions lamarckiennes
et darwiniennes de l’évolution. Ainsi, l’évolution est perçue comme un effort
intrinsèque fourni par les individus dans le but de s’adapter à leur
environnement. L’adaptation répond à un besoin des individus (Bishop et Anderson, 1990; Samarapungavan et Wiers,1997; Moore et al., 2002). Nous tenterons dans ce travail de déterminer la maîtrise que
possèdent les étudiants bruxellois de ces concepts d’évolution.
En Belgique, l’enseignement de l’évolution est au programme d’études du cours de biologie de la dernière année des études secondaires, c’est-à-dire la 6ème année secondaire. Théoriquement, les élèves de l’enseignement général et technique de transition doivent pouvoir, à la fin des leçons sur l’évolution et sur les sujets qui s’y rapportent, développer les hypothèses explicatives de l’émergence de la vie sur terre, connaître les différentes théories de l’évolution (lamarckisme, darwinisme, néodarwinisme), développer les arguments en faveur de l’évolution (paléontologique, embryologique, moléculaire, biogéographique, anatomique,…), retracer les grandes étapes de l’évolution de l’espèce humaine et maîtriser les concepts d’adaptabilité et de survie d’une espèce (Programme du cours de biologie de l’Enseignement secondaire général et technique de transition du 3ème degré). Pratiquement, l’enseignement dépend toujours des circonstances (pédagogiques, disciplinaires, individuelles,…) et des préférences de l’enseignant. Les connaissances des élèves sortant de l’enseignement général et de technique de transition ne sont donc pas uniformes.
Un enseignement rigoureux de l’évolution peut-il avoir une influence sur l’opinion des étudiants vis-à-vis des concepts d’évolution? Il semble que la compréhension de la théorie de l’évolution soit indépendante de son acceptation (Sinatra et al., 2003) et l’enseignement de l’évolution ne paraît pas avoir d’influence significative sur la «croyance» des étudiants en l’évolution (Demastes et al., 1995). Pourtant, Downie et Barron (2000) ont montré que la majorité des étudiants rejetant l’évolution paraît certains que les preuves de l’évolution sont faibles. Ainsi, ils constatent un déclin significatif des opinions anti-évolutionnistes parmi des étudiants en biologie au cours de leurs années d’études. Quoi qu’il en soit, la littérature proposant de nouvelles techniques didactiques d’enseignement de l’évolution est riche (ex.: Nickels et al.; 1996, Downie et Barron, 2000; Passmore et Stewart, 2001; Alters et Nelson, 2002; Sinatra et al., 2003).
En partant de l’hypothèse que l’instruction, dans sa globalité, développe l’esprit critique et l’ouverture d’esprit sur le monde et les différentes connaissances existantes, le degré d’instruction des étudiants peut-il avoir une influence sur les opinions anti-évolutionnistes? Evaluer l’opinion des étudiants bruxellois nous permettra de développer des pistes de réponses.
I.2. Le refus
de l’évolution
I.2.1. Une
question de religion: le créationnisme
Brian. J. Alters
(1999) souligne que l’adjectif «créationniste» est souvent utilisé pour
catégoriser la grande variété de personnes qui rejette l’évolution. Mais pour
lui, ce terme est bien trop vague que pour permettre une véritable
compréhension des causes de ce rejet. C’est pourquoi, il décrit trois
catégories différentes de «créationnistes»: les littéralistes, les
progressistes et les théistes.
Les littéralistes sont ceux qui croient que le texte de la Genèse doit être interprété littéralement. La Bible est une description historique des évènements de la création et chaque jour correspond à un jour solaire. Dans le cadre de cette interprétation la terre a entre 4000 et 10000 ans, c’est pourquoi ils sont souvent appelés les «young earth creationists» (Morris et Morris, 1996 dans Alters, 1999). Les progressistes ou «old earth creationists» reconnaissent quant à eux que la terre a plus de 10000 ans. Chaque jour de la création doit être interprété comme correspondant à une longue période de temps. La vie a donc été créée et a connu des périodes d’extinctions suivies de re-créations. Il n’existe pas de macroévolution. Enfin, en ce qui concerne les théistes, ils acceptent l’évolution mais c’est Dieu et non le hasard qui est responsable de l’émergence de l’homme (Van Till, 1996 dans Alters, 1999). Nous comprenons que cette dernière position est en opposition avec l’évolution définie par le néodarwinisme même si elle l’est dans une moindre mesure que dans les deux premiers groupes.
Quelle est la position des deux principales religions de Belgique, c’est-à-dire les religions catholique et musulmane, sur ces questions d’évolution ?
I.2.1.1. Le catholicisme
En ce qui concerne la position officielle de l'Eglise catholique au sujet de l'évolution, elle semble ambiguë bien que proche des positions théistes définies par Alters (1999). En 1996, le pape Jean-Paul II déclare à l'Académie pontificale des sciences que la théorie de l'évolution ne doit plus être considérée comme une simple hypothèse (Jean-Paul II, 1997). L'évolution est matérielle, elle ne concerne que le corps de l'homme et il faut voir l'intervention divine dans les processus évolutifs. L'âme humaine est issue de la création divine et est indépendante de l'évolution des corps. Cependant, il semble qu’une certaine méfiance persiste face aux thèses évolutionnistes en tant qu’elles sont représentatives d’une tentation rationalisante omniprésente dans nos sociétés, tentation qui, selon Jean-Paul II, met la foi en danger (Jean-Paul II, 1998). Quoi qu’il en soit, sur cette question, les avis sont aussi nombreux que les différents courants du catholicisme allant des progressistes aux conservateurs, comme le très puissant groupe de l'Opus Dei. Un des actes catholiques anti-évolutionnistes les plus récents s’est produit en Italie en février 2004. La ministre italienne de l'enseignement et de la recherche, Letizia Moratti a proposé une loi visant à abolir l'enseignement de l’évolution dans l’enseignement secondaire. La communauté scientifique italienne s'est agitée et sous la pression d'une pétition, la proposition a été modifiée (Susanne, 2004). De plus, au début du mois de juillet 2005, un des plus influents cardinaux du Vatican proche de l’actuel pape Benoît XVI, Christoph Schönborn a nié, dans une tribune du New York Times, toute compatibilité entre l’évolution, en tant que processus étroitement lié au hasard, et la foi catholique (Schönborn, 2005). Il a souligné que la théorie de l’évolution n’est pas remise en question en tant que telle mais que l’Eglise Catholique défend la raison humaine en proclamant l’existence d’un "dessein" dans la nature.
I.2.1.2. L’islam
L'islam a été révélé à La Mecque au prophète Mohammad et il a été établi par écrit dans le texte sacré du Coran entre les années 612 et 632 après J-C. Ce texte est la traduction écrite du message donné par Dieu à Mohammad. Il est donc considéré comme la Parole de Dieu lui-même, ce qui le différencie des textes sacrés chrétiens. Ce fait est important car il rend l'interprétation des textes coraniques beaucoup moins « malléable ». C'est en partie pour cette raison que, même s'il existe différents courants religieux dans l'islam, aucun ne remet l'idée littérale d'un Dieu créateur en question. Il est essentiel de réaliser que l'islam est une « communauté-société », société et islam sont indissociables car pour le musulman vivre sa foi est un projet de vie qui ne peut se concevoir indépendamment de la société (Guide pratique, 2004). Il n'est donc pas étonnant que, dans les pays musulmans, le système d'éducation soit essentiellement basé sur l'étude du Coran et des traditions islamiques. Ce type d'éducation passe sous silence ou remet en questions les apports scientifiques qui rentrent en contradiction avec les écrits coraniques. Des études antérieures ont montré qu’une grande proportion de musulmans refuse l’évolution (Downie et Barron, 2000). En Turquie, une organisation appelée « the Science Research Foundation » a développé une série de conférences anti-évolutionnistes où les principaux locuteurs étaient des créationnistes américains (Sayin et Kence, 1999; Yahya, 1999 dans Downie et Barron, 2000). Les mouvements créationnistes turcs et américains sont effectivement très proches. Certains penseurs musulmans encouragent la recherche scientifique mais ne mentionnent pas l’évolution (Ali, 1997 dans Downie et Barron, 2000). Mais il faut souligner que les scientifiques qui défendent l’évolution subissent des intimidations et sont accusés d’athéisme, ce qui est considéré comme un choix philosophique honteux (Sayin et Kence, 1999). En fait, il n’existe pas d'autorité centralisatrice dans l'islam, il n'y a que des experts en sciences religieuses qui font autorité (ex.: Mufti, Ayatollah, ...) et cette absence d’autorité claire laisse la place à de nombreux penseurs musulmans qui affirment défendre la véritable pensée islamique. Les sites internet pullulent à ce sujet et les révélations tapageuses sur la théorie de l’évolution sont surprenantes. Harun Yahya, penseur musulman connu pour sa lutte contre les principes d’évolution et dont le travail est financé par « the Science Research Foundation », écrit (2003a): «(…) la théorie de l'évolution, qui soutient que la vie n'était pas créée, est une fourberie complètement contraire aux faits scientifiques. (…) les sciences modernes ont révélé, à travers certaines branches comme la paléontologie, la biochimie et l'anatomie, un fait explicite. Ce fait est que tous les êtres vivants sont la création de Dieu». Cet auteur et ce site en particulier nous a été conseillé par de jeunes étudiants bruxellois musulmans afin de nous permettre de «voir ce que pensent les musulmans de l’évolution» (étudiant en ingénieurerie industrielle, bac1, 19 ans). Ce type de manipulation par de prétendus savants de la pensée islamique est très courant.
I.2.2. Mécompréhensions
et mésinterprétations
Nous avons vu
précédemment qu’il semble très difficile de véritablement comprendre
l’évolution et ses concepts. Malgré les efforts déployés pour éclairer chacun
de ses points, les préjugés sur le darwinisme sont courants et manifestent
« le plus souvent, une cécité réelle par rapport au sens véritable du
discours de Darwin (...) et dans des circonstances plus circonscrites, une
volonté de mésinterprétation qui donne la mesure des enjeux liés à son
travestissement. » (Patrick Tort, 1999). Mais
qu’il s’agisse d’une mécompréhension ou d’une mésinterprétation, selon Patrick
Tort, jamais les erreurs liées à l’interprétation d’une théorie n’ont eu des
conséquences aussi graves que quand elles concernaient la théorie darwinienne
de l’évolution. Le darwinisme social est un courant qui est apparu à la fin de la deuxième moitié du 19ème
siècle, il applique les concepts darwiniens aux sociétés humaines. Les concepts
de « sélection naturelle » et de « survie du plus fort »
sont ainsi récupérés à des fins eugéniques et ne sont pas étrangers aux idées
nazies (Gould, 1997). Ce passage de l’histoire des sciences continue
aujourd’hui à être récupéré par certains anti-évolutionnistes pour entretenir
une peur des concepts d’évolution et maintenir la confusion entre théorie
scientifique et idéologie. Le passage qui suit est issu d’un texte intitulé
« Darwinisme et terrorisme » (Yahya, 2003b): «En vérité, si l'on
écarte le darwinisme, il ne reste plus aucune philosophie de
« conflit ». Les trois religions divines les plus répandues dans le
monde, l'islam, le christianisme, et le judaïsme, sont toutes opposées à la
violence. (…) Toutefois, la théorie de Darwin
perçoit la violence et le conflit comme des concepts naturels, justifiés et
adéquats, qui sont nécessaires à l'existence. Pour cette raison, si des
personnes recourent aux actes terroristes au nom des religions musulmane,
chrétienne ou juive, vous pouvez être certains que ces personnes ne sont pas
vraiment des musulmans, des chrétiens ou des juifs. Ce sont de véritables
socio-darwinistes». De même, l’affaire Lyssenko (1937-1963) est un épisode de l’histoire des sciences qui montre les
dangers de mêler des idées politiques aux questions biologiques. Staline et
Lyssenko supprimèrent l’enseignement de la théorie de l’évolution darwinienne
et des théories de l’hérédité car elles étaient considérées comme
« bourgeoises » et au service de la pensée capitaliste. Cet événement
a eu des conséquences catastrophiques sur l’avancée des connaissances biologiques
soviétiques. (Kotek et Kotek,
1986). Aujourd’hui encore, c’est l’enseignement qui est pris pour cible par les
fondamentalistes créationnistes (Etats-Unis, Italie, Serbie, Pays-Bas)
(Susanne, 2004) et les enseignants manifestent un stress important (Griffith et
Brem, 2004) voir de la peur (Moore, 2000) lorsqu’il s’agit d’enseigner cette
matière.
II. Objectifs du travail
L’objectif principal de ce travail est d’évaluer l’opinion des étudiants
bruxellois vis-à-vis des concepts d’évolution. A partir de cette évaluation, il
est possible de définir trois questions essentielles auxquelles ce travail de
recherche va tenter d’apporter une réponse. Premièrement, existe-t-il une
influence de l’appartenance religieuse individuelle sur les opinions
revendiquées? Si tel est le cas, comment s’exprime cette influence et sur quels
points de la théorie de l’évolution se manifeste-t-elle? Deuxièmement,
existe-t-il une influence de l’enseignement suivi par un individu sur les
opinions qu’il développe vis-à-vis des concepts d’évolution? Qu’en est-il du
degré d’instruction (niveau d’enseignement, année d’études) mais également
de l’orientation choisie? Troisièmement, existe-t-il une influence du niveau
d’études atteint par le père et la mère des étudiants sur leurs opinions vis-à-vis
des concepts d’évolution?
A partir de ces trois questions centrales, nous examinons l’impact de
ces influences éventuelles sur:
- la compréhension de la théorie néodarwinienne de l’évolution,
- l’acceptation du concept d’évolution en tant que tel. D’une part en ce
qui concerne l’évolution des animaux et d’autre part, en ce qui concerne
l’évolution de l’homme,
- la perception et l’acceptation de la théorie (néo)darwinienne de
l’évolution.
III. Matériel et Méthode
Afin d’évaluer l’opinion des étudiants bruxellois sur les concepts
d’évolution, nous avons procédé à une enquête par questionnaire dans
l’enseignement secondaire, supérieur non-universitaire et universitaire. Il s’agit d’une enquête transversale,
c’est-à-dire que chaque individu interrogé n’a répondu qu’une seule fois au
questionnaire. Cette gradation dans le niveau d’enseignement nous permet de
déterminer l’influence éventuelle de l’enseignement sur les opinions ciblées.
De plus, le questionnaire permet de déterminer la confession religieuse et le
niveau d’étude des parents des répondants. Nous pouvons ainsi évaluer
l’influence de ces paramètres sur les réponses apportées au questionnaire.
III.1. L’échantillonnage
Nous avons choisi les enseignements et les établissements, au sein
desquels nous avons interrogé les étudiants, de façon aléatoire dans des
catégories d’échantillonnage préalablement définies. Ces catégories sont
définies par: le niveau d’enseignement (secondaire, supérieur non-universitaire et
universitaire), les années d’études (5ème et 6ème année
secondaire, respectivement avant-dernière et dernière année des études
secondaires; 1ère année d’études supérieures et dernières années
d’études supérieures) et l’orientation d’enseignement (orientations scientifiques,
littéraires et biologiques).
Après avoir précisé les catégories d’échantillonnage, nous avons donc
procédé à l’échantillonnage lui-même, c’est-à-dire au sondage des étudiants
ciblés. Il s’est déroulé dans une période allant du mois de février 2005 au
mois de mai 2005 après un échantillonnage préliminaire au cours du mois de
décembre 2004. Les étudiants sont majoritairement interrogés dans le cadre de
leur cours. A l’université, pour une partie des étudiants des orientations
scientifique et biologique, l’échantillonnage s’est déroulé par e-mail. Le
questionnaire est envoyé avec les instructions dans les boîtes e-mail et le
questionnaire complété est renvoyé par la même voie. Ainsi, nous avons
interrogé 1163 étudiants de l’enseignement bruxellois d’une moyenne d’âge de
19,31 ans. Le tableau 1 précise le nombre d’étudiants interrogés pour chaque
catégorie d’enseignement.
|
Enseignement |
Orientation
|
Année |
N |
% |
|
|
Secondaire1 |
O. littéraire
|
5ème |
97 |
19,4% |
|
N=499
|
|
6ème |
101 |
20,2% |
|
|
|
O. scientifique
|
5ème |
155 |
31,1% |
|
|
|
|
6ème |
146 |
29,3% |
100% |
|
E. sup. non-universitaire |
O. littéraire |
1ère |
70 |
25,0% |
|
|
N=280 |
|
>1ère |
56 |
20,0% |
|
|
|
O. scientifique |
1ère |
84 |
30,0% |
|
|
|
|
>1ère |
70 |
25,0% |
100% |
|
E. universitaire |
O. littéraire |
1ère |
76 |
19,8% |
|
|
N=384 |
|
>1ère |
66 |
17,2% |
|
|
|
O. scientifique |
1ère |
66 |
17,2% |
|
|
|
|
>1ère |
77 |
20,0% |
|
|
|
O. biologie |
1ère |
58 |
15,1% |
|
|
|
|
>1ère |
41 |
10,7% |
100% |
1 L’enseignement
secondaire en Belgique est composé de différents réseaux d’enseignement. Nous
avons échantillonné dans les trois réseaux publics, réseau de la Communauté française, réseau officiel
subventionné, tous les deux non-confessionnels, et le réseau libre subventionné
revendiquant une confession religieuse, catholique ou israélite. De plus, nous
avons aussi échantillonné dans les
établissements jugés à éducation prioritaire (c’est-à-dire à "discrimination
positive"), statut défini par le niveau socio-économique moyen des élèves
de l’établissement.
Tableau 1. Pourcentages des étudiants interrogés en fonction des différentes
catégories d’échantillonnage. N=nombre d’étudiants interrogés par catégorie.
Table 1. Percentages of respondent students in each sample
characterized by the educational level, the science, literary or biological
education and the class level. N= number of respondent in each sample.
Ainsi, dans l’ensemble des étudiants interrogés (N=1163), 42,9% d’entre eux suivent l’enseignement secondaire, 24,1% sont étudiants dans le supérieur non-universitaire et 33% sont étudiants à l’université. De plus, les étudiants interrogés sont en grande partie laïques (39%), suivis d’une grande proportion de catholiques (26,1%) et de musulmans (19%). Les individus restant sont de confessions juive (7,4%), protestante (3,3%), orthodoxe (1,9%) ou bouddhiste (1,9%).
Cet échantillonnage s’est réalisé au moyen d’un questionnaire qui
cherche d’une part à évaluer la compréhension que les étudiants ont des
concepts d’évolution
et d’autre part, à évaluer leurs opinions vis-à-vis de ces concepts et de la
théorie de l’évolution qui les coordonne. Il est composé de 21 questions à choix
multiples et d’une page permettant de récolter des informations générales sur
l’étudiant. Le temps de réponse au questionnaire est relativement court et dure
à peu près 20 minutes. La rédaction de ce questionnaire a principalement été
inspirée par les travaux de Anderson et al. (2002) et de Blackwell et al. (2003). Les 21
questions du questionnaire appartiennent à trois parties distinctes car elles
tentent de répondre à des questions différentes. La première partie (Q01 à Q07) a pour objectif d’évaluer la compréhension des étudiants au sujet des concepts d’évolution. Les concepts abordés
dans cette partie sont, dans l’ensemble, ceux de la théorie de la sélection
naturelle, à savoir: l’hérédité des caractères (Q01), la dynamique des
populations en rapport avec certaines contraintes de l’environnement (Q02 et
Q03), la lutte pour l’existence (Q04) et les concepts d’adaptation, de
reproduction différentielle et de variation interindividuelle (Q05, Q06 et
Q07). La seconde partie inclut les questions 08 à
13. Elle cherche à déterminer l’acceptation des
étudiants vis-à-vis de l’évolution et surtout si
les étudiants font une différence entre l’évolution des animaux et l’évolution
de l’homme. Cette question de l’origine de l’homme et de sa filiation avec les
grands singes actuels est un des thèmes évolutionnistes qui pose le plus de
problèmes aux religions (Blackwell et al., 2003).
Précisons que dans notre questionnaire, le terme « évolution »
traduit les processus macro-évolutifs. Plus précisément, les deux premières
questions (Q08 et Q09) concernent l’origine et l’évolution des
animaux. Les autres questions interrogent l’origine de l’homme (Q10), son
animalité éventuelle (Q11), la filiation avec les grands singes (Q12) et le
concept d’âme (Q13). La dernière partie comporte
les questions 14 à 21 et évalue l’opinion et la disposition des étudiants au sujet de la théorie de
l’évolution elle-même. La
première question (Q14) tente de déterminer l’opinion individuelle sur l’objet
de la sélection naturelle (corps et/ou âme) puis les questions suivantes
concernent l’acceptation de la théorie de l’évolution en tant qu’explication du
développement de la vie sur terre (Q15) et sa scientificité (Q16 et Q17).
Enfin, nous tentons de déterminer les dispositions individuelles vis-à-vis des
théories darwinienne et néodarwinienne de l’évolution (Q20 et Q21). Deux
questions (Q18 et Q19) interrogent également l’existence et le désir d’un débat
en cours.
III.2. Traitements statistiques
La méthode d’analyse statistique employée dans cette étude est comparative: les résultats moyens obtenus pour différents groupes spécifiques (confession, enseignement,...) composant l’échantillon sont confrontés les uns aux autres, de façon à dégager les caractéristiques spécifiques de ces parcelles d’échantillon. Le traitement des résultats de l’enquête à permis trois niveaux d’analyses successives. L’analyse fréquentielle permettant la description de notre échantillon en fonction des différentes variables. L’analyse Chi-carré qui soumet les données à des tests d’homogénéité Chi-carré. L’hypothèse nulle étant que toutes les catégories d’individus présentent des distributions homogènes de réponses pour une question donnée. Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences), version 5.0.2 sur PC. Finalement, l’analyse factorielle des correspondances multiples permet d’avoir un résumé descriptif sous forme graphique de l’ensemble de nos observations. En effet, dans notre étude, l’essentiel des résultats est rassemblé sur un graphique représentant les nuages points-variables dans le plan de projections formé par les deux premiers axes factoriels. Du point de vue de l’interprétation graphique, la proximité ou l’éloignement entre points exprime la corrélation ou l’opposition entre les différentes variables étudiées (les réponses aux questions et les caractéristiques générales individuelles) (Lebart et al. 1982 et Vercauteren M. et Slachmuylder J-L, 1993). Ces analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel Homals/SPSS version 10 sur PC.
|
Concepts |
Conceptions évolutionnistes
néodarwiniennes |
Conceptions alternatives |
Compréhension
|
|
|
|
Hérédité des caractères
innés |
Hérédité des caractères
déterminés génétiquement (Q012). |
-Finalisme de l’hérédité:
les caractères apportant un avantage adaptatif sont transmis à la descendance
(Q011). -Hérédité
lamarckienne des caractères acquis (Q013). |
|
Dynamique des populations |
La taille d’une population
est contrôlée par les compétitions intraspécifiques (lutte pour l’existence
car ressources naturelles limitées) et par les relations interspécifiques
(ex:prédation) (Q021, Q032). |
La taille des populations est principalement
contrôlée par les relations interspécifiques. Les relations intraspécifiques ne sont pas
déterminantes (Q022, Q023, Q031, Q033). |
|
Lutte pour l’existence |
La production d’un nombre
d’individus trop élevé pour les ressources du milieu entraîne une lutte pour
l’existence entre les membres d’une population. (Q042). |
-Coopération
interindividuelle et pas de lutte pour l’existence (Q041). -Modification radicale du
régime alimentaire (Q043). |
|
Adaptation |
Les caractéristiques
adaptatives aux contraintes de l’environnement préexistent à ces contraintes
(Q051). |
-Finalisme lamarckien: les
caractéristiques adaptatives apparaissent en réponse aux contraintes de
l’environnement (Q052). -Pas d’adaptation (Q053). |
|
Reproduction différentielle |
Les individus qui sont les
plus aptes à affronter leur milieu produisent vraisemblablement plus de
descendants que les individus moins aptes. (Q061) |
-Altruisme des individus les
plus aptes (Q063). -Pas de reproduction
différentielle (Q062). |
|
Variations |
Les caractéristiques des
individus d’une population varient énormément. Cette variation est du à
l’apparition aléatoire de mutations (Q071). |
- Tous les individus d’une
population sont identiques (Q072). - Finalisme: il existe une
variation due à l’apparition de mutations en réponse aux contraintes de
l’environnement (Q073). |
Evolution des animaux
|
|
|
|
Origine des animaux |
Apparition des animaux
terrestres (~450.106a.) plusieurs milliards d’années après la
formation des la terre (~4,6.109a.) (Q081). |
-Créationnisme: création des
animaux par Dieu peu après la formation de la terre (Q082). -
« agnosticisme »: on ne sait pas (Q083). |
|
Evolution des animaux |
Les animaux sont le résultat
d’une longue évolution des êtres vivants (Q092). |
- Fixisme des espèces
animales (Q091). -
« agnosticisme »: on ne sait pas (Q093). |
Evolution de l’homme
|
|
|
Origine et évolution de l’homme
|
L’homme est apparu à la
suite d’une longue évolution des êtres vivants (Q102). |
-Créationnisme: création de
l’homme par Dieu(Q101) -
« agnosticisme »: on ne sait pas (Q103). |
Animalité de l’homme
|
L’homme est une espèce
animale (Q111). |
- Non, l’homme n’a rien
commun avec les animaux (Q112). - Non, l’homme n’est pas un animal
même s’il descend des animaux (Q113). |
Filiation avec les chimpanzés
|
Ancêtre commun entre les
chimpanzés et l’homme (Q122 et Q123). |
- Créationnisme: pas
d’ancêtre commun (Q121). |
Principe insaisissable: Ame, esprit/conscience
|
- L’homme n’est pas habité par un principe insaisissable (13.2)®(Q133). - Je ne sais pas (13.3)®(Q134). |
- L’homme est habité par un pcp
insaisissable (13.1): l’âme (13’.1)®(Q131). - L’homme est habité par un pcp
insaisissable (13.1): l’esprit(13’.2)/la conscience(13’.3)®(Q132). |
Tableau 2. Conceptions
évolutionnistes néodarwiniennes et conceptions alternatives développées dans le
questionnaire. ex.: Q012=question 01, item 2.
Table 2. Neodarwinian
evolutive conceptions and alternative conceptions as presented in the
questionnaire. ex.: Q012=question 01, item 2.
|
Concepts |
Conceptions évolutionnistes
néodarwiniennes |
Conceptions alternatives |
La théorie de l’évolution
|
|
|
|
L’homme |
La th. de l’évolution
s’applique à l’ensemble des caractéristiques de l’homme (Q143). |
-Rejet de la
th. appliquée à l’homme (Q142). -Application au physique de
l’homme, pas à son âme/esprit/conscience (Q141). - Indécision (Q144). |
|
Puissance explicative |
La théorie de l’évolution de
C.Darwin est la meilleure explication (actuelle) du développement de la vie
sur Terre (Q151). |
- Rejet de la
th. appliquée à l’homme (Q152). - Rejet de la th. car
non convaincante (Q153). |
|
Est-ce une théorie
scientifique ? |
Oui (Q161). |
-Non (Q162). -Indécision (Q163). |
|
Nature d’une théorie
scientifique ? |
Résiste aux observations
et aux expériences (Q171). |
-Acceptée par la communauté scientifique
(Q172). - Elle est vraie (Q173). |
|
Compatibilité avec croyances |
Compatibilité (Q201). |
- Conflit total (Q202). - Conflit partiel (Q203). |
|
Néodarwinisme |
Apporte encore de meilleures
explications et de nouvelles preuves de l’évolution (Q211). |
- Rejet de la
th. appliquée à l’homme (Q212). - Rejet de la th. car
non convaincante (Q213). - Je ne connais pas (Q214). |
Débats en classe
|
Il y a-t-il eu
débat ?
|
Souhaitez-vous ces
débats ?
|
|
|
- Oui (Q181). - Non (Q182). - Je ne sais pas (Q183). |
- Oui (Q191). - Non (Q192). - Je ne sais pas (Q193). |
Tableau 2. Cont.
Table 2. Cont.
IV. Résultats
IV.1.
Résultats généraux
Le tableau 2
décrit les conceptions évolutionnistes néodarwiniennes et les conceptions
alternatives correspondant à chacune des réponses aux questions posées.
Le tableau 3 décrit quant à lui le
pourcentage de réponses données pour chacune de ces questions par l’ensemble
des étudiants interrogés.
|
Question |
1 (%) |
2 (%) |
3 (%) |
4 (%) |
nr (%) |
|
Q01 |
9,00 |
84,20 |
5,80 |
- |
1,00 |
|
Q02 |
78,20 |
13,20 |
7,80 |
- |
0,80 |
|
Q03 |
9,20 |
78,50 |
11,78 |
- |
0,50 |
|
Q04 |
5,00 |
88,50 |
6,30 |
- |
0,20 |
|
Q05 |
50,00 |
45,00 |
4,30 |
- |
0,70 |
|
Q06 |
82,60 |
14,30 |
2,20 |
- |
0,90 |
|
Q07 |
40,10 |
8,90 |
49,60 |
- |
1,40 |
|
Q081 |
67,20 |
16,90 |
15,10 |
- |
0,50 |
|
Q09 |
2,40 |
92,30 |
4,70 |
- |
0,60 |
|
Q101 |
23,50 |
69,70 |
5,40 |
- |
0,40 |
|
Q11 |
62,40 |
12,30 |
24,30 |
- |
1,00 |
|
Q12 |
18,10 |
55,70 |
24,80 |
- |
1,40 |
|
Q131 |
20,60 |
48,50 |
7,50 |
11,60 |
8,40 |
|
Q14 |
42,40 |
4,70 |
25,60 |
25,60 |
1,70 |
|
Q15 |
55,80 |
11,90 |
20,50 |
- |
11,80 |
|
Q16 |
73,50 |
12,60 |
12,60 |
- |
1,30 |
|
Q171 |
84,40 |
7,10 |
6,50 |
- |
1,60 |
|
Q18 |
21,80 |
71,00 |
6,30 |
0,90 |
|
|
Q19 |
28,90 |
55,70 |
14,10 |
- |
1,30 |
|
Q20 |
54,10 |
13,70 |
23,20 |
- |
9,00 |
|
Q21 |
39,20 |
5,90 |
8,90 |
41,90 |
4,10 |
1 La somme des pourcentages est parfois inférieure à 100% car certaines réponses étaient
multiples (<1%). Elles n’ont pas compté dans l’analyse.
Tableau 3. Résultats du
questionnaire. Pourcentages de réponses données par l’ensemble des individus
(N=1163) aux questions Q1 à Q21.
nr = non-réponse. En rouge, le pourcentage maximal pour chaque question.
En italique, les réponses néodarwiniennes.
Table 3. Results of the
questionnaire. Percentages of responses given by all the respondent students
(N=1163) to the questions Q01 to Q21. nr=no response. In red, maximal
percentage of each question. In italic, neodarwinian reponses.
A partir de ce tableau de résultats et de cette grille de lecture (tab. 3 et tab. 2), nous pouvons déterminer globalement la compréhension et l’opinion que les étudiants bruxellois interrogés ont de l’évolution. Il est important de souligner que le questionnaire ne propose que trois à quatre choix de réponse par question. Il est donc évident que les étudiants interrogés sont, pour la plupart, confrontés à des réponses qui ne traduisent pas précisément leurs opinions. De plus, les réponses proposées présentent des opinions très contrastées (ex.: créationnistes et évolutionnistes). Ainsi, l’intérêt de cette étude réside principalement dans l’observation des choix faits par les étudiants lorsqu’ils sont confrontés à cette structuration contrastée de réponses.
En ce qui concerne la compréhension que les étudiants ont de l’évolution
(Q01 à Q07), nous constatons que la majorité des étudiants interrogés semble
comprendre l’évolution selon les préceptes néodarwiniens, ils choisissent en
majorité la réponse traduisant cette conception (pourcentages en italique et en
rouge) pour toutes les questions excepté pour la question concernant le
processus d’apparition des variations génétiques (Q07) (tab. 3). En effet, nous
constatons que le pourcentage maximal de réponses données (p.m.r.) à cette
question semble traduire une compréhension finaliste de ce processus (Q073:
49,6%): les
mutations responsables de la variation interindividuelle « apparaissent en
réponse aux contraintes de l’environnement permettant aux individus mutés
d’être mieux adaptés». Dans le même esprit, il est intéressant de noter
que si la majorité des autres questions ont un p.m.r. dépassant les 75%, la question concernant le
processus d’adaptation (Q05, tab. 3) a un p.m.r. égal à 50% (Q051). Ainsi, bien que ce soit la
réponse en accord avec l’évolutionnisme néodarwinien qui soit majoritairement
choisie, un grand nombre d’étudiants semble développer une conception finaliste
et lamarckienne des processus d’adaptation (Q052: 45%): dans un nouvel environnement, les
lapins développent des caractéristiques leur permettant de s’y adapter.
Ensuite, les réponses apportées par les étudiants aux questions concernant l’acceptation de l’évolution (Q08 à Q13) nous fournissent plusieurs informations intéressantes. Premièrement, en ce qui concerne l’évolution des animaux (tab. 3), nous constatons qu’une majorité des individus interrogés semble considérer que ces derniers sont le résultat d’une longue évolution (tab. 3: Q081 et Q092). Notons que si près de 17% des répondants choisissent la réponse créationniste quant à l’origine des animaux (Q082:16,9%), la majorité d’entre eux ne semble pas fixiste (tab. 3, Q091: 2,4%): en effet, 75% des étudiants choisissant la réponse créationniste pour les animaux paraît quand même accepter qu’ils soient issus de processus évolutifs. Deuxièmement, pour ce qui est de l’origine de l’homme, près d’un cinquième de notre échantillon total choisit la réponse créationniste (Q101: 23,5% et Q121: 18,1%). Notons que 30% des étudiants choisissant de répondre que Dieu à créé l’homme (Q101), choisissent également les réponses considérant que l’homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun (Q122 et Q123). Enfin, une majorité de répondants paraît considérer que l’homme est un animal (Q111: 62.4%) et qu’il est habité par un principe insaisissable (âme: 20,6% et conscience/esprit: 48,5%, tab. 3).
Finalement, l’évaluation de l’opinion des étudiants bruxellois vis-à-vis de la théorie de l’évolution nous indique qu’une grande partie des individus interrogés semble considérer que la théorie darwinienne de l’évolution ne concerne que l’aspect physique de l’homme et pas son âme ou sa conscience (tab. 3: Q141: 42,4%). Ils ont majoritairement choisi de la reconnaître comme la meilleure explication actuelle du développement de la vie (Q151: 55,8%) et comme une théorie scientifique (Q161: 73,5%). Mais, ils sont quand même près de 37% à choisir les réponses exprimant l’existence d’un conflit entre leurs croyances et la théorie de l’évolution que ce conflit soit total ou partiel (Q202: 13,7% et Q203: 23,2%). Pourtant, la majorité des étudiants interrogés n’ont pas connu de débats en classe au sujet des rapports entre religions et évolution (Q182: 71%) bien qu’ils en souhaitent (Q192: 55,7%). Pour finir, notons qu’une grande partie des étudiants déclare n’avoir jamais entendu parler de la théorie néodarwinienne de l’évolution (Q214: 41,9%) bien qu’elle soit au programme du cours de biologie de la dernière année des études secondaires (6ème année).
IV.2.
Résultats comparatifs
L’analyse factorielle des correspondances multiples a été réalisée sur
968 individus (après élimination d’individus s’étant abstenus de répondre à
certaines questions). Les figures 1, 2 et 3 présentent le plan des deux premiers
axes factoriels obtenus par cette analyse. Plus précisément, la figure 1
représente un résumé schématique des groupes de variables identifiés dans le
plan de deux premiers axes. Ce schéma
permet une lecture immédiate des résultats importants. Pour une
observation du positionnement relatif précis des modalités, nous renvoyons aux
figures 2 et 3. Le tableau 4 précise la signification des modalités utilisées
dans l’analyse factorielle des correspondances multiples des figures 2 et 3.
Nous travaillons avec deux types de variables: les variables actives
correspondant aux réponses apportées par chaque étudiant aux 21 questions du
questionnaire et les variables illustratives correspondant aux informations
générales recueillies sur chaque étudiant (âge, sexe, enseignement, confession
religieuse, …).
|
1. Variables illustratives |
|
|
|
1/ Niveau d’enseignement: ENSE (E. secondaire); ENSN (E. supérieur
non-universitaire); ENUN (E. universitaire). |
|
2/ Année d’études: AE5S (5ème secondaire); AE6S (6ème
secondaire); AES1 (1ère études sup.); AESS (dernières années
études sup.). |
|
3/ Orientation: ORL (littéraire); ORS (scientifique); ORB
(biologique). |
|
4/ Confession:
COFL (laïque); COFC (catholique); COFM (musulmane); COFJ (juive); COFP
(protestante); COFO (orthodoxe); COFB (bouddhiste). |
|
5/ Etudes du père:
EPSI (au plus, secondaire inférieur); EPSS (au plus, secondaire
supérieur); EPSU (études supérieures). |
|
6/Etudes de la mère:
EMSI (au plus, secondaire inférieur); EMSS (au plus, secondaire
supérieur); EMSU (études sup.). |
|
7/ Pratique de la religion: POUI (pratiquant); PNON (non pratiquant). |
|
8/ Place de la religion dans
la vie: PRI (importante); PRM (moyenne); PRN (nulle). |
|
9/ Entendu parler de la th. de l’évolution: EOUI (oui); ENON (non). |
|
|
|
2. Variables actives |
|
|
|
2.1. Compréhension (tab.2): ex.: Q012=question 01, item 2. |
|
10/ Question 01, Hérédité des caractères: Q012 (réponse
néodarwinienne); Q011 et Q013 (autres réponses). |
|
11/ et 12/ Question 02 et 03, Dynamique des populations: Q021 et Q032
(réponse néodarwinienne); Q022, Q023, Q031 et Q033 (autres réponses). |
|
13/ Question 04, Lutte pour
l’existence: Q042 (réponse néodarwinienne); Q041 et Q043 (autres réponses). |
|
14/ Question 05, Adaptation: Q051 (réponse néodarwinienne); Q052
(réponse finaliste); Q053 (autre réponse). |
|
15/ Question 06, Reproduction différentielle: Q061 (réponse
néodarwinienne); Q062 et Q063 (autres réponses). |
|
16/ Question 07, Variation: Q071 (réponse néodarwinienne); Q072 (autre
réponse); Q073 (réponse finaliste). |
|
|
|
2.2. Acceptation du
concept d’évolution (tab.2) |
|
17/ Question 08, Origine des animaux: Q081 (évolutionnisme); Q082
(créationnisme); Q083 (« agnosticisme »). |
|
18/ Question 09, Evolution des animaux: Q092 (évolutionnisme); Q091
(fixisme); Q093 (« agnosticisme »). |
|
19/ Question 10, Origine
et évolution de l’homme: Q102 (évolutionnisme); Q101 (créationnisme); Q103
(«agnosticisme »). |
|
20/ Question 11,
Animalité de l’homme: Q111 (l’homme est un animal); Q112 (l’homme n’a rien
commun avec les animaux); Q113 (l’homme n’est pas un animal même s’il descend
des animaux). |
|
21/ Question 12, Filiation
avec les chimpanzés: Q122 et Q123
(existence d’un ancêtre commun); Q121 (créationnisme) |
|
22/ Question 13, Principe insaisissable (âme, esprit, conscience):
Q131 (âme); Q132 (esprit ou conscience); Q133 (aucun pcp insaisissable); Q134
(je ne sais pas). |
|
(Nous avons présenté
précédemment le résultat global de la question 14 mais nous ne parlerons plus
de cette question dans la suite car elle a été sujette à une
mésinterpétation.) |
|
|
|
2.3. Opinions et
acceptation de la théorie de l’évolution (tab.2) |
|
23/ Question 15, Puissance explicative: Q151 (la théorie de
l’évolution est la meilleure explication actuelle du dvpt de la vie, y
compris l’homme); Q152 (meilleure explication non compris l’homme); Q153 (pas
du tout convaincante); Q159 (je ne sais pas). |
|
24/ Question 16, Est-ce une th. scientifique ?: Q161 (Oui); Q162
(Non); Q163 (je ne sais pas). |
|
25/ Question 17, Nature d’une th. scientifique ?: Q171 (résiste
aux observations et aux
expériences ); Q172 (acceptée
par la communauté scientifique); Q173 (elle est vraie). |
|
26/ Question 20, Compatibilité avec croyances: Q201 (compatibilité);
Q202 (incompatibilité totale);
Q203 (incompatibilité partielle); Q209 (je ne sais pas). |
|
27/ Question 21, Néodarwinisme:
Q211 (apporte encore de meilleures explications et preuves de l’évolution);
Q212 (ne concerne pas l’homme); Q213 (non convaincante); Q219 (je ne sais
pas). |
Tableau 4. Dictionnaire des
questions et des modalités de réponses utilisées dans l’analyse factorielle des
correspondances.
Table 4. Dictionary of
questions and response modalities used in the multiple correspondence analysis.
Figure 1. Analyse
factorielle des correspondances multiples; représentation schématique.
Figure 1. Multiple
correspondence analysis; schematic
figure.
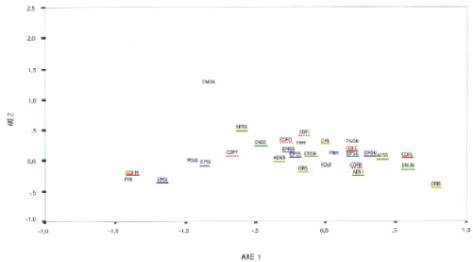
Figure 2.
Analyse factorielle des correspondances multiples; Axes 1 et 2:
Variables illustratives
Figure 2.
Multiple correspondence analysis; Axis 1 and 2: Additional variables.
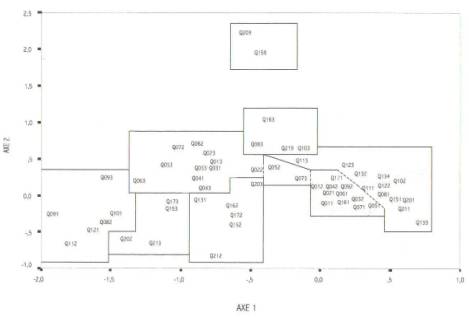
Figure 3. Analyse factorielle des
correspondances multiples; Axes 1 et 2: Variables actives
Figure 3. Multiple correspondence
analysis; Axis 1 and 2: Categorical variables. ex.: Q012=question 01, item 2.
Les modalités correspondant aux individus de confessions musulmane, catholique et laïque (figure 1: en rouge), fort éloignées les unes des autres, présentent donc des profils de réponses aux variables actives différents. Cette différence est hautement significative pour 20 questions sur 21 (Chi-carré: tab.5). Cependant, si les musulmans interrogés sont véritablement isolés, les étudiants laïques et catholiques présentent des profils plus similaires. En effet, la figure 1 nous montre que les étudiants de confession musulmane se situent d’une part, à proximité des réponses traduisant une mécompréhension de la théorie de la sélection naturelle (Q013: 11%, Q022: 17,6%, Q023: 13,9%, Q031: 17,4%, Q033: 21,9%, Q041: 11%, Q043: 9,1%, Q052: 63%, Q053: 9,7%, Q062: 22,7%, Q063: 6,4%, Q072: 14,8%, Q073: 59,3% et fig.3) d’autre part, près des réponses créationnistes pour les animaux et l’homme (Q082: 54,3%, Q091: 7,4%, Q101: 82,8%, Q112: 50%, Q121: 65,7% et fig. 3) et finalement, à proximité des réponses traduisant des opinions anti-darwiniennes (Q153: 51,6%, Q213: 21,9%, Q202: 48,7% et fig. 3).
Dans le cadre de cette étude, sont considérés comme laïques les
étudiants se définissant comme n’étant d’aucune confession religieuse. Ainsi,
la figure 1 montre que les étudiants laïques et catholiques, que nous avons
interrogés, sont quant à eux très proches des réponses conformes à l’évolutionnisme
néodarwinien que ce soit au niveau de la compréhension (respectivement: Q012:
86,4% et 88%, Q021: 84,8% et 78%, Q032: 90,3% et 80,1%, Q042: 91,9% et 93,1%, Q051: 63,8% et 52,7%, Q061: 89,7% et 87,1%, Q071: 50,4% et 38,6% et fig.3 ) ou des opinions
(Q081: 83,9% et
75,3%, Q092: 98% et 96,7%, Q102: 94% et 82%, Q111: 82,2% et 64,8%, Q122/Q123: 98% et 91,7%, Q151: 82,3% et 67,9%, Q161: 77,9% et 75,1%, Q201: 84,2% et 65,7%, Q211: 57,1% et 42,2% et fig.3) traduisant une forte
corrélation positive entre ces profils. Les étudiants laïques et catholiques
interrogés présentent donc des profils de réponses faiblement différenciés
(fig. 1 et fig. 2). Ces derniers sont notamment plus nombreux à choisir les
réponses n’affirmant pas l’animalité de l’homme (Q112/Q113) et à ressentir
leurs croyances en conflit avec la théorie darwinienne de l’évolution
(Q202/Q203). Mais comme pour les étudiants laïques interrogés, ils sont une
majorité à choisir de répondre que l’homme est habité par un principe
insaisissable appelé «esprit ou conscience» (respectivement, Q132: 56,8% et 64%) à l’inverse des étudiants de
confession musulmane qui choisissent majoritairement "l’âme" (Q131:
61,3%).
|
|
Laïques/Catholiques/Musulmans |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
970 |
18,99 |
4 |
0,001 |
** |
|
Q02 |
973 |
28,09 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q03 |
973 |
81,95 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q04 |
977 |
29,85 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q05 |
971 |
86,36 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q06 |
970 |
48,85 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q07 |
964 |
44,37 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q08 |
974 |
348,07 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q09 |
974 |
99,11 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q10 |
968 |
596,03 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q11 |
971 |
411,93 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q12 |
964 |
435,23 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q13 |
975 |
69,06 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q13' |
638 |
139,58 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q14 |
964 |
71,28 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q15 |
876 |
239,29 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q16 |
967 |
19,87 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q17 |
961 |
58,89 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q18 |
932 |
7,91 |
4 |
0,095 |
NS |
|
Q19 |
929 |
25,95 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q20 |
895 |
343,28 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q21 |
942 |
133,01 |
6 |
0,000 |
*** |
Tableau 5. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,
p>0,05; *=significatif, p<0,05; **=significatif, p<0,01;
***=significatif, p<0,001.
Table 5. Results of Chi square tests, NS=unsignificant, p>0.05;
*=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,
p<0.001.
Il est important de souligner que les étudiants laïques, catholiques et musulmans interrogés sont répartis de façon significativement hétérogène dans les différents enseignements sondés, (tab. 6: Chi-carré: p<0,001). L’analyse factorielle des correspondances multiples nous montre d’ailleurs cette hétérogénéité de distribution dont il faut absolument tenir compte dans l’interprétation des résultats. En effet, les résultats des tests Chi-carré obtenus, notamment en ce qui concerne la compréhension de l’évolution (Q01 à Q07), peuvent être le reflet de ces différences de niveau d’enseignement et donc de degré d’instruction.
|
|
Laïques/Catholiques/Musulmans |
||||
|
Variables illustratives |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Niveau d’enseignement |
979 |
187,69 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Orientation |
979 |
97,03 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Année d’études |
978 |
124,07 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Étude père |
862 |
110,01 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Étude mère |
872 |
222,07 |
4 |
0,000 |
*** |
Tableau 6. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,
*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,
p<0,001.
Table 6. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,
p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,
p<0.001.
En observant les modalités représentant les degrés d’instruction (niveau
d’enseignement, figure 1: vert pomme et année d’études, figure 1: vert clair),
nous pouvons considérer qu’il y a une "progression" des profils de
réponses, que ce soit le niveau d’enseignement ou les années d’études. En
effet, lorsque le degré d’instruction diminue, la distance entre les modalités
de l’enseignement et les réponses de l’évolutionnisme néodarwinien
(compréhension et opinions) tend à augmenter. Cette distance progressive
traduit le fait que les patterns de réponses données par les étudiants des
trois niveaux d’enseignement ou des quatre années d’études sont hétérogènes de
façon très significative pour 20 questions sur 21 (Chi-carré: tab. 7a et tab.
8) et que les pourcentages de réponses néodarwiniennes tendent à augmenter
quand le degré d’instruction augmente. Notons que l’écart de profil est le plus
important entre les modalités de la 6ème année secondaire et de la 1ère année d’études
supérieures (AE6S et AES1, fig. 2). Il est important de souligner que les étudiants de
confession musulmane interrogés font exception. En effet, leurs patterns de
réponses sont statistiquement homogènes quel que soit le degré d’instruction
(17 questions sur 17, tab. 7b). En ce qui concerne les orientations
(figure 1: en orange), les étudiants d’orientation biologique que nous avons
interrogés (ORB, fig. 2) sont logiquement très performants en ce qui concerne
la compréhension théorique des concepts de la sélection naturelle (Q012: 90,9%,
Q021: 97%, Q032: 97%, Q042: 98%, Q051: 89,8%, Q061: 97%, Q071: 92,8%). Quant
aux orientations littéraires et scientifiques (ORL et ORS, fig. 2), elles
présentent des profils relativement similaires (12 questions sur 21 présentent
des patterns statistiquement homogènes, Chi-carré: tab. 9 et fig. 1).
|
|
E. secondaire/E. sup. non-universitaire/E.
universitaire |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
1152 |
22,1 |
4 |
0,000 |
** |
|
Q02 |
1154 |
33,29 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q03 |
1157 |
96,12 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q04 |
1161 |
36,23 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q05 |
1154 |
149,25 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q06 |
1153 |
32,2 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q07 |
1146 |
134,37 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q08 |
1154 |
151,25 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q09 |
1156 |
21,27 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q10 |
1147 |
160,3 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q11 |
1152 |
75,26 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q12 |
1146 |
84,68 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q13 |
1156 |
55,57 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q13' |
782 |
32,12 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q14 |
1143 |
56,63 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q15 |
1026 |
104,86 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q16 |
1148 |
27,36 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q17 |
1140 |
20,73 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q18 |
1111 |
31,31 |
4 |
0,095 |
*** |
|
Q19 |
1106 |
3,05 |
4 |
0,549 |
NS |
|
Q20 |
1058 |
126,8 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q21 |
1161 |
227,09 |
4 |
0,000 |
*** |
Tableau 7a. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,
*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,
p<0,001.
Table 7a. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,
p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01;
***=significant, p<0.001.
|
|
E. secondaire/E. sup. non-universitaire1 |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
203 |
3,59 |
2 |
0,166 |
NS |
|
Q02 |
200 |
1,18 |
2 |
0,554 |
NS |
|
Q03 |
203 |
1,85 |
2 |
0,397 |
NS |
|
Q04 |
203 |
2,92 |
2 |
0,232 |
NS |
|
Q05 |
200 |
0,26 |
2 |
0,88 |
NS |
|
Q06 |
204 |
0,82 |
2 |
0,663 |
NS |
|
Q07 |
200 |
4,9 |
2 |
0,086 |
NS |
|
Q08 |
203 |
0,61 |
2 |
0,738 |
NS |
|
Q09 |
202 |
0,31 |
2 |
0,855 |
NS |
|
Q10 |
Cells with Expected Frequency < 5: 2/6 (33,3%) 2 |
||||
|
Q11 |
201 |
145 |
2 |
0,484 |
NS |
|
Q12 |
198 |
2,71 |
2 |
0,258 |
NS |
|
Q13 |
Cells with Expected Frequency < 5: 3/6 (50%) 2 |
||||
|
Q13' |
137 |
0,15 |
2 |
0,928 |
NS |
|
Q14 |
202 |
1,51 |
3 |
0,681 |
NS |
|
Q15 |
173 |
0,39 |
2 |
0,821 |
NS |
|
Q16 |
198 |
4,15 |
2 |
0,125 |
NS |
|
Q17 |
196 |
0,37 |
2 |
0,832 |
NS |
|
Q20 |
179 |
5,9 |
2 |
0,052 |
NS |
|
Q21 |
199 |
0,83 |
2 |
0,842 |
NS |
1 Musulmans, E.univ.:
N=16.
2 Le test Chi-carré ne remplit pas les conditions nécessaires
de validité (-20%
fréquences attendues<5).
Tableau 7b. Détails des tests Chi-carré sur l’échantillon
d’étudiants musulmans, NS=non-significatif, *=significatif, p<0,05,
**=significatif, p<0,01, ***=significatif, p<0,001.
Table 7b. Results of Chi square tests about the Muslims
students sample, NS=unsignificant, p>0.05; *=significant, p<0.05;
**=significant, p<0.01; ***=significant, p<0.001.
|
|
5ème sec. / 6ème sec. / 1ère ens. sup./ >1ère ens. sup |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
1146 |
19,37 |
6 |
0,004 |
** |
|
Q02 |
1148 |
31,41 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q03 |
1151 |
78,59 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q04 |
1155 |
30,96 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q05 |
1148 |
139,06 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q06 |
1147 |
41,52 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q07 |
1140 |
100,94 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q08 |
1149 |
129,71 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q09 |
1151 |
27,90 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q10 |
1142 |
148,47 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q11 |
1147 |
53,06 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q12 |
1141 |
67,47 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q13 |
1151 |
25,10 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q13' |
779 |
26,04 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q14 |
1139 |
75,47 |
9 |
0,000 |
*** |
|
Q15 |
1022 |
45,65 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q16 |
1144 |
30,24 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q17 |
1136 |
14,22 |
6 |
0,027 |
* |
|
Q18 |
1107 |
103,55 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q19 |
1102 |
7,43 |
6 |
0,283 |
NS |
|
Q20 |
1056 |
111,36 |
6 |
0,000 |
*** |
|
Q21 |
1114 |
81,41 |
9 |
0,000 |
*** |
Tableau 8. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,
*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,
p<0,001.
Table 8. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,
p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01;
***=significant, p<0.001.
|
|
O.littéraire/ O.scientifique |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
1051 |
18,24 |
2 |
0,000 |
*** |
|
Q02 |
1053 |
0,14 |
2 |
0,932 |
NS |
|
Q03 |
1056 |
1,24 |
2 |
0,539 |
NS |
|
Q04 |
1060 |
0,42 |
2 |
0,812 |
NS |
|
Q05 |
1054 |
11,76 |
2 |
0,003 |
** |
|
Q06 |
1052 |
2,43 |
2 |
0,297 |
NS |
|
Q07 |
1047 |
3,97 |
2 |
0,137 |
NS |
|
Q08 |
1053 |
22,99 |
2 |
0,000 |
*** |
|
Q09 |
1056 |
6,86 |
2 |
0,032 |
* |
|
Q10 |
1046 |
29,67 |
2 |
0,000 |
*** |
|
Q11 |
1051 |
20,62 |
2 |
0,000 |
*** |
|
Q12 |
1045 |
36,98 |
2 |
0,000 |
*** |
|
Q13 |
1057 |
1,67 |
2 |
0,434 |
NS |
|
Q13' |
725 |
1,48 |
2 |
0,478 |
NS |
|
Q14 |
1043 |
3,09 |
3 |
0,377 |
NS |
|
Q15 |
930 |
1,22 |
2 |
0,542 |
NS |
|
Q16 |
1047 |
6,02 |
2 |
0,049 |
* |
|
Q17 |
1042 |
2,50 |
2 |
0,287 |
NS |
|
Q18 |
1010 |
2,42 |
2 |
0,299 |
NS |
|
Q19 |
1006 |
0,75 |
2 |
0,688 |
NS |
|
Q20 |
959 |
7,95 |
2 |
0,019 |
* |
|
Q21 |
1018 |
0,17 |
3 |
0,082 |
NS |
Tableau 9. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,
*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,
p<0,001.
Table 9. Results of Chi square tests, NS=unsignificant,
p>0.05; *=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01;
***=significant, p<0.001.
|
|
Etude du père: Sec. inf./ Sec. sup./ Sup. |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |
||||
|
Q02 |
996 |
7,91 |
4 |
0,095 |
NS |
|
Q03 |
997 |
6,44 |
4 |
0,168 |
NS |
|
Q04 |
Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |
||||
|
Q05 |
996 |
22,01 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q06 |
993 |
7,69 |
4 |
0,104 |
NS |
|
Q07 |
988 |
9,50 |
4 |
0,049 |
* |
|
Q08 |
999 |
37,53 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q09 |
Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |
||||
|
Q10 |
991 |
63,91 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q11 |
993 |
71,80 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q12 |
991 |
45,58 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q13 |
998 |
8,18 |
4 |
0,085 |
NS |
|
Q13' |
664 |
17,50 |
4 |
0,002 |
** |
|
Q14 |
988 |
11,16 |
6 |
0,084 |
NS |
|
Q15 |
891 |
41,22 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q16 |
991 |
5,35 |
4 |
0,253 |
NS |
|
Q17 |
Cells with Expected Freq, < 5: 2/9 ( 22,2%) 1 |
||||
|
Q18 |
956 |
1,68 |
4 |
0,795 |
NS |
|
Q19 |
956 |
8,40 |
4 |
0,078 |
NS |
|
Q20 |
921 |
38,76 |
4 |
0,000 |
*** |
|
Q21 |
970 |
30,02 |
6 |
0,000 |
*** |
1 Le test Chi-carré ne remplit pas les conditions
nécessaires de validité (-20% fréquences attendues<5)
Tableau 10. Détails des tests Chi-carré,
NS=non-significatif, *=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01,
***=significatif, p<0,001.
Table 10. Results of Chi square tests, NS=unsignificant, p>0.05;
*=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,
p<0.001.
|
|
Etude de la mère: Sec. inf./ Sec. sup. /Sup. |
||||
|
Question |
N |
|
ddl |
p |
sign. |
|
Q01 |
1005 |
5.71 |
4 |
0.222 |
NS |
|
Q02 |
1006 |
16.60 |
4 |
0.002 |
** |
|
Q03 |
1008 |
13.52 |
4 |
0.009 |
** |
|
Q04 |
Cells with Expected Freq. < 5: 2/9 ( 22.2%) 1 |
||||
|
Q05 |
1005 |
28.96 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q06 |
1004 |
12.21 |
4 |
0.016 |
* |
|
Q07 |
998 |
7.82 |
4 |
0.098 |
NS |
|
Q08 |
1010 |
92.42 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q09 |
Cells with Expected Freq. < 5: 2/9 ( 22.2%) 1 |
||||
|
Q10 |
1000 |
152.86 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q11 |
1004 |
155.46 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q12 |
1001 |
134.91 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q13 |
1009 |
12.28 |
4 |
0.015 |
* |
|
Q13' |
676 |
32.08 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q14 |
1000 |
18.57 |
6 |
0.005 |
** |
|
Q15 |
899 |
67.03 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q16 |
1002 |
5.54 |
4 |
0.236 |
NS |
|
Q17 |
Cells with Expected Freq. < 5: 2/9 ( 22.2%) 1 |
||||
|
Q18 |
968 |
1.72 |
4 |
0.787 |
NS |
|
Q19 |
969 |
15.80 |
4 |
0.003 |
** |
|
Q20 |
929 |
81.21 |
4 |
0.000 |
*** |
|
Q21 |
980 |
51.49 |
6 |
0.000 |
*** |
1 Le test Chi-carré ne remplit pas les conditions
nécessaires de validité (-20%
fréquences attendues<5).
Tableau 11. Détails des tests Chi-carré, NS=non-significatif,
*=significatif, p<0,05, **=significatif, p<0,01, ***=significatif,
p<0,001.
Table 11. Results of Chi square tests, NS=unsignificant, p>0.05;
*=significant, p<0.05; **=significant, p<0.01; ***=significant,
p<0.001.
Les modalités représentant le niveau d’études du père et de la mère des étudiants interrogés ont été groupées dans la représentations schématique (fig. 1: en bleu) car elles présentaient des profils relativement similaires (fig. 2). Nous pouvons observer une « progression » de ces niveaux d’études. En effet, plus les niveaux d’études augmentent, plus l’éloignement aux groupes de mécompréhension théorique, de réponses créationnistes et de réponses anti-darwiniennes est important, traduisant une corrélation négative entre ces modalités. Le niveau d’études du père et de la mère semble donc avoir une influence sur la compréhension et l’opinion des étudiants vis-à-vis de l’évolution, ce que semblent confirmer les analyses Chi-carré (tab. 10 et 11). Cependant, il faut souligner que, parmi les enfants de père et/ou de mère n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur, respectivement 74% et 83% sont de confession musulmane, ce qui créé une hétérogénéité de distribution des étudiants laïques, catholiques et musulmans interrogés au sein des trois catégories de degré d’instruction parental (tab. 6, Chi-carré: p<0,001). Cette hétérogénéité est clairement observable dans les figures de l’analyse factorielle des correspondances multiples (fig. 1 et fig. 2).
V. Discussion
V.1. Influence de la religion
V.1.1.Sur la compréhension de la théorie de
l’évolution
Nous avons montré que les étudiants de confession musulmane interrogés
paraissent moins performants du point de vue de la compréhension des concepts
de la théorie de la sélection naturelle que ne le sont les étudiants de
confession catholique et les étudiants laïques. En fait, le développement de
mécompréhensions est en partie lié aux conceptions créationnistes développées
par les étudiants. En effet, l’analyse des correspondances a clairement montré
que les réponses traduisant une mécompréhension de la théorie de la sélection
naturelle sont corrélées positivement aux réponses traduisant une conception
créationniste du monde vivant. A l’inverse, les réponses de compréhension
néodarwinienne sont corrélées positivement aux réponses évolutionnistes.
Pourtant, de nombreuses études précédentes ont montré que les croyances
créationnistes n’empêchaient pas de comprendre correctement les concepts de la
théorie de l’évolution (ex.: Bishop et Anderson, 1990; Sinatra et al., 2003). Il est vrai que croire et comprendre
sont des choses très différentes (Blackwell et al., 2003) mais les croyances sont parfois si
puissantes qu’elles peuvent modifier la perception des phénomènes objectifs
(Alters et Nelson, 2002; Kordig, 1971 dans Blackwell et al., 2003). McKeachie et
al. ont montré en 2002 que les convictions
créationnistes affectaient l’apprentissage et donc les performances des
étudiants. Ils sont plus anxieux, moins motivés à apprendre et moins réceptifs
aux nouvelles informations que ne le sont les étudiants qui ne ressentent pas
de conflit entre leurs croyances et la théorie de l’évolution. Notre étude
confirme ce résultat et c’est pourquoi, le travail des enseignants est si
difficile. De nombreuses techniques d’enseignement de l’évolution sont
développées dans la littérature (Jensen et Finley, 1997; Passemore et
Stewart, 2001; Wallin et al., 2001; Hagman et al., 2002; Trowbridge et
Wandersee, 2003; Scharmann,
2005). Quelle que soit l’approche choisie, les enseignants sont de plus en
plus souvent encouragés à initier le débat en classe au sujet des
problématiques autour de l’évolution (Southerland, 1996; Cooper, 2001; Cobern,
2001; Scharmann, 2005) afin de ne pas accentuer la démotivation des élèves et
afin de conserver ce rapport de confiance et de respect indispensable à tout
processus pédagogique efficace (Scott, 1997a; Woods et Scharmann, 2001). De
plus, initier le débat permet de mettre en avant les pré-conceptions des élèves
sur l’évolution, la nature de la science ou l’acceptation de la théorie de
l’évolution. Si leurs pré-conceptions ne sont pas mises en avant, les élèves
sont moins réceptifs aux concepts enseignés et n’apprennent aux mieux leurs
leçons que pour l’examen (Alters et Nelson, 2002). Ensuite, il est essentiel,
pour les enseignants, de connaître les pré-conceptions des élèves afin de
mettre en place un enseignement efficace (Bishop et Anderson, 1990). Il est
vrai que des études ont aussi montré qu’il est beaucoup moins stressant pour
les enseignants de ne pas engager la polémique en classe, en considérant que ce
genre de débat n’a rien à faire dans une classe de sciences (Griffith et Brem,
2004). Notre travail montre d’ailleurs que les débats sont rares alors que la
majorité des étudiants en souhaite.
V.1.2. Sur l’acceptation de l’évolution
Il paraît évident que les convictions religieuses influencent l’acceptation de l’évolution en tant que phénomène naturel. Nos résultats n’apportent pas de nouvelles informations sur ce point. Par contre, nous avons pu mettre en évidence que les étudiants interrogés choisissant les réponses créationnistes sont majoritairement de confession musulmane. Les étudiants catholiques interrogés paraissent quant à eux accepter massivement l’évolution. Près d’un quart de la population estudiantine bruxelloise échantillonnée choisi de répondre que l’homme est une création divine. Cette importante proportion s’explique principalement par une forte concentration de la population musulmane belge à Bruxelles (Feld et Manço, 2000).
Il est quand même intéressant de noter que la majorité des étudiants interrogés choisissant les réponses créationnistes manifestent des systèmes de croyances incohérents. Les conceptions qui rentrent en contradiction avec d’autres sont définies comme incohérentes (Thagard, 1989 dans Evans, 2001). Ainsi, beaucoup considèrent que les animaux et l’homme ont été créés par Dieu pourtant l’évolution des animaux semble massivement acceptée tandis que l’évolution de l’homme semble massivement rejetée (parmi les étudiants choisissant le réponses créationnistes, 70% et 30% paraissent "créationnistes théistes" en ce qui concerne respectivement les animaux et l’homme). L’incohérence cognitive de cette position peut s’expliquer de deux façons différentes.
1/ Pour commencer, elle peut signifier une position créationniste majoritairement théiste pour les animaux et une position littéraliste pour l’homme. Evans (2001) a déjà montré ce type de résultat chez des chrétiens américains. Cela n’est en effet pas surprenant étant donné que le point sensible des débats se trouve être l’évolution de l’homme (Downie et Barron, 2000; Blackwell et al., 2003). Non seulement l’homme est la créature privilégiée de Dieu mais en plus, il est le gardien des valeurs morales. Les écrits du Vatican ont confirmé ce point: il existe une tendance rationalisante néodarwinienne qui met l’humanité de l’homme en danger (Jean-Paul II, 1998; Schönborn, 2005). Cet attachement à ne pas reconnaître l’animalité de l’homme tient donc, en partie, de la crainte de perdre toute référence absolue de moralité (Allchin, 1989 dans Downie et Barron, 2000; Moore, 2000; Blackwell et al., 2003). Nos résultats montrent d’ailleurs que bien que l’homme soit majoritairement reconnu comme étant un animal, il paraît considéré comme habité par un principe insaisissable, qui est l’âme pour les musulmans interrogés et la conscience pour les laïques et les catholiques interrogés. Les étudiants répondants paraissent donc en majorité d’accord avec le point de vue de Jean-Paul II qui considère que l’évolution concerne le corps de l’homme mais pas son âme (Jean-Paul II, 1998). La tendance rationnalisante du néodarwinisme existe d’ailleurs bel et bien puisque la "conscience" et l’"âme" font partie de ses ambitions explicatives (ex.: Searle, 1996). Scott (1997b) souligne que des conflits entre les religions et le néodarwinisme ne vont pas tarder à surgir à ce sujet.
D’un point de vue méthodologique, il est intéressant de faire quelques commentaires. Premièrement, Blackwell et al. (2003) souligne que les deux difficultés rencontrées avec la théorie de l’évolution concernent l’animalité de l’homme et sa macro-évolution. En effet, si la plupart des créationnistes acceptent les processus de micro-évolution, il n’en est pas de même de la macro-évolution. Dans notre questionnaire, le terme "évolution" traduit les processus de macro-évolution mais dans une version retravaillée du questionnaire, il serait intéressant d’établir des questions sur ce point afin de préciser cette nuance. Deuxièmement, Evans (2001) a montré que les positions mixtes, évolutionnistes pour les animaux et créationnistes pour l’homme, sont plus nombreuses dans le cadre d’un questionnaire à questions ouvertes que dans le cadre d’un questionnaire à questions fermées. Ceci n’a rien d’étonnant. Il est évident qu’il est impossible de proposer un ensemble exhaustif des réponses possibles à une question. Les répondants sont obligés de faire un choix parmi des réponses qui ne traduisent pas parfaitement leurs représentations. Nous avons d’ailleurs reçu des commentaires à ce sujet de la part des répondants. Les questions ouvertes permettent donc aux individus d’exprimer au mieux leurs opinions. De plus, Scott (1999) rapporte que s’il est demandé aux gens de choisir entre une explication religieuse et une explication scientifique quand elles se contredisent, 64% des gens déclarent qu’ils "sont plus enclins à accepter la réponse religieuse" (Gallup, 1999). Au vu de cette étude, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’une surévaluation des convictions créationnistes littéralistes due à la forme fermée du questionnaire. Cependant, Gilly M. (1980) souligne le caractère utopique de penser percevoir les représentations d’autrui dans leur intégralité à travers un questionnaire. C’est pourquoi, malgré les critiques qui peuvent être faites, nous avons opté pour un type de questionnaire très structuré qui force le répondant à faire un choix. Et faire tel ou tel choix a, selon nous, du sens. Il a d’autant plus de sens qu’il est possible de commenter les choix faits. De plus, la forte structuration du questionnaire permet une plus grande rigueur comparative (Gilly, 1980).
2/ Ensuite, l’incohérence des positions créationnistes peut aussi traduire la confrontation cognitive vécue par les étudiants croyants entre les "vérités" apportées par la science et la Vérité donnée par la religion. Ils sont confrontés à deux façons souvent incompatibles de concevoir le monde. C’est pourquoi, beaucoup d’étudiants ne font pas de choix, sauf s’ils y sont contraints comme c’est le cas par certaines questions de notre questionnaire. Dans leurs conceptions du monde, ils séparent la religion et la science et ne cherchent pas à accorder leurs vérités. Ainsi, dans le cadre de notre étude, certains élèves choisissent à la fois les réponses créationnistes (ex.: "Dieu a créé l’homme") et les réponses évolutionnistes (ex.: "L’homme est issu d’un long processus d’évolution") en précisant que si la première est vraie selon la religion, la seconde est vraie du point de vue scientifique. L’incohérence de certaines réponses peut donc aussi traduire ce choix cognitif "schizophrénique": d’une question à l’autre, les étudiants font le choix de répondre selon la religion ou selon la science sans rechercher la cohérence.
V.1.3. Sur les opinions vis-à-vis de la
théorie de l’évolution
En cohérence avec l’acceptation de l’évolution, les convictions religieuses influencent l’opinion vis-à-vis de la théorie l’évolution. Elle est majoritairement considérée comme la meilleure explication actuelle du développement de la vie par les laïques et les catholiques interrogés, même si ces derniers paraissent se montrer plus critiques quant à son application à l’homme et se sentir minoritairement en conflit partiel avec elle. Quant aux choix des étudiants musulmans interrogés, ils semblent montrer que ces derniers sont majoritairement non convaincus par la théorie de l’évolution et qu’ils ne pourront jamais l’accepter. Nous avions souligné dans l’introduction la particularité du Coran en tant qu’il est considéré comme la parole directe de Dieu (Guide pratique, 2004). Nous retrouvons probablement ici les effets de cette particularité. Pour beaucoup de musulmans, il semble que le Coran ne puisse être interprété que littéralement. L’homme descend d’Adam et d’Eve et non d’un ancêtre commun avec les grands singes actuels, peu importe qu’il y ait 99% d’ADN en commun. De plus, si les musulmans accordent une place importante dans leur vie à la religion et se déclarent presque tous pratiquants (85,1%), c’est loin d’être le cas des étudiants catholiques interrogés (25,7%). La religion occupe une place plus que secondaire dans leur vie, ce qui peut expliquer, en partie, une ouverture d’esprit plus importante aux découvertes de l’évolution.
V.2. Influence de l’enseignement: niveau
d’enseignement, année d’études et orientation
V.2.1. Sur la compréhension de la théorie de
l’évolution
Au vu des résultats
que nous avons présentés, le degré d’instruction (niveau d’enseignement et
année d’études) des étudiants influence leur compréhension des concepts
d’évolution. Les étudiants universitaires paraissent en avoir une meilleure
compréhension que les étudiants de l’enseignement supérieur non-universitaire
qui semblent mieux comprendre que les élèves du secondaire. Les analyses
Chi-carré et l’analyse des correspondances ont montré ce résultat. Pour ce qui est de l’année d’études,
les élèves de la dernière année des études secondaires (6ème année)
ne paraissent pas réellement plus performants que les élèves de
l’avant-dernière année (5ème année secondaire) qui n’ont jamais eu
de cours sur l’évolution. Et théoriquement, les populations estudiantines de 6ème
et 1ère année des études supérieures sont, à quelques mois près,
équivalentes du point de vue de l’instruction. Or, de façon surprenante, les
différences significatives se marquent principalement entre ces deux années
d’études. Ainsi, nous pensons que cette absence de différence significative
entre les élèves de 5ème et les élèves de 6ème année
secondaire peut probablement être expliquée par le fait que les élèves
interrogés de dernière année secondaire n’ont pas encore intégré les concepts
de la théorie de la sélection naturelle. Les examens de fin d’année scolaire
contribuent sûrement beaucoup à cette intégration, ce qui explique que les
différences positives de compréhension se manifestent en 1ère année
d’études supérieures. Selon nous, les cours sur l’évolution donnés en dernière
année secondaire améliorent donc la compréhension des élèves. Quant à
l’orientation, littéraire ou scientifique, elle n’a pas réellement d’influence
sur la compréhension que les étudiants ont des concepts d’évolution. Par
contre, les étudiants d’orientation biologique, qui de plus sont de niveau
universitaire, semblent logiquement marquer une véritable différence de
compréhension.
En fait, malgré ces changements significatifs d’un enseignement à l’autre, les étudiants choisissent majoritairement la réponse de compréhension conforme au néodarwinisme pour la plupart des concepts envisagés. Nous avons montré que les deux concepts les plus sujets à des mécompréhensions sont les concepts d’adaptation et de variation. L’interprétation finaliste de ces processus est très courante même après les cours sur l’évolution. Ce résultat est en accord avec de nombreuses études précédentes (ex.: Deadman et Kelly, 1978; Bishop et Anderson, 1990; Greene, 1990; Demastes et al., 1995; Firenze, 1997; Samarapungavan et Wiers, 1997; Wallin et al., 2001). En ce qui concerne les variations, la majorité des étudiants choisit la réponse qui les interprète comme le résultat des modifications de conditions environnementales. Ainsi, les variations ne précèdent plus ces modifications mais les suivent et la nature ne joue donc plus un rôle sélectif mais instructif (Kupiec et Sonigo, 2000). De même, l’adaptation paraît répondre aussi au « besoin » des organismes: elle n’est pas l’effet de la sélection naturelle sur plusieurs générations, elle répond au besoin immédiat des individus. Ces points fondamentaux de la théorie de la sélection naturelle sont donc massivement mal compris. Et de plus, ce type de compréhension naïve est très résistant aux changements (Bishop et Anderson, 1990; Cooper, 2001). Plusieurs hypothèses explicatives sont envisageables pour expliquer cette résistance.
Premièrement, la logique finaliste d’adaptation, qui veut que l’adaptation survienne pour répondre au « besoin » des organismes, est celle du quotidien. Au quotidien, ce terme est souvent utilisé pour traduire les changements individuels journaliers notamment au niveau des comportements ou de la morphologie. Il est vrai que de nombreuses caractéristiques des animaux changent sur de courtes périodes de temps, en réponse aux climats saisonniers par exemple (Firenze, 1997; Evans, 2001). Ainsi, les explications finalistes des processus évolutifs sont plus intuitives que les explications néodarwiniennes (Hagman et al., 2002, Moore et al., 2002). Moore et al. (2002) soulignent que ces mécompréhensions sont aussi dues aux enseignants, et au monde scientifique en général, qui utilisent souvent un langage finaliste dans le but de rendre accessible aux étudiants cette théorie complexe. Certains chercheurs considèrent d’ailleurs que l’usage fréquent du terme « besoin » par les étudiants ne traduit pas forcément une mécompréhension de leur part. Il peut manifester une simple tentative d’expliquer au mieux les processus évolutifs (Southerland, 1996; Wallin et al., 2001; Hagman et al., 2002).
Deuxièmement,
la résistance des mécompréhensions finalistes peut aussi s’expliquer par le
fait que beaucoup d’étudiants paraissent avoir des difficultés avec la notion
de hasard (Deadman et Kelly, 1978; Wallin et al., 2001). Ce terme est souvent
perçu comme un paravent pour
cacher l’ignorance des scientifiques: est expliqué par le hasard ce qui ne peut
être expliqué autrement. De plus, la notion de hasard, centrale dans la théorie
de l’évolution, est au coeur de la polémique entre les évolutionnistes théistes
et les évolutionnistes néodarwiniens. En effet, si les théistes acceptent
l’évolution, ils considèrent que les processus évolutifs sont guidés par Dieu. L’homme ne peut pas être le fruit du hasard, s’il existe c’est la volonté de Dieu (Schönborn, 2005).
Sur ce point, les théistes et les néodarwiniens ne s’entendront jamais. C’est
pourquoi, certains chercheurs en appellent à plus de tolérance de la part des
scientifiques afin de ne pas fermer la porte aux évolutionnistes théistes
(Ruse, 1997; Scott, 1997a et b). Ils soulignent qu’aucune observation dans la
nature n’indique que l’évolution est sans dessein. Affirmer l’impossibilité d’une action divine ne
relève pas de la science mais d’une idéologie appelée le matérialisme
philosophique (Scott, 1997a). La science doit fonctionner de façon méthodologiquement
matérialiste: elle ne doit pas faire intervenir de causes supra-naturelles
(Dieu) pour expliquer les phénomènes. Mais ce matérialisme méthodologique ne
doit pas devenir un matérialisme philosophique car c’est donner du poids aux
arguments anti-darwiniens qui accusent la théorie de l’évolution d’être non
scientifique et idéologique (Scott, 1997a).
V.2.2. Sur l’acceptation de l’évolution
Le degré d’instruction (enseignement, année d’études) semble influencer
l’acceptation de l’évolution par les étudiants catholiques mais pas par les
étudiants musulmans. Pour les étudiants catholiques interrogés, les
pourcentages des réponses évolutionnistes, déjà majoritaires, tendent à
augmenter avec le degré d’instruction. En ce qui concerne les étudiants musulmans
interrogés, les réponses créationnistes restent majoritaires de façon
équivalente quel que soit le degré d’instruction.
Il faut souligner qu’un nombre très faible d’étudiants musulmans a été
interrogé à l’université. En fait, les musulmans issus de l’immigration, par
exemple marocaine ou turque, semblent présenter une scolarisation
difficile et il a été observé que peu d’entre eux
poursuit des études supérieures (Feld et Manço, 2000). C’est explicable en partie parce que la
population musulmane bruxelloise est caractérisée par un niveau
socio-économique faible: plus de 80% des élèves musulmans du secondaire interrogés
se trouvent dans des établissements à discrimination positive, c’est-à-dire que
le niveau socio-économique moyen des élèves de l’établissement est inférieur à
la moyenne bruxelloise et plus de 60% et 75% des étudiants musulmans interrogés ont un père
et/ou une mère ayant, au mieux, arrêté leurs études après le secondaire. Ceci
peut expliquer qu’ils sont une majorité à ne pas continuer leurs études ou à
s’inscrire dans des études supérieures de type court (graduat, 3 ans) afin de
travailler au plus vite. L’analyse des correspondances montre d’ailleurs que le
taux de participation aux études universitaires est fortement corrélé au niveau
d’études des parents, ce qui a déjà été démontré (Drolet, 2005).
Quoi qu’il en soit, un sondage américain a montré que le pourcentage de
conceptions créationnistes diminue graduellement lorsque le niveau
d’enseignement augmente (Gallup, 1999 dans Rennie, 2002). Nos résultats le
confirment mais uniquement pour les étudiants de confession catholique.
V.2.3. Sur les opinions vis-à-vis de la
théorie de l’évolution
A nouveau, si le degré d’instruction influence les opinions des
étudiants catholiques, il n’en est pas de même pour les étudiants musulmans
interrogés. Les étudiants catholiques sont plus nombreux à l’université qu’en
secondaire à choisir la réponse acceptant la théorie de l’évolution comme la
meilleure explication scientifique actuelle du développement de la vie sur
Terre et elle semble de moins en moins ressentie comme conflictuelle avec les
croyances. Les étudiants musulmans interrogés paraissent rester quant à eux
majoritairement non convaincus et en conflit avec elle, quel que soit le degré
d’instruction.
V.3. Influence du niveau d’études du père
et de la mère
V.3.1.
Sur la compréhension de la théorie de l’évolution
Le niveau d’études des parents, et en particulier de celui de la mère (fig.2 et tab.11), influence la compréhension que les étudiants ont de la théorie de la sélection naturelle. Nous constatons que les enfants de parents universitaires manifestent une meilleure compréhension. Il a déjà été montré que les enfants de parents n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur ou le secondaire supérieur, sont moins performants au niveau scolaire comparés aux enfants de parents universitaires (Worswick, 2001). En fait, les parents universitaires investissent davantage de leur temps aux soins directs à leurs enfants et donc à leur travail scolaire (Zuzanek, 2000). Cependant, il faut souligner que 74% et 83% des enfants de père et de mère n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur dans notre étude sont de confession musulmane. Nous avons déjà signalé que les musulmans issus de l’immigration marocaine ou turque présentent une scolarisation difficile. Cette difficulté semble notamment s’expliquer par le très faible niveau de scolarisation des parents et un investissement parental faible dans le travail scolaire de l’enfant (Feld et Manço, 2000) mais aussi par une mauvaise connaissance du français. Feld et Manço (2000) ont montré par exemple que seulement 5% des jeunes turcs pratiquent régulièrement le français au sein de leur famille. Une mauvaise maîtrise de la langue française peut en effet expliquer en partie la moindre performance des élèves musulmans.
V.3.2. Sur l’acceptation de
l’évolution et sur les opinions vis-à-vis de la théorie de l’évolution
Il ne semble pas y avoir d’influence remarquable du niveau d’études du père ou de la mère sur l’acceptation de l’évolution et des théories associées. Les différences mises en évidence par les analyses Chi-carré effectuées sur l’ensemble des étudiants interrogés sont principalement dues au fait que 74% et 83% des enfants de père et mère n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur sont de confession musulmane.
V.4. Perspectives de recherches
Il serait intéressant d’affiner la comparaison entre la population
estudiantine catholique et la population estudiantine musulmane. Pour ce faire,
il est essentiel de comparer des populations de niveaux socio-économiques
similaires. Ce n’est pas le cas dans notre étude. En effet, les étudiants
catholiques interrogés sont d’un milieu socio-économique relativement élevé
(majoritairement dans des établissements sans discrimination positive, haut
degré d’instruction individuel et parental). Un échantillonnage des étudiants
issus de l’immigration italienne (que l’ont peut raisonnablement supposés
majoritairement catholiques) pourrait peut-être apporter des information
intéressantes. Il nous aurait été impossible de toucher ce type de population à
Bruxelles. En effet, il existe un phénomène important de concentration
géographique des populations d’origine immigrée. Par exemple, 75% des immigrés italiens habitent en
Wallonie et 52%
des Marocains à Bruxelles (Feld et Manço, 2000). De plus, interroger les
étudiants d’une université confessionnelle permettrait d’affiner
l’échantillonnage universitaire. Ainsi, nous pensons que développer une étude
d’une plus grande ampleur qui couvrirait toute la Belgique francophone et
utiliserait une version retravaillée du questionnaire, afin d’en combler les
lacunes, apporterait certainement de nouvelles informations et affinerait
celles déjà apportées par notre
étude.
VI. Conclusions générales
L’évaluation de l’opinion des étudiants bruxellois vis-à-vis de l’évolution nous a fournit plusieurs résultats intéressants. Premièrement, nous avons montré que les convictions religieuses influencent négativement la compréhension de la théorie de l’évolution en diminuant probablement la qualité de son apprentissage par refus ou démotivation de l’étudiant. En effet, les étudiants ressentant leurs croyances en conflit avec la théorie semblent manifester davantage de mécompréhensions que les autres. Les convictions religieuses influencent également négativement les opinions développées par les étudiants vis-à-vis du concept d’évolution en tant que tel mais aussi vis-à-vis de la théorie de l’évolution. Elle ne paraît dès lors plus considérée comme la meilleure explication actuelle du développement de la vie. Les étudiants choisissant les réponses créationnistes, lorsqu’ils doivent choisir entre les réponses créationnistes, évolutionnistes ou celles marquant une indécision, sont majoritairement de confession musulmane. Les étudiants catholiques interrogés choisissent quant à eux majoritairement les réponses évolutionnistes aux questions posées. Nous avons également souligné le caractère incohérent des choix créationnistes qui acceptent majoritairement une évolution de type théiste pour les animaux mais refusent celle de l’homme. Ainsi, si une interprétation symbolique paraît acceptable pour les animaux, la création de l’homme est davantage comprise littéralement. Il n’est pas inutile de souligner que près d’un quart de la population estudiantine échantillonnée choisi de répondre que l’homme est une création divine. En définitive, l’homme paraît considéré comme une espèce animale à part et ce, même par les laïques. Deuxièmement, nous avons montré que le degré d’instruction et les cours donnés sur l’évolution en dernière année des études secondaires influencent positivement la compréhension des étudiants vis-à-vis de la théorie de la sélection naturelle. Cependant, les choix de réponses traduisant une interprétation finaliste de l’évolution restent très courants car ce type d’interprétation semble beaucoup plus intuitif pour les étudiants. De plus, nous avons montré une corrélation positive entre l’augmentation du degré d’instruction des étudiants et la diminution de fréquence des choix de réponses traduisant des conceptions créationnistes et anti-darwiniennes pour les étudiants catholiques, qui semblent par ailleurs majoritairement évolutionnistes. A l’inverse, les étudiants musulmans interrogés choisissent majoritairement les réponses créationnistes et anti-darwiniennes quel que soit leur degré d’instruction. Enfin, nous avons montré que le niveau d’études des parents influence la compréhension de la théorie de la sélection naturelle développée par les étudiants. En effet, un faible degré d’instruction parental paraît influencer négativement leur investissement scolaire et la majorité des enfants musulmans issus de l’immigration a des parents faiblement scolarisés. Nos résultats ne montrent pas d’influence significative du niveau d’études des parents sur les opinions développées vis-à-vis de l’évolution et de la théorie (néo)darwinienne de l’évolution.
Remerciements: Nous tenons à remercier le Pr. Martine Vercauteren
(ULB) pour ses conseils éclairés lors de la réalisation de cette étude et bien
sûr, l’ensemble des enseignants et des étudiants sans la participation desquels
cette étude n’aurait pas été possible.
Références bibliographiques
Alters B.J, 1999, What is creationism?, The American Biology Teacher 61(2), 103-106.
Alters B.J., Nelson, C.E, 2002, Perspective: teaching evolution in higher education, Evolution 56(10), 1891-1901.
Anderson D.L., Fisher K.M., Norman G.J., 2002, Development and Evaluation of the Conceptual Inventory of Natural Selection, Journal of Research in Science Teaching 39(1), 952-978.
Bishop B.A. et Anderson C.W., 1990,
Student conceptions of natural selection and its role in evolution, Journal of
Research in Science Teaching 27(5), 415-427.
Blackwell W.H., Powell M.J. et Dukes
G.H., 2003, The problem of student acceptance of evolution, Journal of
Biological Education 37(2), 58-67.
Brem S.K., Ranney M., Schindel J.,
2003, Perceveid consequences of evolution: College students perceive negative
personal and social impact in evolutionary theory. Science Education, 87,
181-206.
Campbell N.A., 1995, Biologie, 3ème
édition, De Boeck Université, Bruxelles, 1190 p.
Cobern W.W., 2001, A reasoned
approach to the teaching of evolution in the public’s interest, Paper presented at the tri-annual meeting of the International History, Philosophy
and Science Teaching Group Denver, CO.
Cooper R.A., 2001, The goal of evolution
instruction: belief or literacy?, Reports on the National Center for Science
Education, 21, 1-2, 14-18.
Deadman J A. et Kelly P.J., 1978,
What Do Secondary School Boys Understand About Evolution and Heredity Before
They are Taught the Topics? Journal of Biological Education 12(1), 7-15.
Dictionnaire
d’histoire et de philosophie des sciences, 1999, sous la direction de Dominique
Lecourt, Quadrige/PUF, Paris, 1005p.
Dobzhansky Theodosius, 1973, Nothing
in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. The American Biology
Teacher 35(3), 125-129.
Downie J.R. et Barron N.J, 2000,
Evolution and religion: attitudes of scottish first year biology and medical
students to the teaching of evolutionary biology, Journal of Biological
education 34(3), 139-146.
Drolet M., 2005, Participation aux études postsecondaires au Canada le rôle du revenu et du niveau de scolarité des parents a-t-il évolué au cours des années 1990?, produit n°11F0019MIF au catalogue de Statistique Canada, document de recherche no 243, 51p.
Evans E.M., 2001, Cognitive and
Contextual Factors in the Emergence of Diverse Belief Systems: Creation versus
Evolution. Cognitive Psychology
42, 217-266.
Feld
Serge et Manço Altay, 2000, L'intégration des jeunes d'origine étrangère dans
une société en mutation. L'insertion scolaire, socioculturelle et
professionnelle en Belgique, L'HARMATTAN - Logiques Sociales, Paris, 218 p.
Firenze R., 1997, Lamarck vs.
Darwin: dueling theories. Reports of the National Center for Science Education
17(4), 9-11.
Gould Stephen Jay, 1991, La Vie est
Belle, les Surprises de l’Evolution, éditions du Seuil, pour la traduction
française, 469p.
Gould S.J., 1997, La Mal-Mesure de l’Homme, nouvelle édition, Odiles Jacob, Paris, 468p.
Gould S.J. et Eldredge N., 1993, Punctuated equilibrium comes of age. Nature, 366, 223-227
Greene E.D.Jr., 1990, The logic of
university students’ misunderstanding of natural selection. Journal of Research
in Science Teaching 27(9), 875-885.
Guide pratique des religions et des convictions, 2004, Communauté française de Belgique, Ousia, Bruxelles, 51p.
Hagman M., Olander C., Walin A., 2002, Research-based teaching about biological evolution. In Lewis J., Magro A. and Simonneaux L., Eds, Biology Education for the Real World. Student-Teacher-Citizen, pp 105-119.
Jean-Paul II, 1997, The Pope’s message on evolution and four commentaries, Le Message de l’académie pontificale
des sciences, The Quaterfly Review of Biology 72(4), 377-379.
Jean- Paul II, 1998, Fides et Ratio, Encyclique, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/en
cyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_en.html
Jensen M.S. et Finley F.N, 1997,
Teaching Evolution Using a Historically Rich Curriculum and Paired Problem
Solving Instructional Strategy. The American Biology Teacher 59(1), 208-212.
Kuhn
Thomas, 1983, La Structure des Révolutions Scientifiques, éditions Flammarion,
Paris, pour la version française, 284 p.
Kotek, J. et Kotek, D., 1986,
L’affaire Lyssenko, Editions complexes, Bruxelles, 238p.
Kupiec Jean-Jacques et Sonigo Pierre, 2000, Ni Dieu ni Gène, Pour une Autre Théorie de l’Hérédité, Paris , éditions du Seuil, 229p.
Lebart L., Morineau A. et Fénelon J-P, 1982, Traitement des données statistiques: méthodes et programmes, Bordas, Paris, 510 pp.
Mayr E., 1982, The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution and Inheritance, Cambridge MA, Harvard University Press.
McKeachie
W.J., Lin Y-G. et
Strayer J., 2002, Creationist vs. Evolutionary Beliefs: Effects on Learning
Biology. The American Biology Teacher 64(3), 189-193.
Moore R., 2000, The revival of
creationism in the United States. Journal of Biological Education 35(1), 17-21.
Moore R., Mitchell G., Bally R.,
Inglis M., Day J. et Jacobs D., 2002, Undergraduates’ understanding of
evolution: ascription of agency as a problem for student learning. Journal of
Biological Education 36(2), 65-71.
Nickels M.K., Nelson C.E., et Beard
J., 1996, Better Biology Teaching by Emphasizing Evolution et the Nature of
Science. The American Biology Teacher 58(6), 332-336.
Passmore C. et Stewart J., 2001, A
Modelling Approach to Teaching Evolutionary Biology in High Schools. Journal of
Research in Science Teaching 39(3), 185-204.
Popper K.R., 1973, La Logique de la Découverte Scientifique, trad. N. Thyssen-Rutten et Philippe Devaux, Payot, Paris, 480p.
Rennie John, 2002, 15 Answers to Creationist Nonsense, Scientific American, 287 (1), 78-85
Ruse Michael, 1997, John Paul II and
Evolution, The Quaterly Review of Biology, 72(4), 391-395.
Samarapungavan A., et Wiers R.W.,
1997, Children’s Thoughts on the Origin of species: A Study of explanatory
Coherence. Cognitive Science 21(2), 147-177.
Sayin Ümit et Kence Aykut, 1999, Islamic scientific creationism: a new challenge in Turkey, Reports on the National Center for Science Education, 19(6),18-20,25-29.
Scharmann
L.C., 2005, A Proactive Strategy for Teaching Evolution - 'Why do I have to
know this stuff?', The
American Biology Teacher 67(1), 12-16.
Scott E.C., 1997a, Dealing with anti-evolutionism, Reports on the National Center for Science Education, 17, 4, 24-30.
Scott E.C., 1997b, Creationists and the Pope’s statement, The Quaterly Review of Biology, 72(4), 401-406.
Schönborn C., 07/07/2005, Finding
design in nature, The New York Times, http://www.millerandlevine.com/km/evol/catholic/schonborn-NYTimes.html
Searle J.R., 1996, Deux biologistes
et un physicien en quête de l’âme, La Recherche 287, 62-77.
Sinatra G.M., Southerland S.A., McConaughy F. et Demastes J.W., 2003, Intentions and beliefs in students’ understanding and acceptance of biological evolution. Journal of Research in Science Teaching 40(5), 510-528.
Southerland S. A., 1996). Acknowledging students' agency: Science educators' responsibility in evolution education. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, St. Louis, MO, April.
Susanne,
C., 2004, L’enseignement de la biologie et de l’évolution, (humaine) en
péril ?, Antropo 8, 1-31. www.didac.ehu.es/antropo
Tort
P., 1999, Darwinisme. Dans Dictionnaire d’histoire et de philosophie des
sciences, sous la direction de Dominique Lecourt, Quadrige/PUF, Paris, 275-284.
Trowbridge J.E. et Wandersee J.H., 2003, Indentifying critical junctures in learning in a college course on evolution, Journal of Research in Science Teaching 40 (supplément), 140-154.
Vercauteren M. et Slachmuylder J-L,
1993, Croissance d’enfants belges en milieu urbain, (Bruxelles) et rural
(Viroinval), Anthropologie et Préhistoire, 104, 119-132
Wallin
A., Hagman M., Olander C., 2001, Teaching and learning about the biological
evolution: Conceptual understanding before, during and after teaching. In
Proceedings of the III Conference of ERIDOB, p.127-139.
Woods S.C. et Scharmann L.C., 2001, High
scholl students’perceptions of evolutionary theory (with implications for
instruction) Electronic Journal of Science Education, 6(2), http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/woodsetal.html,
13p.
Worswick C., 2001, Le rendement scolaire d’enfants d’immigrants au Canada, 1994 à 1998, produit no 11F0019MIF au catalogue de Statistique Canada, document de recherche no 178, 36p.
Yahya Harun, 2003, Le Mensonge de l’Evolution, Essalam, Paris
a: http://www.mensongedelevolution.com/chapitre17.php
b: http://www.mensongedelevolution.com/sprefacespeciale_1.php
Zuzanek J., 2000, Les effets de
l’emploi du temps et des contraintes de temps sur les relations
parents-enfants, Sommaire de rapport de recherche, Ottium publications, 34p.